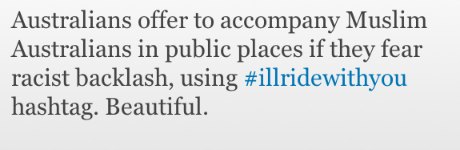« Vous subissez actuellement un retard de 25 minutes en raison de la découverte un peu plus tard dans la soirée d’un colis suspect en gare de Châtelet », crachotent à intervalles réguliers les haut-parleurs avec la poésie propre à la SNCF. La foule s’engouffre dans la voiture après avoir attendu pendant plus d’une demi-heure sur le quai l’arrivée du train. Après les menaces proférées par l’État islamique, appelant à frapper et tuer partout « les méchants et sales Français », et l’assassinat d’Hervé Gourdel fin septembre, les alertes au colis piégé se sont multipliées, perturbant quotidiennement le fonctionnement de la ligne D, qui n’avait pas besoin de cela pour être très aléatoire. Très sollicités, les services antidéminage s’acquittent de leur tâche avec le plus grand sérieux. Mais nul ne semble s’étonner de ce ralentissement du trafic imputé à la découverte d’un colis piégé « un peu plus tard dans la soirée »…
Dans le wagon, la clientèle habituelle d’un lundi soir : quelques ados qui sortent de cours, un ou deux profs qui commencent déjà à s’assoupir, trois Pakistanais qui sortent d’un chantier et font ricocher les syllabes exotiques d’une conversation qui roule comme une cataracte enjouée et un grand Africain en boubou coloré au profil d’oiseau de proie et au regard caché derrière des lunettes de soleil.[access capability= »lire_inedits »] Le troupeau des scolaires grimpe en voiture aux stations suivantes. Le matin, il vaut mieux les éviter et partir très tôt. À partir de 7 h 30, le signal d’alarme est systématiquement tiré par un petit malin négociant ainsi habilement un retard en cours qui sera mieux accepté à trente que tout seul. De même, si l’on préfère voyager tranquille, mieux vaut s’installer dans la partie basse de la voiture, quitte à moins bien profiter des paysages riants de la banlieue nord et de la plaine Saint-Denis. L’étage supérieur est en général à cette heure-ci envahi par des groupes d’ados braillards qui hurlent par-dessus les vocalises de Kerry James ou Nicki Minaj vomies par leurs téléphones. Quelquefois, ils se courent après à travers le wagon sans même faire lever un sourcil aux voyageurs plongés dans Métro ou 20 Minutes, le MP3 sur les oreilles, indifférents au monde et à son cours.
Pour autant, le cliché de l’usager francilien déshumanisé et capable de laisser un assassinat ou un viol se dérouler sous ses yeux sans interrompre sa conversation téléphonique est pour le moins injuste. J’ai vu un jour une jeune femme se faire agresser verbalement de façon très violente par un dégénéré musculeux puant le shit et l’alcool. Certes, il y a eu un moment d’hésitation avant que trois personnes se lèvent pour demander au Tony Montana de pacotille de laisser en paix la demoiselle. L’intéressé s’est fendu d’un « tu cherches les embrouilles, cousin ? », mais a prudemment battu en retraite à la station suivante, en n’oubliant pas toutefois de couvrir d’injures sa victime et ses sauveurs dès qu’il eut posé un pied sur le quai. Un autre jour, un psychopathe en herbe, après avoir copieusement injurié une préposée SNCF derrière son guichet, a soudain décidé, pour une obscure raison formée dans les méandres de sa cervelle atrophiée, que le fait de coller une bonne droite dans la vitre de sécurité serait une conclusion tout à fait appropriée à sa courtoise intervention. Les gens se sont employés à rassurer la jeune femme traumatisée derrière son guichet, mais certains ont presque plaint l’abruti qui venait de se broyer les phalanges sur le verre feuilleté de deux centimètres d’épaisseur. Les Franciliens ne sont pas des monstres.
Le train s’emplit progressivement à mesure que l’on se rapproche de la gare du Nord. Il s’immobilise peu avant d’arriver à Sarcelles : on annonce un incendie à la voie 42, les équipes de pompiers sont en intervention. Les annonces contradictoires se succèdent. « En raison d’un départ de feu dû à un problème technique en gare du Nord, ce train ne circule plus jusqu’à nouvel ordre. » « En raison de la découverte d’un colis suspect en gare de Châtelet, le trafic sur la ligne D est ralenti. » « Votre train subit actuellement un ralentissement dû aux conditions de circulation. » En fait de ralentissement, nous sommes arrêtés en pleine voie depuis dix minutes. Nous avons miraculeusement eu le temps de larguer le paquet d’ados en gare de Gonesse. Le soleil inonde l’intérieur du wagon, et les voyageurs, pris d’une douce torpeur, comme le sous-préfet des Lettres de mon moulin, contemplent les herbes folles qui se balancent au gré d’une brise légère entre les rails et les canettes rouillées. On aperçoit un peu plus loin le grand pont sous lequel se dressait il y a peu encore un assemblage hétéroclite de cahutes et de baraques de fortune. Pendant quatre ans, un bidonville de mille personnes, délimité par une montagne d’ordures, s’est étalé en contrebas des rails, entre les micro-parcelles cultivées et l’ombre des premières tours de logement. Le bidonville a été progressivement évacué à partir de 2011, suscitant les protestations des associations de soutien aux Roms et des collectifs contre la xénophobie. Comme les associations de soutien aux Roms et les collectifs contre la xénophobie n’apportaient cependant pas d’autre solution au problème de l’enlèvement des ordures et des conditions d’hygiène déplorables du camp que leur compassion, l’expulsion a suivi son cours, et bien d’autres lui ont succédé depuis, le gouvernement socialiste n’étant pas plus tendre en la matière que le pouvoir sarkozyste envers ceux que l’immigration clandestine et l’espace Schengen ont rejetés sur les rives cafardeuses de la grande couronne.
Dans notre wagon immobile, les voyageurs secouent leur torpeur et s’animent quelque peu. Les langues se délient. Le grand africain hiératique se lance dans une harangue passionnée contre la SNCF : « Colis piégé ? Colis piégé ? Mais oui, bien sûr ! Tu oublies ton sandwich sur le quai et voilà : colis piégé ! Tu laisses traîner ton journal sur le siège ? Colis piégé ! » Je lui fais remarquer qu’il vaut mieux réagir cent fois quand on crie au feu plutôt que de laisser passer une fois qui pourrait être la bonne, mais il ne partage visiblement pas mon point de vue : « Moi, je ne fais plus confiance aux annonces de la SNCF ! Une fois, j’étais dans le train, je vois le chauffeur descendre et il part boire un café avec un collègue, et deux minutes après on nous annonce que le train est bloqué à cause d’un colis piégé, mais c’est juste le chauffeur qui était parti ! S’il n’avait pas envie de travailler, il fallait qu’il le dise plutôt que de dire “colis piégé !” Je ne crois plus la SNCF, ce sont des menteurs ! De toute façon, ici, ça bloque toujours pour nous à Sarcelles, quel que soit le problème. Un problème à Châtelet ? Ça bloque ici ! Un problème à Montparnasse ? Ça bloque à Sarcelles ! Un problème à Marseille ? Ça bloque ici ! Un problème à New-York ? Ça bloque à Sarcelles ! Tiens, je ferais mieux de prendre l’avion, dit-il en montrant le sillage blanc d’un avion de ligne qui traverse le ciel, au moins je serais sûr d’aller quelque part ! »
Si la vie des voyageurs est considérablement compliquée par le contexte « sécuritaire », celle de la police ferroviaire ne l’est pas moins. En gare du Nord, le dispositif est plus impressionnant que jamais. Les équipes de sécurité de la SNCF croisent les patrouilles de militaires, Famas au poing. Ce jour-là, une intervention massive des forces de l’ordre se déroule en « surface », dans la gare d’avant, aujourd’hui complétée en sous-sol par de hideuses galeries souterraines qui offrent au voyageur une plongée dans la glauquissime esthétique urbaine des années 1970-1980. On procède à des contrôles en série tandis que les soldats arpentent les quais, trois par trois. Je cherche à me renseigner auprès d’un agent SNCF. La lassitude perceptible dans sa voix indique que je suis loin d’être le premier à poser la question : « Un colis suspect. Vous inquiétez pas. On intervient. » J’insiste : « Ça arrive souvent en ce moment, non ? » « Ben oui, tout le temps. C’est comme ça, on a un signalement, il faut qu’on vérifie. Bonne journée, monsieur. »
Entre les menaces djihadistes, les risques épidémiques et la racaille, l’anxiété fait partie du code génétique de l’usager des transports en commun. Et, pour ceux qui ont suffisamment d’ancienneté pour avoir connu la gare du Nord pendant les émeutes de 2005 ou celles de Villiers-le-Bel, l’anxiété s’est transformée en fatalisme. Devoir calculer son parcours pour éviter de se faire tamponner la tête par une bouteille de mousseux lancée à la volée lors d’une bataille rangée entre une vingtaine de guerriers du bitume fait partie du jeu. Heureusement, cela n’est pas si fréquent. Reste que, quand on est passé d’un quai sinistre, où un clochard s’égosillait sur l’air du cheval blanc qui s’appelait Stewball, au remake de Graine de violence en doudoune-casquette, les déclarations lénifiantes de tel ou tel ministre qui n’a pas dû voir un RER depuis les années 1980 produisent un sentiment d’irréalité plus dangereux pour la santé mentale que n’importe quelle annonce au colis suspect.
Même abstraction faite de la menace terroriste actuelle, la gare du Nord conserve une réputation déplorable. Andy Street, le directeur général de l’enseigne de grands magasins John Lewis, la qualifiait récemment de « trou le plus sordide d’Europe », en comparaison avec Saint-Pancras, à Londres, « gare moderne, tournée vers le futur ». Il faut préciser qu’avec 20 millions de voyageurs par an, la splendide gare néogothique londonienne, entièrement réaménagée à l’occasion des Jeux olympiques, fait pâle figure face à notre bonne vieille gare du Nord, premier nœud ferroviaire d’Europe pour le trafic. D’ici à la fin de l’année, près de 200 millions d’« usagers », nom donné au client pour célébrer les valeurs du « service public », auront traîné les pieds sur les quais souterrains ou fixé d’un air absent la faïence blanche des piliers de la gare de surface.
Perdu dans ce flot humain, l’usager moyen doit donc apprendre à vivre avec la menace terroriste, les risques d’Ebola, de grippe ou de bronchite, et avec la persistance têtue de ce que le jargon SNCF nomme pudiquement les « incivilités ». En la matière, les campagnes de prévention de la compagnie publique s’avèrent aussi inefficaces que risibles. L’une des plus fameuses diffusait des messages enregistrés par des enfants pour faire la leçon aux usagers : « Eh ! vous, les adultes ! Vous n’êtes pas au courant ? C’est interdit de traverser les voies ! et tous les zours ya des crands qui traversent les voies ! » Considérant que la grande majorité des individus traversant les voies chaque jour ne sont certainement pas des adultes et que la très grande majorité des voyageurs majeurs et responsables supportent chaque jour sans broncher les retards entraînés par ce genre de pratiques – qui se surajoutent à toutes celles évoquées plus haut –, il est étonnant que les voix crispantes de ces affreux bambins n’aient pas suscité de crise de démence collective dans la population pendulaire. Il me semble cependant que, durant la (courte) période où cet infantilisme moralisateur a résonné dans les haut-parleurs, les agents de la SNCF se sont faits plus rares sur les quais.
Le géographe Christophe Guilluy a donné une visibilité à la « France invisible » des petites et moyennes agglomérations ou des zones rurales enclavées, oubliée des politiques et des médias au profit de la banlieue, génératrice de fantasmes, de gros titres… et de votes. Certes, mais, en réalité, ils ne connaissent pas mieux la seconde que la première. La France qu’on rencontre entre 6 heures et 8 heures du matin et entre 17 heures et 20 heures dans le RER, qui aligne deux à trois heures de trajet par jour, est à des années-lumière des abstractions politiques généreuses du multiculturalisme, tout autant que des fantasmes remigratoires. Le Tout-Paris s’était offusqué des propos de Richard Millet sur le nombre de Blancs dans le RER à Châtelet-les-Halles, mais il y a bien longtemps que le Tout-Paris n’a pas dépassé Châtelet-les-Halles – à supposer qu’il y ait récemment mis les pieds.
Cette France qui vit dans la banlieue profonde et travaille à Paris compte son lot de petits Blancs usés, comme ce jeune cadre que j’ai vu pendant des années apostropher chaque jour le siège vide en face de lui puis saluer de manière tout à fait naturelle ses collègues montés à la station suivante. Elle compte aussi ses immigrés à l’ancienne aussi excédés que leurs concitoyens « de souche », comme ce type à bout qui répond à la petite racaille qui le traite de raciste après s’être fait refuser une cigarette : « Moi aussi je suis arabe, pauvre con ! » Cette France-là, coincée dans son RER ou son train de banlieue, reste désespérément sourde aux généreux appels au vivre-ensemble, car le vivre-ensemble qu’elle expérimente chaque jour ressemble parfois à la guerre de tous contre tous. Passé la zone 2, le Paris éclairé et progressiste, c’est fini. On entre sur les terres de l’électorat auquel il faut tout expliquer avec beaucoup de pédagogie car, voyez-vous, il est toujours un peu en retard. Comme le RER.[/access]
*Image : Soleil.