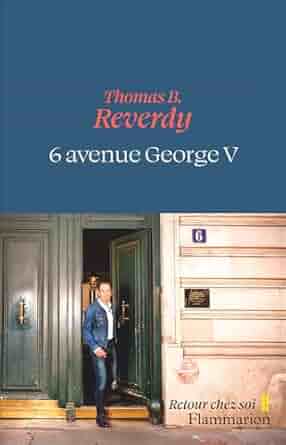Ressuscitée par l’ensemble musical Los Elementos et le Centre de musique baroque de Versailles, une messe de requiem composée pour les obsèques du roi d’Espagne, Luis 1er de Borbon y Saboya, réapparait trois siècles après sa mort.
Son règne de sept mois et demi fut l’un des plus brefs de l’histoire européenne. Et assurément le plus fugitif de l’histoire de l’Espagne.
Luis de Borbon y Saboya, Louis de Bourbon et de Savoie, roi d’Espagne, roi de Castille, de Léon, d’Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Cordoue, de Cerdagne, de Corse, de Murcie, de Jaen, d’Algarve, d’Algésire, de Gibraltar, des Îles Canaries, des Indes Orientales et Occidentales, de l’Inde et du continent océanien, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan… monta sur le trône de Madrid le 15 janvier 1724 pour mourir de la variole le 31 août de la même année. Il n’avait que 17 ans. Il avait été prénommé Louis, comme son arrière-grand-père, Louis XIV, roi de France et de Navarre. Et il avait Louis XV comme cousin germain. Doublement cousin germain même, puisque son père, Philippe V, le premier des Bourbons à régner sur l’Espagne, était le frère cadet du duc de Bourgogne, père de Louis XV, et sa mère, la reine Marie-Louise de Savoie, la propre sœur de la duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie.
Comme il devait accéder au trône des rois catholiques, en Espagne on l’appela Luis, Luis Primero, qui fut donc durant 229 jours le deuxième des rois espagnols de la maison de Bourbon, le premier à être né à Madrid. Adolescent, il consuma en fêtes un règne forcément insignifiant malgré les intrigues terribles des cours de France et d’Espagne. On lui avait fait épouser en 1721 une sienne cousine, la princesse Louise-Élisabeth d’Orléans, dite Mademoiselle de Montpensier, sacrifiée à la raison d’Etat, enfant du régent de France, Philippe, duc d’Orléans, et d’une fille légitimée de Louis XIV, sa cousine. Une enfant mariée à 12 ans et qui sera reine à 14 ans. Le duc de Saint-Simon, le mémorialiste, qui l’avait accompagnée à Madrid en tant qu’ambassadeur extraordinaire, voulant prendre congé d’elle et lui demandant ses ordres pour ses parents et pour sa grand-mère, Madame, l’épistolière princesse Palatine, ne se vit gratifié pour toute réponse que de trois rots retentissants. Avec sa sœur, Mademoiselle de Beaujolais, qui devait épouser l’infant Carlos, demi-frère de Luis (plus tard lui aussi roi d’Espagne et le plus brillant), la jeune reine sera renvoyée en France sans tambours ni trompettes quelque temps après la mort de son époux. Et Philippe V, qui avait abdiqué en faveur de l’aîné de ses fils après 24 années d’un règne qui lui pesait, dût se résigner à remonter sur le trône où il demeura jusqu’à sa mort en 1746.
A lire aussi: Notre ami Pierrot
En Espagne, on ne se souvient de Luis 1er que pour la brièveté de son règne : « el reino relampago », le règne éclair. Comme son cousin français, il fut surnommé le Bien Aimé, « el Bien Amado ». Mais à l’inverse de Louis XV, Luis 1er n’aura décidemment pas le temps de se faire détester de ses sujets.
En France, en dehors des historiens et des familiers des cours, plus personne ne connaît aujourd’hui son existence. Et c’est bien ce qui fait de ce concert donné ce 28 janvier au château de Versailles, trois siècles et un an après son avènement, une chose tout à fait extraordinaire : au sein même de la Chapelle des rois de France, on ressuscite, comme surgie des brumes d’un passé oublié, la Messe de Requiem écrite en toute hâte par le maître de la Chapelle des rois d’Espagne, José de Torres y Martinez Bravo (1670-1738). Ce requiem qui célébra en 1724 les obsèques de Don Luis, frêle adolescent inhumé dans le panthéon royal de l’Escurial.
Organiste de renom, compositeur de musique religieuse aussi bien que profane, théoricien, éditeur, José de Torres y Martinez Bavo compte dans l’histoire de la musique espagnole. Il avait été organiste de la Chapelle royale du temps de Charles II, le dernier des Habsbourg d’Espagne et grand-oncle de Philippe V, en avait été expulsé lors des bouleversements survenus avec le changement de dynastie… avant d’y revenir en tant que maître de Chapelle de ce grand amateur de musique que fut le premier Bourbon d’Espagne… et de conserver son poste jusqu’à sa mort.
Certes, la cour de France avait pris le deuil quand parvint à Versailles la nouvelle de la mort du roi d’Espagne. Selon l’usage, toute la noblesse défila en grand deuil devant les souverains et la Chapelle royale accueillit les célébrations saluant la mort d’un Bourbon régnant.
Mais jamais on n’y avait entendu ce Requiem composé pour Louis 1er d’Espagne et c’est là un évènement aussi savoureux que surprenant pour l’historien comme pour l’amateur de musique. En France, berceau des Robertiens, en France devenue République où l’on chassa tour à tour du pouvoir les deux lignées d’Artois et d’Orléans, on entendra un requiem composé pour un roi mort il y a trois siècles dans un pays, l’Espagne, où règnent encore des princes de la maison de Bourbon.
Requiem pour Louis 1er, roi d’Espagne
Avec les Pages du Centre de musique baroque de Versailles, le Chœur de l’Opéra royal et l’ensemble musical Los Elementos, sous la direction d’Alberto Miguelez Rouco.
Le 28 janvier 2025 à 20h. Chapelle royale du château de Versailles. 01 30 83 78 89 ou www.operaroyal-versailles.fr