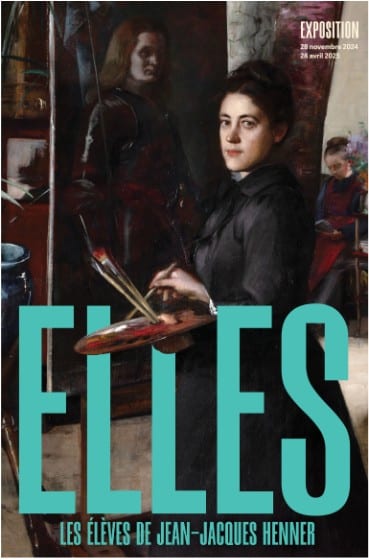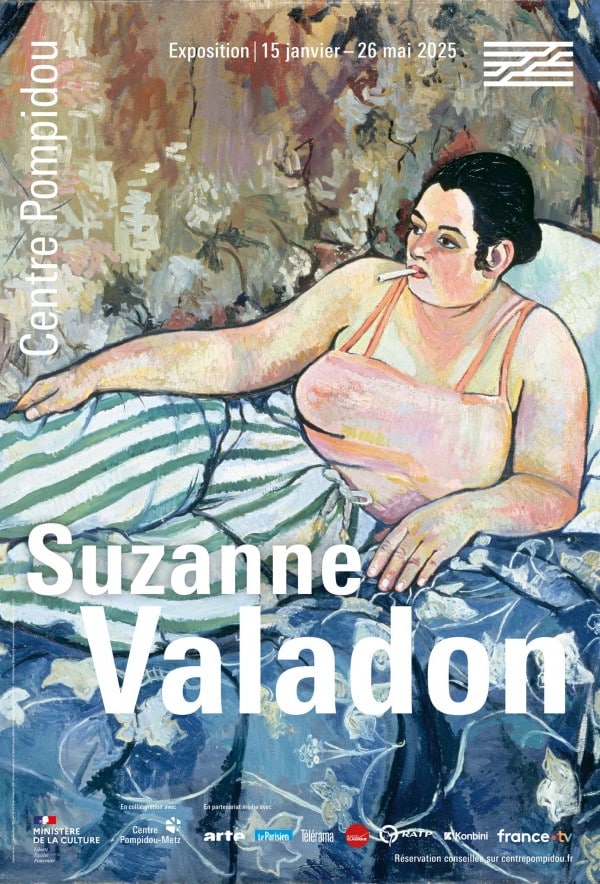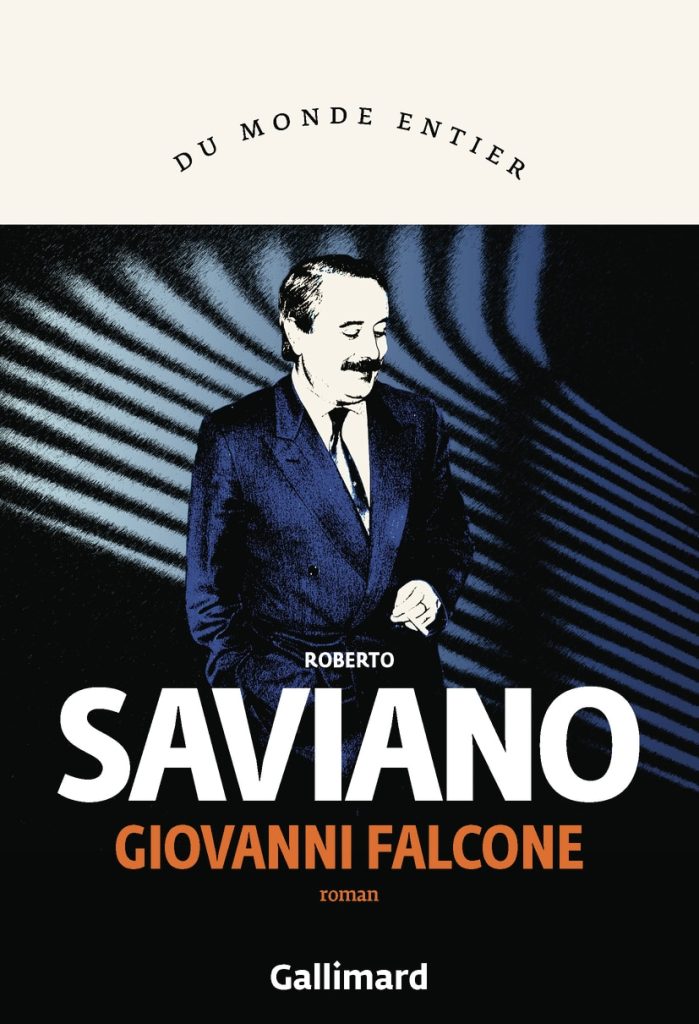Cette semaine, dans la presse, on ne parle plus que de bruits de bottes, de budgets militaires, d’armées professionnelles et d’armées de conscrits… Le monde se réarme
Après le spectaculaire lâchage de l’Ukraine par les États-Unis, l’Europe a retenti cette semaine d’une musique guerrière que beaucoup de pays avaient oubliée depuis 80 ans. Le président Macron a pris la tête de cette campagne laissant son Premier Ministre et son gouvernement dans une situation intérieure enchevêtrée et sans gloire.




La même semaine a vu des massacres en Syrie qui n’ont guère généré d’indignation, car peu de gens se préoccupent des Alaouites maintenant que Bachar a été chassé du pouvoir. Les optimistes espèrent que l’élégant Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammed al-Jolani) finira par abandonner ses oripeaux religieux. Il en était de même quand, revenus à Kaboul en août 2021 les Talibans ont laissé les Occidentaux espérer qu’ils avaient changé. On a vu ce qu’il en était et il y a toutes les chances qu’il en soit de même en Syrie.
Enfin, en Israël, le nouveau chef d’Etat-major, le général Eyal Zamir annonçait que 2025 serait une année de guerre contre le Hamas et l’Iran.
A lire aussi: Emmanuel Macron accusé de tirer profit de la guerre en Ukraine
Alors que le public français, indifférent jusque-là aux budgets militaires, découvre face aux menaces russes les failles de son armée, l’enquête publiée par Tsahal confirme sans fard ses échecs opérationnels et stratégiques le jour du 7-Octobre.
Armée bonsaï
La France a une armée bonsaï, dotée de tous les équipements sophistiqués mais en trop petite quantité, l’armée israélienne se reproche d’avoir avant le 7-Octobre misé sur la technologie au détriment de l’intelligence humaine.
Sur le plan financier, le budget militaire israélien avait diminué à moins de 5% du PIB en 2022, incluant une aide américaine annuelle d’environ 3,5 milliards de dollars, que l’administration Biden, si décriée aujourd’hui, avait augmentée à près de 9 milliards après octobre 2023. En 2025 ce budget sera de plus de 5,5% du PIB, soit d’environ 30 milliards d’euros. On reste loin des chiffres d’après la guerre du Kippour, quand les dépenses militaires représentaient jusqu’à 30% du PIB, ce qui avait déclenché l’inflation et la crise du début des années 80, ce que les Israéliens ont appelé la décennie perdue.
Le casse-tête de l’exemption militaire des ultra-orthodoxes en Israël
Pour la France, le budget militaire, rogné depuis les années 60, a atteint son étiage de 1,4% du PIB en 2015. Ni notre pays, ni les autres membres de l’Otan qui s’étaient engagés en 2014 auprès des Américains à augmenter les dépenses à plus de 2% du PIB ne l’ont fait. Même si le pourcentage a augmenté depuis la présidence Macron et doit continuer de le faire, il n’atteint pas encore les 2% et les retraites des militaires revalorisées dans le passé dans le but de stimuler les départs (il fallait une «armée agile» et éviter tout embonpoint) pèsent sur les disponibilités en équipements.
Avec 68 millions d’habitants, la France compte environ 200 000 militaires d’active et 40 000 volontaires en réserve opérationnelle qui effectuent qu’un service 15 jours en moyenne par an en encadrement.
Sept fois moins peuplé, Israël compte une armée de 170 000 soldats d’active avec un service de 36 mois chez les hommes. Mais il dispose de plus de 450 000 réservistes, souvent combattants, qui passent six semaines par an dans l’armée jusqu’à 40 ans au moins.
A lire aussi: Berlin, Mulhouse, Gaza, même combat
Si la France a depuis 1997 une armée professionnelle, Israël a une armée de conscrits, mais le service n’est pas obligatoire pour les Arabes israéliens et pour les ultra-orthodoxes, respectivement 21% et 14% de la population mais nettement plus parmi les jeunes adultes. Chaque année 60 000 jeunes israéliens non harédis effectuent leur service militaire. 13 000 ultra-orthodoxes atteignent aussi 18 ans, mais parmi eux, moins de 2000 ont été enrôlés par l’armée l’an dernier. La Cour Suprême a statué en juin 2024 qu’il n’existait pas de cadre juridique pour exempter les étudiants d’écoles religieuses, yeshivot et kollels, actuellement 150 000 dans le pays, un nombre qui croît chaque année d’environ 8%.
Menaces existentielles
L’effort militaire israélien avec des générations de jeunes engagés dans un service dur, long et dangereux est lié aux contraintes existentielles du pays. L’armée a forgé la mentalité des citoyens et la présence de soldats revenant de permission appartient au spectacle quotidien de la vie civile. L’admiration que l’armée rend l’échec du 7-Octobre d’autant plus incompréhensible.
Mais la conscription est aussi un facteur potentiel de fracture de la société israélienne. La plupart des dirigeants d’un monde ultra-orthodoxe en expansion numérique refusent que leurs jeunes prennent leur part de la défense du pays. Ils génèrent en retour une hostilité de plus en plus virulente et dans cette spirale désastreuse on n’entend pas de parole de sagesse qui porte et qui pourtant s’impose.
En France, la situation n’a rien de comparable, et l’armée n’a pas le rôle central qu’elle joue en Israël. Mais il existe des pans entiers de la population qui pour des raisons de colère sociale, de messianisme écologiste ou de répulsion religieuse rejettent les principes de patriotisme, de débat d’opinions et de laïcité à la base de notre contrat national et pour lesquels le bruit de bottes pourrait être un nouveau motif de révolte.
Évidemment, l’ennemi n’est pas le même, Poutine est loin pour les Français, qui ont du mal à envisager les Russes aux portes de Paris, tandis que pour les Israéliens, la menace de l’islamisme est on ne peut plus concrète. Mais il ne faut pas oublier que Poutine a fait aussi alliance avec des islamistes et que l’islamisme radical a aussi déclaré la guerre à la France.
Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix prépare la guerre. C’est en 1955 que mon professeur de latin nous avait fait écrire cette phrase en cours de 6e. Peut-être aurait-il recommencé ces jours-ci….