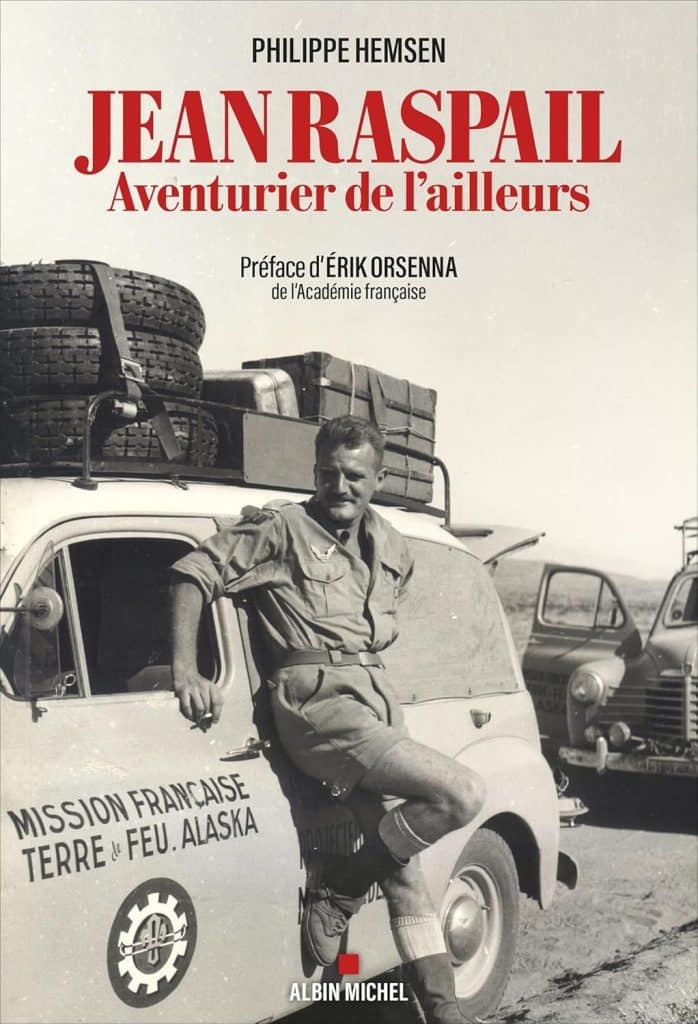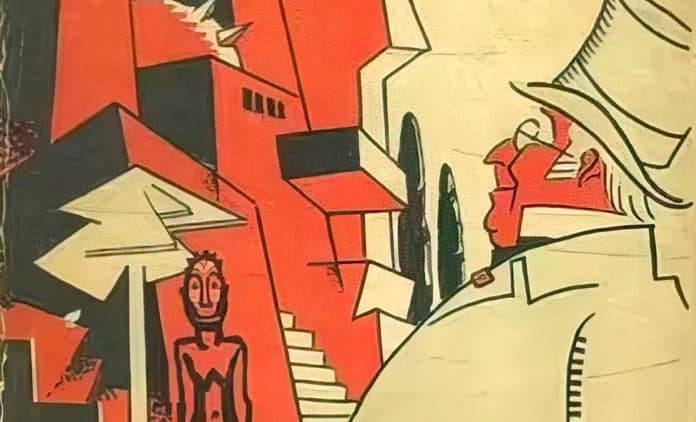Jusqu’au 12 octobre, le Musée Maillol présente plus de 350 photographies de Robert Doisneau (1912-1994), le chantre discret d’une banlieue disparue et d’un Paris bistrotier, dans l’exposition «Instants Donnés» …
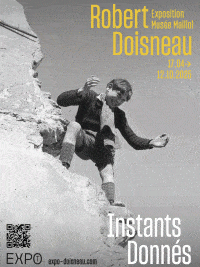
On connait par cœur sa rengaine, cet air d’accordéon qui sort exsangue d’un bistrot patibulaire, entre chien et loup, dans le noir et blanc de l’après-guerre, son filon des existences simples. Des gueules pas possibles accoudées au comptoir, l’écrin des jeunesses dévastées, champs de ruine et épidémie de coqueluche, baraquements de fortune et TSF en berne ; c’était le temps où la misère et l’ouvriérisme militant faisaient gonfler le nombre d’adhérents dans les cellules de quartier, toute la lyre, le chromo célinien, le Front Pop’ et les grèves, les congés payés et l’île Seguin, apéritif vinique et siphons, lutte des classes et petites gens qui peinent à joindre les deux bouts comme dans un livre d’Henri Calet. Cette fois-ci, le photographe humaniste ne nous aura pas ! Promis. Juré. On tiendra bon. C’est trop facile de jouer sur la corde des sentiments d’une France sépia.
Plus de 350 photographies
Le style émotif, c’était bon pour les générations passées, celles de nos grands-parents qui crurent au miracle économique et à l’espoir d’un monde nouveau après la Débâcle. Tino à la radio et l’Huma à la criée, c’est fini ! Nous, rejetons des mondialisations malheureuses, surnuméraires des eighties, on ne nous reprendra plus dans ce grand catalogue des illusions. Nous sommes las des images frelatées. Alors, on se rend au Musée Maillol avec l’envie d’en découdre. Les statues girondes n’apaiseront pas notre courroux contre cette falsification d’identité. La banlieue, elle ne court plus depuis bientôt cinquante ans, elle s’enlise. Et Paris, cette vieille ganache a beau ripoliner son joli minois, elle ne séduit plus que les tour-operators.


A lire aussi: Les dessins joailliers, trésor caché du Petit Palais
Mais on craque, une fois de plus. Car on est faible et nostalgique et que Doisneau vise toujours juste. Il y a d’abord ses appareils de labeur sous verre, son Rolleiflex et son Leica M3. Et, au mur, plus de 350 photographies, infime fragment d’une collection qui comprend 450 000 images. Tout notre décor mental décline alors sa frise chronologique. Les clichés dansent devant nos yeux. On retrouve nos marques, nos bornes temporelles. Les écrivains de caractère, les peintres et les sculpteurs qui furent les voisins de palier de Doisneau avant d’entrer dans les livres d’Histoire de l’Art, les forts des Halles, les rupins en bamboche et les gamins des rues. C’est con mais notre France des toilettes à l’étage et des coups de grisou demeure notre inébranlable socle mémoriel. Tiens-là, on reconnaît Bob Giraud pensif, Blondin barbu, Jeanne Moreau, Sabine Azéma, Roger Vailland et Maurice Baquet, le copain violoncelliste qu’il rejoignit à New-York pour une série loufoque et enneigée. Comme le professait le Pape François, Doisneau a fait des périphéries son grand œuvre. L’exposition se déploie sur deux étages, elle commence au rez-de-chaussée, puis on grimpe au 2ème voir comment par le plus grand des hasards en traversant à pied les Tuileries pour un rendez-vous professionnel, Doisneau assista à l’installation des statues de Maillol sous la supervision de Dina Vierny et la bénédiction de Malraux, puis on termine par le 1er. Les montagnes russes, quoi. On suit la vie de l’artiste, son regard sur l’enfance, son embauche chez Renault, son licenciement, ses piges alimentaires qui durèrent des années notamment pour la publicité, son intrusion dans les mondanités chez Vogue, puis, peu à peu, le succès par les livres, Cavanna et Pennac en doublette, et la consécration d’une empreinte majeure reconnue par ses pairs et le public.
Émotion
Tout ça, avouons-le, ce qui est rafraîchissant à notre époque des égos boursouflés, dans une forme de sincérité, loin de la fausse modestie des médiocres. Qu’on le veuille ou non, Doisneau a été l’artisan de notre imaginaire. De Simca aux mineurs de fond, de la chenille du Comte et de la Comtesse de Beaumont à « La monnaie des commissions » (1953) où un écolier en blouse rapporte un pain aussi grand que lui – et comment rester de marbre devant « Les tabliers de Rivoli », des petits se tiennent la main en 1978 en barrant la circulation. Je vous donne ma préférée, elle est intitulée « Timide à lunettes » et date de 1956 : un garçonnet peu assuré en culottes courtes tient son sac d’école alors qu’autour de lui ça chahute et ça crie, cette tendresse-là nous émeut aux larmes.
16,5 € 59-61 rue de Grenelle, Paris 7e