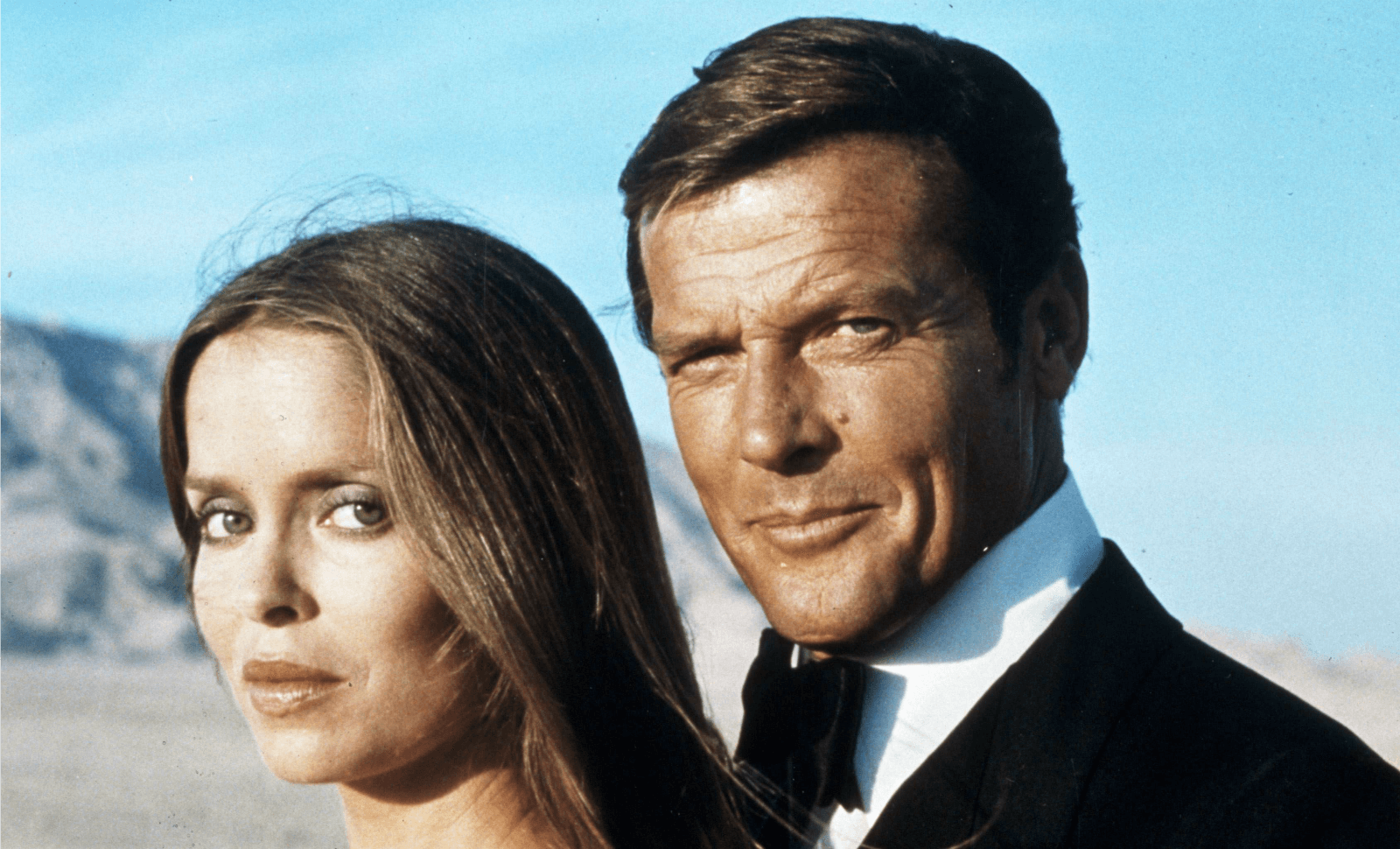Rika Zaraï, la chanteuse franco-israélienne, est décédée le 23 décembre. Courageuse, joyeuse, curieuse de tout et toujours ouverte au dialogue, elle a fait de son salon la deuxième ambassade d’Israël en France.
Elle m’avait accueilli avec un immense sourire, au pied du grand escalier de sa somptueuse demeure villa Montmorency. J’avais vingt-deux ans. Savait-elle que j’avais été un bad-boy des milieux nationalistes ? Peut-être. Je suis sûr qu’elle n’en avait cure : j’étais invité par sa fille pour une boum, j’étais bien élevé – je venais de me fendre d’un baise-main – et ça lui suffisait. Et puis elle préférait les combatifs que les mous. La deuxième fois que nous nous sommes vus, nous avons sympathisé. Un an plus tôt je combattais à Beyrouth un ennemi qu’elle avait affronté dix ans avant moi. Ça nous a rapprochés. Rika posait plein de questions, toujours. Elle était curieuse de tout, et écoutait avec une grande attention. Dialoguer, permettre à des opinions contraires de s’affronter en toute sérénité, la remplissait de satisfaction. Durant les derniers temps de sa vie, c’était une auditrice attentive de Zemmour. Organiser des rencontres, des débats, avait été au cœur de sa vie : le salon de Rika était le discret lieu de rendez-vous improbables entre diplomates du Moyen-Orient, d’Israël et d’Europe. C’était la deuxième ambassade d’Israël en France. On y croisait Shimon Peres, bien sûr, mais aussi, plus tard, les conseillers d’Ariel Sharon venus rencontrer des gens qu’ils étaient censés n’avoir jamais vus.
Rika détestait voir la France se rabaisser. Elle en avait une grande idée.
Déjà, à mon mariage, elle avait voulu que je fasse venir Robert Hersant. J’avais présenté Rika à mon patron, qui l’avait très civilement complimentée sur sa voix, et elle lui avait présenté le Grand Rabbin Kaplan qui était là, comme par hasard, et l’ambassadeur d’Israël, Mordechaï Gazit. Je les ai laissés tous les quatre amorcer une conversation pas évidente, au moment où l’orchestre entamait à grand renfort de cymbales un classique populaire bavarois pour accompagner la colossale choucroute que l’on commençait à servir. C’était vaguement surréaliste. Il fallait l’oser. La musique, ce jour-là, était-elle adressée à Robert Hersant dont elle savait parfaitement qu’il avait eu, dans sa jeunesse, des sympathies pour le national-socialisme ? On était plus près de « Papy fait de la résistance » – elle aimait beaucoup rigoler – que de la culpabilisation mémorielle. Rika, d’ailleurs, détestait voir la France se rabaisser. Elle en avait une grande idée. Elle voulait réconcilier l’histoire, enterrer les passifs, pour le plus grand profit de ses deux passions, Israël et la France. C’était, en dehors de la chanson, le grand plaisir de cette discrète diplomate.
L’amour de la France
Car Rika, la « sabra », aimait la France passionnément et lui vouait une gratitude sincère pour le succès et la prospérité qu’elle lui avait donnés. La France, d’ailleurs, elle l’avait épousée. Par son mari d’abord, un Ch’ti pur jus, issu d’une historique famille d’accordéonistes, qui avait, excusez du peu, été le batteur de Jacques Brel. Pour élever sa fille Yaêl, elle avait choisi Louisette, une pied-noir de Saïda, inconsolable de la perte de son fiancé légionnaire, tué par les fellaghas. Par sa carrière où, adoptée par Charles Aznavour pour passer en première partie de ses spectacles, elle avait rapidement conquis un public populaire par sa voix juste et son accent particulier, bien adapté à distiller la bonne humeur. Sa chanson était sans prétention, comme elle. Elle était destinée à procurer de la joie, à donner du courage. Au temps de sa grande popularité, de « Sans chemise sans pantalon », elle a été le visage joyeux et dynamique de son pays d’origine, lui octroyant certainement des points de sympathie dans le public français.
Rika était une femme d’action, pas une pleureuse. Un accident de voiture l’avait bloquée dans une gangue de plâtre pendant un an, elle en était ressortie avec une volonté décuplée. Je l’ai vue pourtant plus d’une fois s’accrocher à la rampe de son grand escalier, quand des ondes de douleur la paralysaient d’un coup. Les chimies médicales qu’on lui proposait, endormant l’énergie en même temps que la souffrance, elle n’en voulait plus. De là son intérêt pour la médecine douce et les vertus des plantes. Et très vite, elle a eu le désir de faire partager aux plus grand nombre le bénéfice de son herboristerie personnelle, dans la droite ligne d’un Mességué. J’en avais des placards pleins. On l’a moquée, elle n’en avait cure. Il lui en fallait plus pour l’atteindre.
Côté courage, Rika avait été à bonne école, auprès de parents d’une solidité à toute épreuve. Lui, ingénieur-électricien venu à pied de Crimée dans les années 20, elle infirmière de Varsovie ayant tout quitté pour participer à la réalisation du rêve de Théodore Herzl : établir une vraie nation sur la terre ancestrale des juifs, Israël. Cette race de pionniers était opiniâtre, tenace et combative. Frouma et Eliezer vivaient dans un appartement tout blanc et tout simple, éclaboussé de lumière, de la vieille ville de Jérusalem. Ils ne vénéraient pas le veau d’or et n’avaient de respect que pour les valeurs qui font les fortes nations. Ils ont dû accueillir là-haut leur fille, enfin débarrassée de ses terribles douleurs, à bras ouverts. Et je suis sûr qu’elle a chanté pour eux. Elle ne pouvait pas s’en empêcher ! Au revoir, Rika.