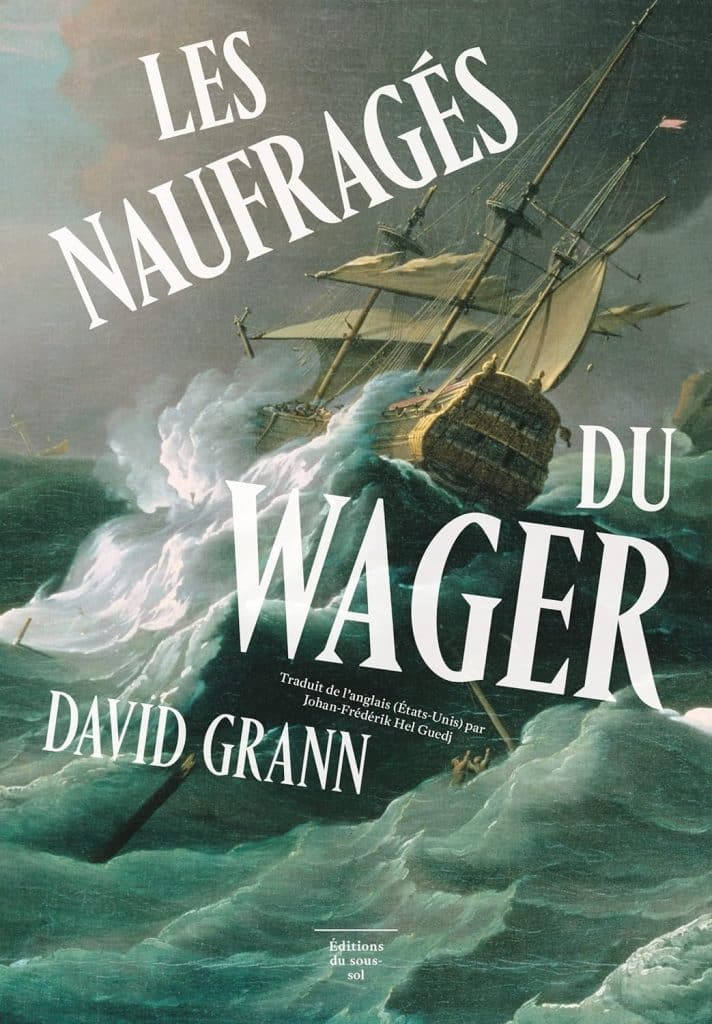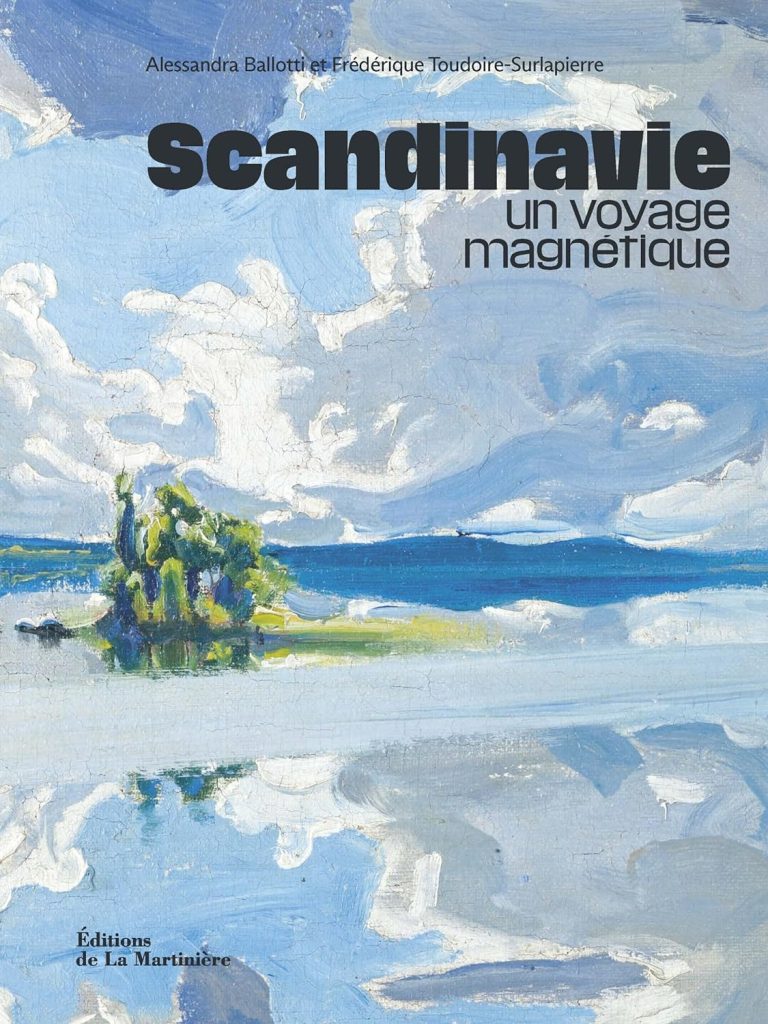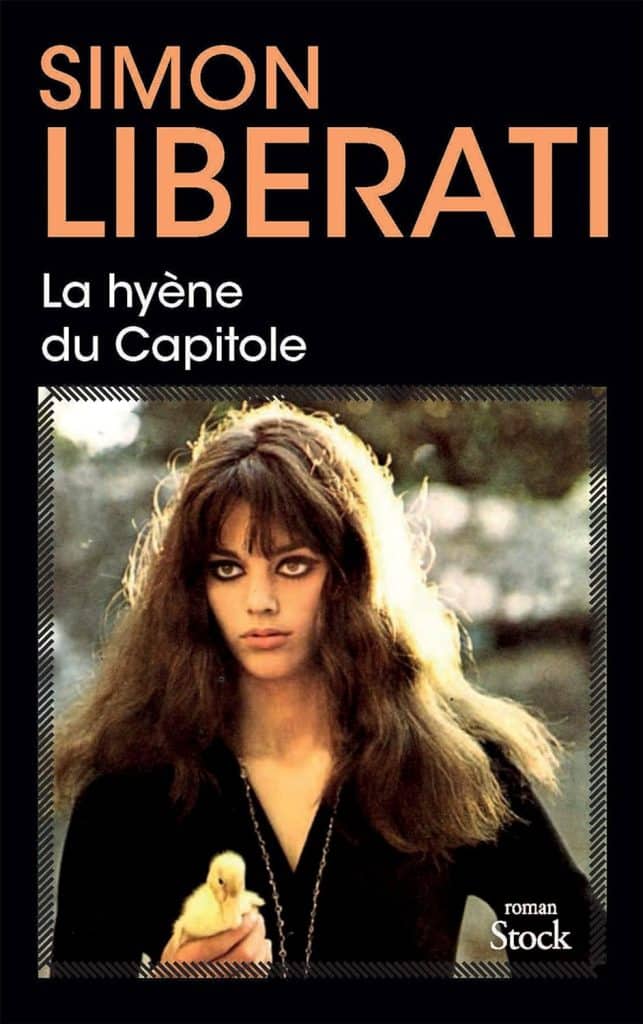Frédéric Simonin est l’un des derniers chefs-patrons de Paris, un vrai Parigot-tête de veau qui, avant de faire ses classes auprès de Joël Robuchon, a connu l’école de la rue, en banlieue. Aussi attentif envers son personnel qu’il l’est à l’origine de ses produits, c’est en poète qu’il décline les terroirs de France.
Les Jeux olympiques attendus par tous comme le Messie auront au moins eu le mérite de nous révéler le vide intergalactique qui habite le cerveau de nos dirigeants et l’idée au fond très pessimiste qu’ils se font de notre pays : comme si, pour exister, Paris avait besoin de ces bacchanales païennes vues et revues à satiété. Outre que tout le monde a eu, ou aura, un jour, les JO (d’où le côté vulgaire de la chose), rappelons à nos Machiavel de pacotille que Paris rayonnait autrefois, telle une étoile transformant sa propre substance en lumière. Quelle était donc la substance de Paris ? C’était une ville vivante et amusante où le petit peuple côtoyait la bourgeoisie et l’aristocratie, parfois au sein d’un même immeuble (ce que raconte très bien Hemingway dans son plus beau livre : Paris est une fête). Les petits commerces à la façade élégante pullulaient dans tous les quartiers, ainsi que les bals musette, les foires au jambon et les matchs de boxe… Les plus grands peintres et les meilleurs écrivains y avaient élu domicile, jouissant de cette liberté de créer et d’aimer qui n’existait nulle part ailleurs. Dans Le Monde d’hier, Stefan Zweig note ainsi sa stupéfaction lorsqu’il voit qu’ici des femmes blanches sortent avec des militaires noirs américains, chose inimaginable dans la Vienne et le Berlin des années 1930 !
Le plus comique dans cette affaire est que tous les Parisiens qui le peuvent ont d’ores et déjà décidé de fuir, du 24 juillet au 11 août, laissant sous les yeux des caméras du monde un village Potemkine vidé de ses habitants… Belle publicité.

On aurait très bien pu à la place célébrer l’invention du restaurant ! Celui-ci, en effet, fut créé à Paris, en 1765, rue des Poulies, près du Louvre, par un certain Boulanger, qui proposait des bouillons de poule et autres petits plats destinés à restaurer (requinquer) les passants. Avant la Révolution, on en comptait déjà une centaine. 1 000 en 1825. Plus de 2 000 en 1834. Sous Napoléon III, sur un million de Parisiens, 200 000 allaient y manger tous les jours. En 1903, on recense 2 000 cafés et brasseries, 1 500 restaurants et 12 000 marchands de vin où l’on peut casser la croûte (la consommation est alors d’un litre de vin par jour et par personne !) : autant de lieux de rencontre conçus pour supporter la tension et les cruautés de la vie.
Dans le fil de cette histoire, nous aimerions ici rendre hommage à l’un des derniers chefs-patrons de Paris, un vrai Parigot-tête de veau au grand cœur dont le restaurant (situé dans le quartier des Ternes) s’inscrit dans cette tradition sans laquelle nous ne serions plus que des zombies. Au début des années 2000, Frédéric Simonin fut, aux côtés de son mentor Joël Robuchon, l’un des premiers chefs à célébrer le terroir oublié de Paris, avec ses maraîchers d’Île-de-France, ses champignonnières et ses recettes traditionnelles comme les pommes Pont-Neuf (ancêtres de la frite), le bœuf miroton (connu depuis le xviie siècle), le homard Thermidor, le potage au cresson, les petits pois à la parisienne, la tarte Bourdaloue et le fontainebleau aux cerises aigres-douces de Montmorency…
A lire aussi, du même auteur: Chasseurs sachant chasser
Né en 1975, Frédéric Simonin aurait pu très mal tourner : « J’ai passé mon enfance à Aubervilliers. Mon père militaire était toujours absent et ma mère tenait des bars de nuit : j’ai ainsi côtoyé des voyous, des maquereaux et des gangsters… J’étais en échec scolaire, très perturbé, un enfant débordant d’énergie dans un corps d’homme. À 13 ans, mes parents m’ont mis dans un internat militaire à La Roche-Guyon où j’ai découvert la rigueur et la camaraderie avec d’autres enfants de militaires, aussi paumés que moi. Mon rêve, c’était d’intégrer la Légion étrangère qui est l’élite de l’armée. Avec le recul, je pense que la disparition du service militaire a été une catastrophe sociale pour la France, car c’était une machine à intégrer. Deux ans après, j’ai commencé mon apprentissage en cuisine dans un joli restaurant situé au bord de la Seine et la première chose que j’ai faite a été d’envoyer mon plateau dans la gueule d’un client qui m’avait manqué de respect… »
Envoyé à Saint-Brieuc, en Bretagne, Frédéric tombe sur un chef bienveillant, Roland Pariset, qui va prendre le temps de le former et de lui apprendre à canaliser son énergie, un nouveau père, un vrai Jean Valjean !
De retour à Paris, il prend le bottin et écrit des lettres de candidature à tous les grands restaurants qui le font rêver : « À l’époque, on écrivait à la main et on recevait des réponses somptueuses avec le tampon de l’établissement ! C’était émouvant. Aujourd’hui, on communique sur Instagram. »
Ledoyen, Taillevent, l’hôtel Meurice, le George V, la Table de Joël Robuchon… Pendant des années, Simonin apprend le métier à la dure, comme un soldat, en se frottant aux plus grands chefs. En 2006, il gagne deux étoiles Michelin au service de l’ancien séminariste qui voulait devenir prêtre, Joël Robuchon, puis devient Meilleur Ouvrier de France, un concours qu’il remporte brillamment, mais qui le laisse sur le carreau : « J’en ai pleuré. Et après ? me suis-je dit, ça ne change rien de ce que je suis… On est ici de passage. »


À la tête de son propre restaurant depuis 2010, Simonin s’efforce d’être bon et juste avec son personnel et cela se sent : « Je leur apprends à être en éveil et à utiliser tous leurs sens. Je veux qu’ils soient autonomes et capables de réaliser un plat de A à Z : quand on le goûte, on sent qu’il y a une unité, un geste, une énergie. »
Très technique, sa cuisine paraît fluide et naturelle et privilégie des produits d’exception comme la rare truffe du Périgord Louis Pradel, qui embaume sa poitrine fondante de cochon au jus de civet…
Tous ses plats expriment un imaginaire poétique qui nous fait voyager, à l’image de ses exquises ravioles de foie gras servies dans un consommé de crevettes grises parfumé au gingembre. « Aujourd’hui, la concurrence est rude : il y a des tas de bons restaurants dans le monde qui ont plus de moyens que nous, plus de personnel, plus de design, moins de taxes… Nous, nous devons survivre ! » Alors, Monsieur Macron, les JO, c’est bien, mais l’avenir de notre gastronomie, c’est mieux !
Frédéric Simonin Restaurant
Menu déjeuner à 55 euros.
25, rue Bayen, 75017 Paris
01 45 74 74 74
www.fredericsimonin.com