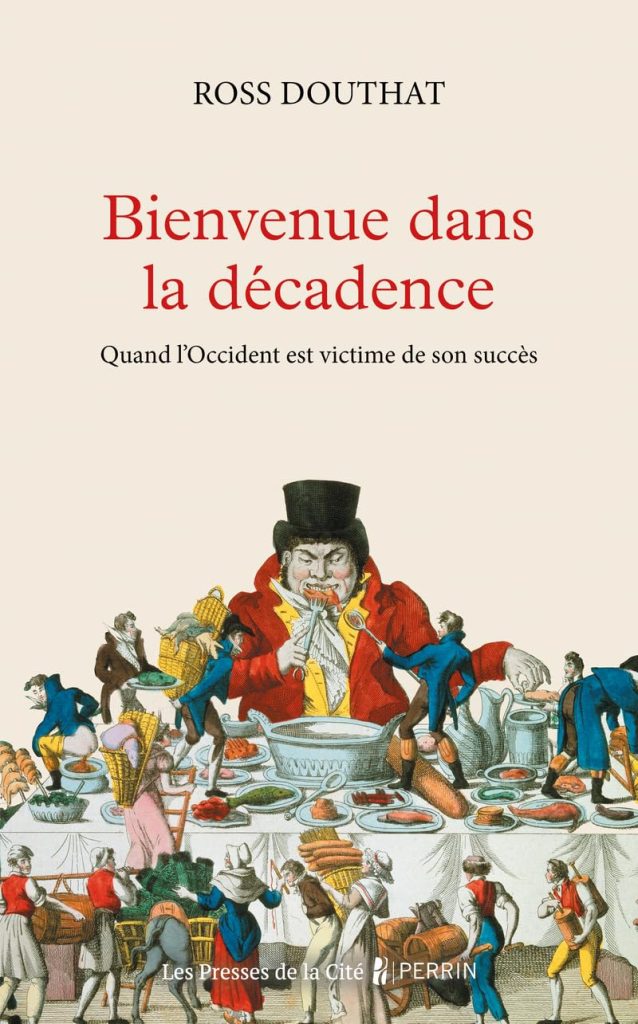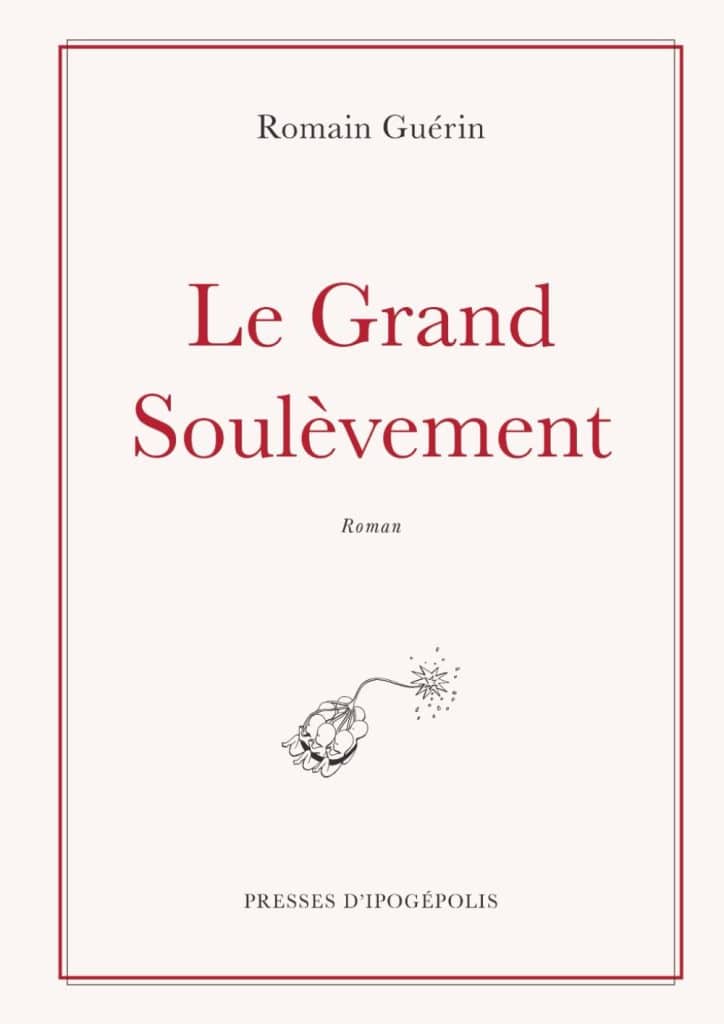La campagne présidentielle américaine prend un nouveau tournant. Le président sortant, 81 ans, a annoncé hier qu’il se retirait finalement de la course. Pourvu qu’il s’en souvienne, en se réveillant ce matin… Kamala Harris est favorite pour le remplacer, mais face à Donald Trump la lutte ne sera pas aisée.
Joe Biden aura finalement renoncé à l’ultime bataille. À 82 ans bien sonnés, le natif de Scranton s’est senti trop âgé pour continuer. Diminué et fragilisé, celui qui fut sénateur du Delaware de 1973 à 2009 a fini par admettre qu’il n’avait plus les ressources intérieures suffisantes pour affronter un Donald Trump héroïsé après avoir survécu sous les yeux du monde à une tentative d’assassinat par un post-adolescent complexé comme en produisent à la chaîne les États-Unis d’Amérique.
Sleepy Joe était bien plus que ça
« Je pense qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je me retire », a ainsi posté dans une missive solennelle le second président d’origine irlandaise de l’histoire de l’Amérique. Dans ce bref courrier explicatif adressé aux citoyens américains, Joe Biden dresse le bilan de son action, vantant notamment sa politique économique et infrastructurelle, ainsi que l’inflation reduction act qui fut un rude coup porté à l’Union européenne. Une politique extrêmement protectionniste et pas si éloignée de celle qu’avait en son temps menée Donald Trump. Nous ferions d’ailleurs peut-être bien de nous en inspirer partiellement, mais c’est une autre histoire. L’essentiel est au fond ailleurs, dans cet aveu formulé par Joe Biden qui admet sous la contrainte ne plus être un atout pour son camp et comprendre en creux qu’il ne peut plus l’emporter.
De cet animal politique dépeint ces derniers mois en marionnette, peu de choses sont sues en France. Le parcours politique long et brillant de Joe Biden cache pourtant une vie parsemée de drames terribles qui ont en leur temps durablement marqué l’opinion publique. Joe Biden a notamment perdu sa première épouse Neilia et sa fille Naomi en décembre 1972 lors de sa première campagne sénatoriale, dans un épouvantable accident de la route. Ses fils Beau et Hunter ont miraculeusement survécu, traumatisés à vie.
A lire aussi, Dominique Labarrière: Trump: petit cours de journalisme politiquement correct
En 2015, la mort a frappé de nouveau le clan Biden. Son fils Beau est décédé des suites d’un cancer du cerveau à l’âge précoce de 46 ans. Militaire et procureur général du Delaware, Beau avait toutes les qualités pour faire de lui le successeur naturel de son père. Le deuil a profondément affecté l’actuel 46ème président des États-Unis qui a dû par la suite subir les frasques de son cadet Hunter. Écorché vif, ce dernier s’est fait remarquer dans la colonne des faits divers et les rubriques mondaines pour sa consommation de drogues ainsi que son appétit sexuel.
Face à ces épreuves, Joe Biden a toujours su faire preuve de résilience. Politicien rusé et fin connaisseur des arcanes de Washington, Joe Biden était un expert de la politique étrangère dépeint en « modéré » au sein du camp démocrate. Alors qu’il était apparu plutôt fringant lors de l’élection présidentielle de 2020 où il affronta Donald Trump, la baisse de ses capacités cognitives est devenue bien trop flagrante au cours des derniers mois. Ayant toujours été qualifié de gaffeur, Joe Biden était aussi combatif. Dernièrement, ce trait de caractère semblait s’effacer, dévoilant un vieillard en grandes difficultés face à la presse ou ses adversaires. À telle enseigne que des personnalités de premier plan l’ont appelé à renoncer, à l’image notamment de George Clooney dont la prise de position a fait grand bruit.
Le duel annoncé entre deux hommes d’âge mûr et deux anciens présidents n’était pas au goût de tous les Américains qui semblaient contraints de voter pour faire barrage plus que par adhésion. Ils ne l’auront finalement pas. Reste la question qui fâche : qui pour prendre le relais ?
Kamala Harris en recours naturel : oui, mais…
Joe Biden a relancé une campagne américaine qui semblait acquise aux Républicains. Dans un tweet, il a explicitement soutenu la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Impopulaire, cette femme métisse et plutôt jeune pour les standards locaux aura fort à faire pour obtenir le soutien du parti démocrate et plus généralement des électeurs démocrates. Elle n’est pas encore la candidate du parti qui se réunira lors d’une convention nationale dans un mois. Barack Obama a notamment exprimé ses réserves : « J’ai confiance dans le fait que les leaders de notre parti seront capables de trouver une solution pour qu’émerge une candidature exceptionnelle ». Voilà une première pierre lancée dans le jardin de Kamala Harris qui fait pourtant figure de candidate naturelle eu égard à sa fonction et au fait qu’elle soit légalement la seule à pouvoir utiliser les fonds collectés pour la campagne Biden.
A lire aussi, Lucien Rabouille: J.D. Vance: de la «white trash» à la White house?
Une donnée qui a son importance puisque le parti démocrate se retrouve désormais au coude à coude dans des États qui lui étaient à l’origine acquis sur le papier, tels que le Nouveau-Mexique ou la Virginie en sus des fameux « swing states ». Éviter la catastrophe sera extrêmement coûteux alors que de nombreuses grandes fortunes financent la campagne de Donald Trump, soutenu désormais par le « monde de la tech » dont vient son colistier J.D. Vance. Des personnalités richissimes et influentes comme Elon Musk ou Peter Thiel font ouvertement campagne pour The Donald, dont l’aura a pris la couleur pourpre de l’Empereur survivant.
Les démocrates semblent pourtant décidés à livrer bataille. En plus d’Obama, des pontes comme Nancy Pelosi, Chuck Schumer ou Hakeem Jeffries n’ont pas déclaré leur soutien explicite à Kamala Harris. Joe Manchin, influent sénateur de Virginie-Occidentale, s’est déclaré prêt à entrer dans la bataille. On pourrait imaginer que Gavin Newsom, dont l’ancienne compagne est actuellement en couple avec Donald Trump Jr, pourrait aussi nourrir quelques envies. Pete Buttigieg, sorte de version homosexuelle de J.D. Vance, avec lequel il partage les mêmes origines et la même formation, serait aussi un candidat crédible. Bref, la guerre n’est pas finie. Mais Donald Trump doit être conscient d’une chose : son meilleur ennemi n’est plus dans la course. La virulence extrême de sa déclaration en est d’ailleurs la meilleure preuve. Qualifiant Biden de traître dans un post enragé sur son média social personnel, il a tout de même dévoilé son inquiétude. De fait, la campagne républicaine va devoir entièrement se réorganiser pour affronter un nouvel adversaire qui risque d’être plus jeune et de trancher. En janvier dernier, la républicaine Nikki Haley avait déclaré que « le premier parti qui retirera(it) son candidat octogénaire sera(it) celui qui gagnerait l’élection »…