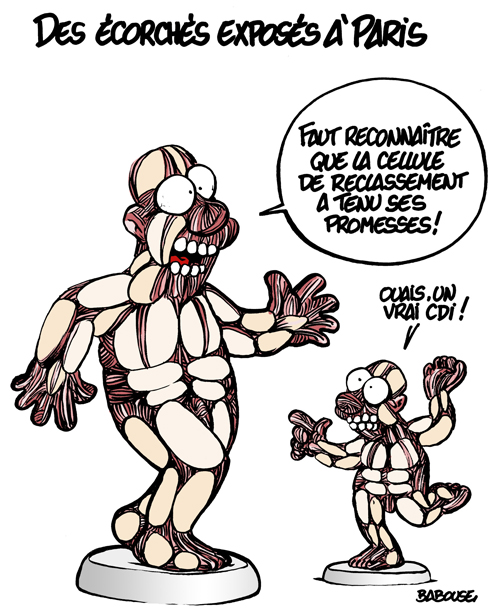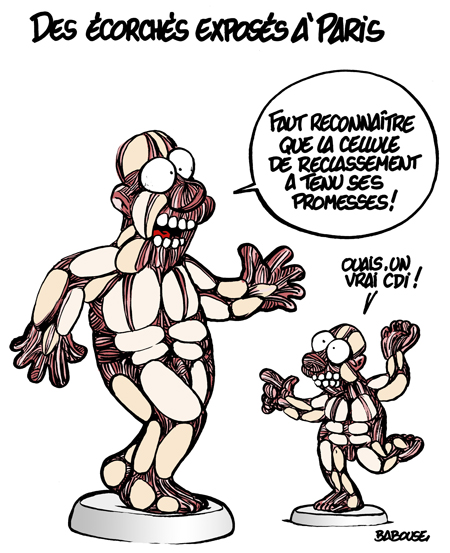Ramon Fernandez, « collabo » notoire, est mort dans la nuit du 2 au 3 août 1944. Une crise cardiaque mettait fin à son calvaire. Peu auparavant, il avait chuté de sa chaise, à la terrasse de Lipp, pour cause d’ivresse. Son fils, Dominique, avait alors quinze ans et admirait de Gaulle. Soixante années plus tard, Fernandez fils a l’âge d’être le père de Ramon. Écrivain de renom, esprit sensible et fin, il a remonté la piste des mémoires et des faits. Il n’a pas résolu l’énigme, mais il ose enfin parler longuement, savamment, tendrement mais sans rien dissimuler, de son « salaud » de père. Il s’est libéré d’un tabou et nous donne un livre fondamental, sur la condition humaine, par surcroît parisienne et française.
Le 1er décembre 1926, Ramon Fernandez, métis franco-mexicain, héritier du Sud, qui fabrique souvent des mâles mélancoliques et arrogants, épouse une jeune diplômée de l’École de Sèvres. Liliane Fernandez, née Chomette incarne le Nord, la rigueur, presque l’ascétisme. C’est un être de devoir, verrouillé. Deux enfants naissent, Irène et Dominique ! Le couple se sépare en 1936. Curieusement, c’est Ramon qui souffrira le plus. Il perd l’équilibre et ne se rétablira jamais. Tous ces détails sont fournis par le « journal » de Liliane, dans lequel a puisé Dominique pour conduire son enquête. Et c’est aussi l’une des forces de ce livre supérieurement construit, à la manière d’un grand projet abouti, que de confronter les péripéties de la vie quotidienne, souvent navrantes et cruelles, aux événements considérables. Un somptueux cadeau d’un fils à son père, une œuvre pour tous les orphelins de la littérature…
Avant de devenir une « ordure », Ramon fut un personnage honorable, c’est-à-dire de gauche et humaniste. Lauréat du prix Fémina en 1932, très en vue, recherché par les hommes intelligents, courtisé par les jolies femmes, il montrait une prestance de danseur de tango : cheveux plats gominés, regard de braise, corps puissant. Confident de Proust, il conversait avec Gide, interrompait Malraux, admirait Paulhan, fréquentait Mauriac et connaissait tout ce que le Paris des deux rives comptait de gens influents. Deux ou trois arrondissements parisiens formaient alors un nombril… grand comme le monde. Aujourd’hui, deux ou trois nombrils circonscrivent la rive gauche.
Essayiste, critique, Ramon Fernandez fut l’enfant chéri de la gauche chic jusqu’en décembre 1936, après qu’il eut paraphé un manifeste signé par Léon Daudet, Henri Béraud, Abel Bonnard, Drieu-la-Rochelle… Bref, il ruina sa bonne réputation. Et cela n’allait pas s’arranger. Il choisit le camp franquiste, seul capable à ses yeux d’épargner à l’Espagne « la désagrégation du pays sous l’influence anarchiste et communiste ». De son côté, Gide, désillusionné, venait de publier Retour d’URSS ; son aveu navré lui valut la riposte dont les staliniens détenaient le vocabulaire secret. Le parti communiste, le fascisme, la guerre d’Espagne et le goût des hommes forts : voilà les totems de cette génération perdante.
Issu du « Parti de la classe ouvrière », hostile à Maurice Thorez, voici que s’avance un costaud des Batignolles, une grosse carrure : Jacques Doriot ! Ramon, surdoué du genre littéraire, a trouvé son « homme » dans ce surdoué du genre tribunicien. Le beau Ramon éprouva des émotions fortes au spectacle de l’ambition, de la volonté, de la force. Quelque chose, enfin, desserrait l’étreinte de l’angoisse et de l’amertume. Les temps changeaient, il imagina peut-être qu’il pourrait changer avec eux. Le compte à rebours commençait. Il dura quatre ans ; quatre années d’occupation, de terreur, d’élégance et de mondanités, pendant lesquelles de brillants intellectuels consentirent à feindre de jouer un rôle dans ce prodigieux pays, la France, que l’Allemagne tenait au collet. Illusion tragique ! Paris, jolie môme incomprise, insolente comme Arletty, boudeuse comme Danielle Darrieux, voluptueuse comme Simone Simon, ne cherchait qu’à s’étourdir, à oublier.
Quelques figures inauguraient un jeu de rôle dont l’issue crépusculaire était prévue dans ses règles. Parmi elles, les deux Abel, Hermant et Bonnard. Abel B., sapé comme un mylord, ganté beurre frais, écrivait ses discours de ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse dans une langue parfumée. Ses mœurs autant que ses fréquentations lui valurent l’affectueux surnom de « gestapette »… Il fuira en Espagne. Abel H. ne manquait pas de dons. Hélas ! Malgré sa maîtrise parfaite de la grammaire, il confondit le vert de l’espoir avec le vert-de-gris.
Maurice Sachs, juif, converti au christianisme par opportunisme sincère, acoquiné aux pégriots, vécut d’expédients, de rapine et de mensonge. Styliste impeccable, compagnon idéal de la mondanité, homosexuel étincelant, infiltré des salons, trafiquant d’or, délateur au profit de la Gestapo, on perd sa trace dans une prison de Hambourg, en 1944. Commence sa légende : fut-il assassiné par ses co-détenus, enragés de ses infamies ? Eut-il la tempe percée par le Lüger d’un nazi, sur le bord d’une route ? Ou bien survécut-il ? Quelqu’un me l’a assuré, convaincu de l’avoir aperçu dans le hall d’un hôtel, en Suisse, au début de l’année 1946. Pauvre Maurice ! Mauvais garçon précieux, efféminé des crapuleries, cherchant l’infamie comme d’autres les diamants, extravagant symbole de Paris occupé, la ville des merveilles et des orpailleurs de caniveau. Déchiré entre la Grâce et l’ennui, affamé de chair, mystique, prince de l’écriture et des vilenies, ange noir exténué ; il ira au paradis pour avoir donné à ses contemporains une idée de la damnation. Paul Léautaud montera au ciel, lui aussi, pour avoir tant aimé les bêtes. Le vieux teigneux ignorait qu’il était en partie exaucé, lorsqu’il écrivait, le 7 mars 1945, dans son incomparable Journal : « Quelle pourra bien être la nouveauté de la prochaine guerre ? L’extermination du genre humain ? Hélas ! C’est une chimère. »
Le 24 mars 1944, Pierre Drieu-la-Rochelle, séducteur déclinant et variqueux, sujet au vertige mais frôlant les précipices, plaçait sa tête dans le four de sa cuisinière et, pour la seconde fois, ouvrait le gaz. Drôle d’époque. Fin des Temps. Drieu, tué par la politique avait vécu pour la littérature ; il lui confia son sort posthume.
Drieu, Fernandez, Sachs : notre époque, bourrelée de remords, surveillée par les moralisateurs, punie par les procureurs, observe avec dégoût leurs courses rapides sur la terre, affranchies de ses petits repères. Ils furent cependant à la mesure d’un temps déraisonnable. Doriot, déjà titulaire de la croix de guerre (1918), décoré de la croix de fer (1944), se voyait en gauleiter universel, en héritier naturel d’Adolph H. Sa griserie prit fin le 22 février 1945, sous la mitraille de deux avions mal identifiés.
« Nous n’avons pas su l’aimer », dira de Drieu son compagnon de débauche et d’esprit, son presque frère, Emmanuel Berl. Bien évidemment, Ramon et Pierre (qui ne s’appréciaient guère) jouèrent la comédie des apparences, mais au moins, ils ne lâchèrent pas la main du personnage inspiré par leur fantaisie, leur aveuglement, leur lâcheté, leur faiblesse. Ils payèrent un prix très élevé le droit de trouver place dans la comédie humaine. Ils ne se soucièrent pas outre mesure de paraître meilleurs qu’ils n’étaient. Gravement atteint de paradoxalite, maladie très commune en France, ils constatèrent avec une joie non dissimulée les progrès rapides de la maladie qui les menait de l’opprobre au tombeau. Mais enfin, ils opposèrent des valeurs strictement culturelles à la pression marchande qui s’exerçait sur le monde. Ils accomplirent leur destin, volontairement sourds aux crimes qui se commettaient hors de leur vue. Ce fut une sorte de « luxe » suprême et une malédiction. Après eux, viendrait légitimement l’ère du soupçon.
Ramon, Drieu, manquant de caractère, confièrent aux idéologies le soin de les distraire d’eux-mêmes, de les rassurer. Marguerite Duras a bien connu Fernandez. Pendant la guerre, elle vint habiter 5, rue Saint-Benoît (Paris, VIe), au-dessus de l’appartement où il vivait avec Betty, sa seconde épouse. Marguerite n’a jamais dissimulé l’affection, l’admiration que lui inspiraient Ramon. À Dominique, elle déclara : « Collaborateurs, les Fernandez. Et moi, deux ans après la guerre, membre du PCF. L’équivalence est absolue, définitive. C’est la même chose, la même pitié, le même appel au secours, la même débilité du jugement, la même superstition disons, qui consiste à croire à la solution politique du problème personnel. »
Que s’est-il passé ? Comment tout cela a-t-il commencé ? Se souvient-on encore de la case qu’occupaient les pions sur l’échiquier, avant le grand choc qui les jeta tous dans une mêlée confuse, où s’abolirent les lois qui réglaient leurs déplacements ? Ces dandies égarés, ces solitaires, ont versé dans l’esprit de système. C’est assez dire qu’ils cherchaient à se punir. Tous, fusillés, suicidés, exilés, bannis, nous abandonnèrent, avec, pour seul viatique et unique héritage, la difficulté d’être français.
Ramon
Price: 6,20 €
61 used & new available from 3,00 €