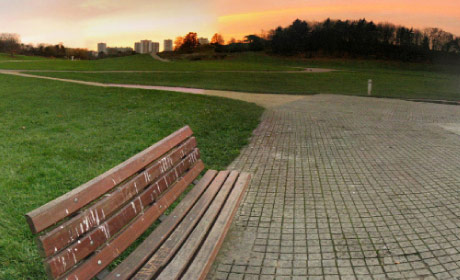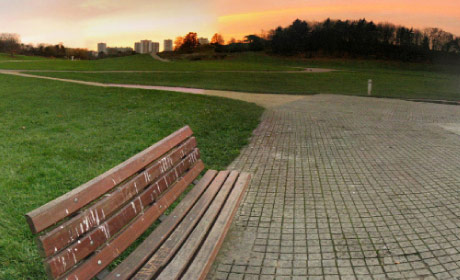Pierre-Louis Basse aime la gauche du monde d’avant, le football et l’histoire. Au point, parfois, de rendre ces trois passions consubstantielles, ce qui donne chez ce grand journaliste des livres d’écrivain, chose pas forcément évidente. Des livres d’écrivain, c’est-à-dire des livres qui ont toujours tendance à déborder leur sujet, comme dans son Séville 82[1. Séville 82, La Table ronde, Petite Vermillon.], où il raconte un des combats les plus tragiques du onze tricolore, quand la France perdit le « match du siècle » avec un héroïsme surhumain en demi-finale de la Coupe du monde, face à une équipe d’Allemagne d’une brutalité peu commune. De même, bien avant l’OPA sarkozyste, il avait donné un essai biographique sur Guy Môquet[2. Une Enfance fusillée, Stock.] qui était aussi une histoire de famille : sa mère, Esther, militante communiste, avait été chargée de récupérer les lettres et les planches sur lesquelles les fusillés de Chateaubriand avaient écrit leurs adieux.
[access capability= »lire_inedits »]Chroniqueur de la ligne 13[3. Ma ligne 13, Le Serpent à plumes.], celle qui l’emmène de Saint-Ouen aux locaux d’Europe 1, où il officie tous les week-ends à midi, il est un observateur lucide, généreux et aimablement désespéré de cette France que l’on défigure à grandes giclées de vitriol communautariste. Est-ce pour cela que, pour son premier roman, Comme un garçon, il se réfugie en 1979, l’année de ses 20 ans ? Ce lecteur de Nizan sait pourtant qu’il ne faut laisser dire à personne que c’est le plus bel âge de la vie.
Que faisait donc Pierre Garçon, le vrai nom de Basse, l’année où commençait le deuxième choc pétrolier ? Comme il a un peu de mal à s’en souvenir, l’homme de 50 ans s’installe dans un hôtel de Clichy, dans le quartier où lui et sa bande s’accrochaient à des rêves de lendemains qui chantaient d’une voix de plus en plus inaudible dans la France du plan Barre. Alors, pour retrouver la mémoire, dans cette chambre anonyme des dortoirs modernes au confort mondialisé, il branche un vieux pick-up acheté en RDA, ceux dont les fils se branchaient directement dans la prise, et il écoute des disques de Zappa, Gainsbourg, Nina Hagen qu’il volait au nom de la reprise individuelle. Et c’est comme si tout recommençait : le corps des amours perdues, les films de Jacques Bral, la silhouette de Christine Boisson et une inoubliable séance de ski sur les pentes enneigées de Montmartre.
Pierre-Louis Basse, ou Pierre Garçon, comme vous voudrez, fait pour ce premier roman un travail aussi essentiel que sans espoir. Bien au-delà d’une simple autofiction, d’un catalogue sentimental, d’une panoplie dérisoire et émouvante qui va de la couleur jaune des tickets de métro à l’haleine mentholée des filles qui fumaient des Kool, il cherche le moment, l’instant peut-être où l’on a basculé d’une époque à une autre. De cette année 1979 à ce temps où « jamais le pays dans lequel il vivait n’avait exhibé autant de preuves d’asservissement à ceux qui dominent et qui détiennent le pouvoir par l’argent ».
Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu, parlait de « dater sa tristesse ». C’est ce que fait Pierre-Louis Basse dans Comme un garçon. Et il le fait vraiment bien, les larmes aux yeux, le sourire aux lèvres.[/access]