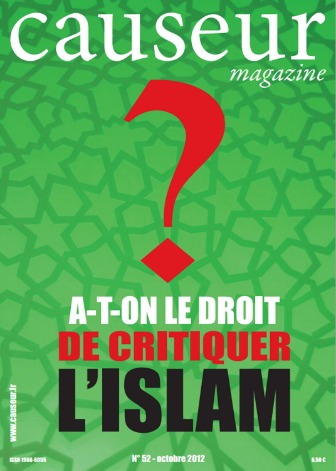En 1930, lorsqu’un film dépassait les bornes, on pouvait commencer par l’interdiction pure et simple et conclure par l’excommunication papale. C’était L’Âge d’or. Luis Bunuel se permettait d’y défenestrer un évêque. Aujourd’hui, c’est dans l’indifférence générale que les hommes d’Église sont filmés comme des simples d’esprit ou des pervers endimanchés.
Avec sa représentation profane de la Cène de Léonard de Vinci, Viridiana (1961) fut interdit en Espagne, en Suisse et en Italie. Si le propos de Bunuel était de montrer la difficulté à pratiquer la charité chrétienne ici-bas, les nombreux détournements publicitaires ou cinématographiques de ces vingt dernières années prétendent tout au plus à un vague racolage connoté. Il est cependant bien rare qu’ils créent le moindre émoi.[access capability= »lire_inedits »]
Lorsque Rivette, en 1966, vit se liguer contre lui parents d’élèves pétitionnaires, nonnes en colère et politiciens outrés, c’est parce qu’il avait l’audace d’adapter La Religieuse de Diderot, qui traitait essentiellement des dévoiements de la vie monastique. Quand il réalise Ne touchez pas à la hache, quarante ans plus tard, personne ne grince des dents alors même que c’est cette fois la vocation religieuse qui est mise en question, puisque la duchesse de Langeais ne prend le voile que pour supporter le dépit d’une passion amoureuse.
En 1985, Je vous salue Marie de Godard abordait les rapports entre le corps et l’âme, transposant de nos jours le mystère de l’Immaculée Conception. Il provoquait l’ire de religieux qui n’avaient vu que l’affiche, tandis que les innombrables représentations gadgétisées de vierges-mères dans l’heroic fantasy, la science-fiction ou la comédie avaient toujours laissé ceux-ci de marbre.
La Dernière tentation du Christ (1988) de Scorsese, adapté de Nikos Kazantzakis, montrait Jésus fondant une famille et abandonnant sa mission divine, avant de se ressaisir car il s’agissait là d’une ultime tentation sur la croix. Face à cette interrogation éminemment chrétienne sur la double nature du Christ, la réaction ne se fit pas attendre : exactions dans de nombreuses salles de cinéma, réactions indignées de dignitaires, menaces en tous genres. Personne cependant ne s’était offusqué de la très irrespectueuse satire des Monty Python, La Vie de Brian, quelques années plus tôt. Et lorsque deux décennies plus tard, Da Vinci Code spécule sur la descendance de Jésus et Marie-Madeleine, c’est surtout l’occasion de débats policés entre érudits bon teint.
C’est peu dire que le blasphème, au terme de ce florilège, apparaît comme une notion assez floue. Au cinéma en tout cas. En bonne logique spectaculaire, le contexte, le climat politico-médiatique, les intentions supposés et la notoriété de ceux qui s’y adonnent, semblent davantage pris en compte que l’objet même du scandale. L’incohérence des réactions tient sans doute, alors, à un furieux désir de reconnaissance couplé à l’incertitude doctrinale. Dans les démocraties post-modernes en effet, les religions ne structurent pas les normes collectives. Elles ne représentent qu’une identité parmi d’autres, une opinion respectable parce que relative. Ne pouvant rien régenter, elles tiennent avant tout à demeurer visibles, à éprouver la fierté de voir leurs pratiques privées accueillies dans l’espace public. Parallèlement, l’hyper-individualisme a fini de faire vaciller le socle immuable des valeurs, des dogmes et des credo, construisant de bric et de broc des univers spirituels sur mesure, libertaires ou coercitifs, hédonistes ou mortifères, soit autant de tribus que de spectateurs. Cela tombe bien car ces mêmes démocraties adorent les identités ainsi présentées, communicantes et syncrétistes, mouvantes et singulières, pittoresques et non exclusives.
De fait, le blasphème ou ce qui se présente comme tel ne peut que se radicaliser, répondant ainsi à plusieurs attentes : celle d’une société libérale qui ne fait passer ses désastres économiques et sociaux qu’à grands coups de discordes sociétales passagères ; celle des tribus elles-mêmes qui acquièrent ainsi davantage de visibilité, mais qui surtout, devant l’outrance sans équivoque, n’ont pas à longtemps hésiter pour comprendre qu’elles sont indignées. Ainsi, pour choquer efficacement, n’est-il plus recommandé de se poser d’ennuyeuses questions sur la nature du Christ : le couvrir d’excréments suffit. De même, la simple représentation de Mahomet risquant d’être prétexte à d’interminables discussions théologiques, autant le grimer d’emblée en chef de guerre stupide et lubrique pour obtenir d’excellents effets.
Mais cette société qui est la tolérance même, qui se fait gloire de respecter la liberté de ceux qui pensent comme elle, qui assure qu’elle a droit au blasphème comme au dernier iPhone et qu’il ferait beau voir qu’on l’en prive, qui incite perpétuellement à briser des tabous et à subvertir des codes qui ne sont pas les siens, qui saura en dresser le portrait blasphématoire ? Qui saura mettre à jour le caractère faisandé de son prétendu humanisme, l’hypocrisie de son antiracisme, le chiqué de son antifascisme (Pasolini a tout dit dans ses Écrits corsaires[1. « Je crois que le véritable fascisme, c’est ce que les sociologues ont appelé, de façon trop débonnaire, la « société de consommation ». Une définition à l’air inoffensif, purement indicative. Et bien non ! Si on observe la réalité avec attention, mais surtout si on est capable de lire à l’intérieur des objets, des paysages, dans l’urbanisme et, surtout, à l’intérieur de l’homme, on voit que les résultats de cette société de consommation sans souci sont les résultats d’une dictature, d’un véritable fascisme. »]). Quel film saura donc révéler que la société de consommation est totalitaire ? Inutile de l’attendre, il a déjà été réalisé, justement par Pasolini, en 1975: Salo n’est supportable que si on se persuade qu’il ne traite que de la Seconde Guerre mondiale; le scandale arrive lorsqu’on a enfin compris qu’il traite bel et bien de notre temps.[/access]
*Photo : Salo de Pasolini.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !