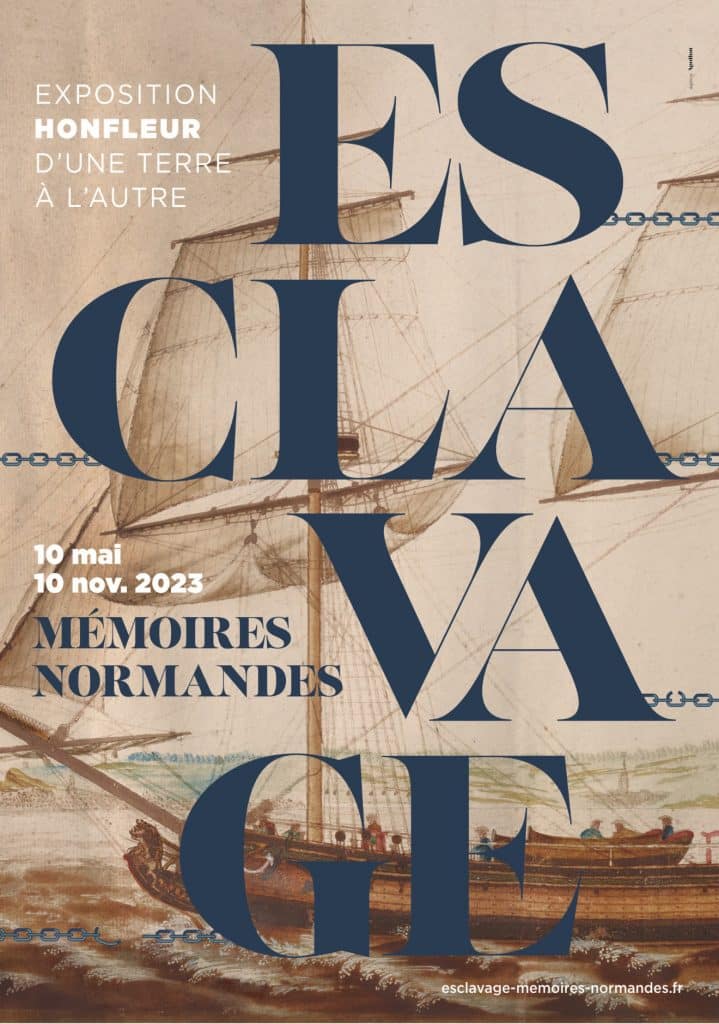L’Opéra-Garnier ouvre la saison lyrique parisienne avec Don Pascuale, irrésistible « dramma buffo » de Donizetti
Pas de morte saison pour Gaetano Donizetti. L’Opéra-Bastille, en février dernier, accueillait dans ses murs la huitième reprise de l’immortel Lucia di Lammermoor, dans une mise en scène d’Andrei Serban millésimée… 1995 ! Cette fois, l’Opéra-Garnier ouvre la saison lyrique parisienne avec Don Pascuale, irrésistible « dramma buffo » du compositeur prolifique dont ce n’est jamais que le soixante huitième opéra : Donizetti n’en écrira plus que deux encore avant de passer l’arme à gauche.
Composition prétendument expédiée en moins de deux semaines – le maître se plaisait à répandre le mythe d’une éblouissante facilité, propre à son génie – créé à Paris en 1843, ce petit joyau de commedia dell’arte, traversé d’un humour doux amer, s’exporta aussitôt avec succès, triomphant dans toutes les salles européennes. Sur un livret de Giovanni Ruffini (1807-1881) tellement remanié par le compositeur que le poète en vint à exiger le retrait de son nom, l’intrigue oppose Don Pascuale, un pingre mais riche barbon un peu puéril, pressé de convoler avec une demoiselle dans la fleur de l’âge, à son neveu Ernesto qu’il menace de déshériter s’il épouse une jeune veuve, Norina. Organisé par son ami le docteur Malatesta, un faux mariage finira par convaincre le vieillard dupé à repousser avec effroi son projet matrimonial. D’un bout à l’autre, cette comédie aux accents mélancoliques est un ravissement.
Troisième reprise d’une production millésimée 2019, la mise en scène inventive et minimaliste de Damiano Michieletto transpose l’action à l’époque du smartphone, des incrustations d’images sur fond vert et des intérieurs high tech. Don Pascuale partage avec sa bonne un « ça m’suffit » à l’ameublement plouc à souhait, que son épouse toute neuve, Norina, dissimulée sous le pseudonyme de Sofronia pour se transformer illico en harpie dissipatrice, réaménagera en loft dispendieux. Meurtri, humilié, pressuré, le mari ne songe plus dès lors qu’à se débarrasser de cette mégère : le but est atteint ; le stratagème aboutit à un mariage plus « décent » : entre jeunes gens. La morale est sauve.

Les effets spéciaux de l’écran géant qui place en gros plan, sur un fond en incrustation vidéo, le visage filmé de Norina permet à Julie Fuchs de déployer son talent comique hors pair, avec force mimiques que le spectateur détaille à loisir. La soprano française – qu’on a déjà entendu l’an passé en Gulietta dans Les Capulets et les Montaigu – accuserait-elle, décidément, une certaine fatigue ? Vibrato distendu, aigus difficiles, projection trop courte – la chanteuse (qui succède à Nadine Sierra puis à Pretty Yende) n’était pas à son meilleur au soir de la première. Tel n’est pas le cas de Laurent Naouri, qui remplace quant à lui Michel Pertusi dans le rôle-titre, tandis que le baryton Florian Sempey, qui campait déjà le docteur Malatesta en 2018 et 2019, et qu’on a pu entendre cette année même dans Roméo et Juliette, endosse le personnage avec brio. Dans le rôle d’Ernesto, le ténor René Barbera qui l’an passé incarnait le comte Almaviva du Barbier de Séville avec la même force jaillissante et cuivrée.
Rien, dans les faiblesses (passagères ?) d’une partie de la distribution, qui ne porte fondamentalement atteinte à la vivacité désopilante d’un spectacle musicalement magistral, sous la baguette transalpine de Speranza Scappucci. Elle dirigeait déjà à Paris Les Capulets… l’an passé. Agée de 50 ans, invitée pour la saison 2025 au Royal Opera House de Londres, c’est la « cheffe » qui monte. Qu’on se le dise.
Don Pasquale. Opéra en trois actes de Donizetti. Direction Speranza Scappucci. Mise en scène Damiano Michieletto. Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris. Avec Laurent Naouri (Don Pasquale), Florian Sempey (Dottor Malatesta), Julie Fuchs (Norina), Slawomir Szychowiak (le notaire).
Palais Garnier. Les 20, 22, 25 septembre, 5, 11, 13 octobre à 19h30.
Durée du spectacle : environ 2h35