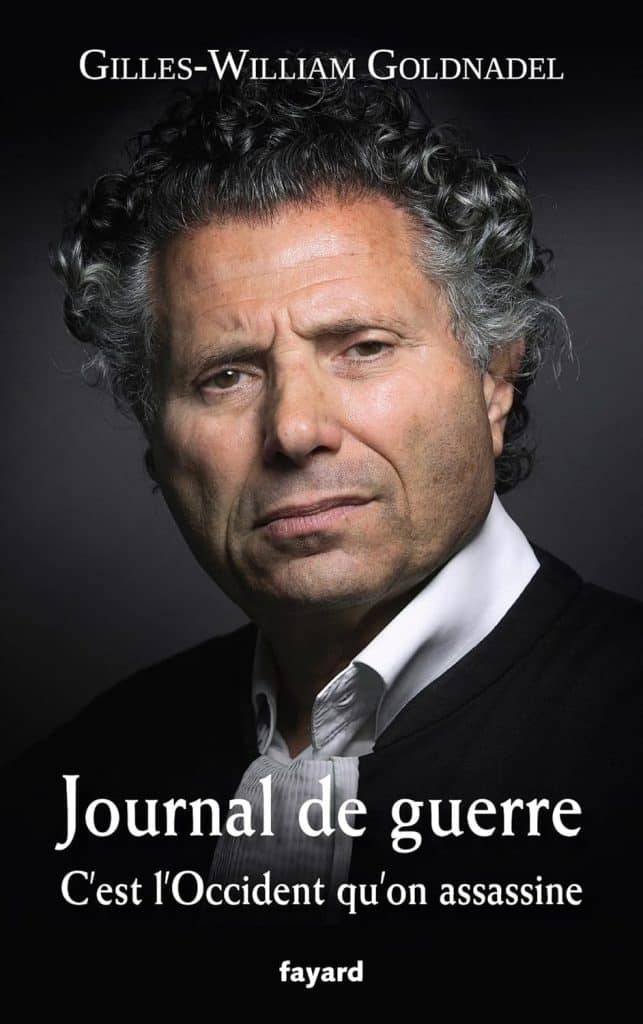De la théorie du genre à la bioéthique en passant par l’antispécisme : panorama non exhaustif des thèses universitaires les plus absurdes, les plus immorales ou les plus risibles – le cumul n’étant pas interdit.
Avant de disséquer dans son dernier ouvrage, La religion woke (1), les thèses déconstructivistes qui ravagent les sociétés occidentales, Jean-François Braunstein avait déjà examiné de près dans La philosophie devenue folle (2), l’excellent essai dont il va être question ici, les travaux de certains « penseurs » très à la mode et ayant participé à l’entrisme, dans le monde universitaire, des théories les plus farfelues devenues, par la force de l’ignorance, de la bêtise idéologique et de la paresse intellectuelle, des thèses « acceptables » et relayées par des professeurs se targuant de progressisme.
Conversations « illicites » avec ma chienne
La théorie du genre est maintenant incontournable dans les universités anglo-saxonnes et connaît un réel succès en France. Le jargon butlérien, après avoir fait le bonheur d’Éric Fassin et de Paris-VIII, a envahi les amphis de la Sorbonne, de Sciences Po, de l’ENS et de quasiment toutes les universités françaises. La théorie en question est aussi fluide, trouble et maigrelette que le liquide rachidien de ses thuriféraires mais les conséquences de son enseignement sont catastrophiques : le transgenrisme, dernier avatar de l’obsession démiurgique et narcissique des déconstructeurs de la distinction sexuelle, ravage une partie de notre jeunesse avec la complicité de l’Éducation nationale, de l’université et de la caste médiatico-culturelle wokiste. Concomitamment, écrit Braunstein, l’idéologie de la « libération animale », initiée par le philosophe et professeur de bioéthique australien Peter Singer, a favorisé l’émergence de l’animalisme et de l’antispécisme chers à Aymeric Caron. Singer, effaçant d’un trait les différences entre « l’animal humain » et « l’animal non humain », s’étonne que les relations sexuelles entre les hommes et les animaux soient encore taboues. Dans la foulée, Monika Bakke, une universitaire polonaise adepte des thèses de Singer, regrette qu’ « aucun pays ne reconnaisse le mariage entre les humains et les animaux ». De son côté, l’universitaire américaine Donna Haraway décrit sa relation avec Mlle Cayenne Pepper, sa chienne, les « baisers mouillés et profonds » qu’elles échangent et les « conversations illicites » qu’elles tiennent, le but étant de « troubler » les distinctions entre les espèces pour finir par « s’entremêler avec le riz, les abeilles, les tulipes, la flore intestinale et tout être organique auquel l’existence humaine doit d’être ce qu’elle est, et réciproquement ». Bref, sous couvert de réflexion philosophique, ça délire à plein tube. Et ce n’est pas fini. Et même ça s’accélère – du plus abject au plus risible.


A lire aussi, du même auteur: Woke fiction, le cinéma français n’est pas épargné
Selon Singer, écrit J. F. Braunstein, si l’on définit l’humanité par le langage, la conscience et la raison, les humains ne jouissant plus de toutes ces facultés – « les enfants et adultes handicapés mentaux, les vieillards séniles ou les personnes en coma dépassé », selon lui – peuvent éventuellement devenir des cobayes d’expérimentations à la place d’animaux « beaucoup plus conscients ou intelligents que ces humains extrêmement diminués ». À un journaliste l’interrogeant sur l’utilisation des chimpanzés dans la recherche pharmacologique, Singer répond qu’il préférerait qu’on cherche à « obtenir le consentement des proches de gens qui sont dans des états végétatifs » et qu’on expérimente les nouveaux traitements sur ces « animaux humains diminués ». Cette idée révoltante n’est pas un « dérapage malheureux », affirme Braunstein en rappelant que Peter Singer est partisan, comme nombre de ses collègues éthiciens, de l’euthanasie sans consentement des personnes dans le coma, des vieillards souffrant de démence sénile ou des enfants « défectueux » – Singer trouve par exemple raisonnable la suggestion du prix Nobel de médecine Francis Crick, à savoir la possibilité d’un délai de trois jours après la naissance d’un enfant pour que les parents puissent effectuer certains tests sur son potentiel génétique puis décider de le laisser vivre ou de le tuer. Si, demain, l’euthanasie est légalisée en France, sommes-nous certains d’échapper longtemps à ce que nous considérons aujourd’hui comme des débordements monstrueux ? Est-il inconcevable d’imaginer que ces derniers puissent devenir, sous la pression des idéologies progressistes, les gestes routiniers et utilitaristes d’une organisation totalitaire, bio-technocratique et eugéniste dirigée par des individus ayant oublié le sens tragique de l’existence et dénués de toute morale ?

Refermons l’excellent essai de Jean-François Braunstein et soumettons à son auteur le cas d’Anna Smajdor, cas remarquable qui pourrait introduire un nouvel ouvrage sur la folie grandissante dans le monde philosophique et universitaire.
GPA « éthique » ?
Anna Smajdor est professeure agrégée de philosophie à l’université d’Oslo. Il y a quelques mois, dans un article intitulé « Whole-Body gestionnal donation » (WGBD ou « Don gestationnel de corps entier ») et paru dans la revue Theoretical Medicine and Bioethics (3), cette éthicienne pro-GPA a émis l’hypothèse d’utiliser comme mères porteuses des femmes… en état de mort cérébrale. « Il n’y a pas de raison médicale évidente pour laquelle l’initiation de telles grossesses ne serait pas possible », décrète-t-elle en introduction de son article. Par ailleurs, elle considère qu’il serait raisonnable de proposer le « don gestationnel de corps entier » (ou WGBD) à toute personne voulant « éviter les risques et les contraintes liés à la gestation d’un fœtus dans son propre corps ». Pour les cas où certaines de ces GPA échoueraient, Anna Smajdor déroule une argumentation abjecte, qu’elle estime, elle, « raisonnable » et « éthique » : « Si les fœtus sont gravement endommagés par des facteurs inattendus découlant de la gestation en état de mort cérébrale – nul besoin de laisser naître des bébés gravement endommagés. […] L’avortement, en particulier l’avortement tardif, peut être traumatisant pour les femmes enceintes, à la fois émotionnellement et physiquement. Cependant, dans le cas du WGBD, la femme gestante est déjà morte et ne peut pas être blessée. Les parents mandatés peuvent décider de l’avortement sans avoir à se soucier des effets sur la donneuse gestante. » Afin d’écarter d’éventuelles récriminations féministes, Anna Smajdor propose que les hommes en état de mort cérébrale participent également au programme WGBD. Bien sûr, concède la chercheuse, il y a des risques mortels, surtout au moment de l’accouchement – « mais pour les donneurs en état de mort cérébrale, le concept de “mortel” n’a aucun sens : le gestateur est déjà mort. » Ces idées délirantes ont suscité de vives polémiques – mais pour combien de temps encore ? Comme le note Sylviane Agacinski dans L’ homme désincarné (4) : « Nos contemporains ont beau répéter à l’envi toute l’horreur que leur inspirent les totalitarismes, ils n’en tirent aucune leçon. On tourne “la morale” en dérision et l’on se moque des “vieux tabous”. Tout est justifié au nom des intérêts individuels et des “demandes sociétales” que le droit est sommé de ne pas entraver. »
A lire aussi, Peggy Sastre: Muriel Salmona: la psy qui traumatise
Les divagations d’Anna Smajdor s’accordent parfaitement avec le projet de déconstruction de l’humanité et d’élimination de la moralité que soutiennent à leur manière philosophes utilitaristes et théoriciens du genre. L’un d’entre eux, Paul B. Preciado, disciple halluciné de Derrida et de Butler, escompte l’avènement du transgenrisme, de la bio-technologie et de l’utérus artificiel afin de mettre à bas ce qu’il appelle, dans ce salmigondis infect, l’ordre hétéro-patriarco-colonial. Tandis qu’Anna Smajdor envisage une nouvelle manière, monstrueuse, de GPA, Preciado propose « l’arrêt de l’assignation du sexe à la naissance » en demandant que les sages-femmes cessent de dire aux parents : « Vous avez eu un garçon (ou une fille) », pour leur annoncer triomphalement : « Bravo ! Vous avez eu un corps vivant ». Le plus curieux est de constater qu’il existe des individus qui écoutent les délires de ces énergumènes le plus sérieusement du monde, sans frémir devant le projet immoral de cette philosophie devenue folle ou sans éclater de rire devant les idées sottes – ou d’une telle absurdité que seuls des intellectuels peuvent y croire, selon la célèbre formule d’Orwell – qui lui servent d’arguments.
Quand le sperme est classé « pathogène »
Finissons sur une drôlerie. Car face à ces élucubrations désespérantes, il arrive un moment où se dégourdir les zygomatiques devient nécessaire et même vital. Dieu merci, les Butler, Haraway, Preciado, Smajdor et autres baudruches intellectuelles déconstructionnistes nous facilitent souvent la tâche. Les thèses chimériques de ces diafoirus universitaires mêlant jargon philosophique, baragouin sociologique et charabia scientifique, n’impressionnent que les cancres estudiantins et les journalistes ignares. Une première et très efficace façon de contrecarrer les ratiocinations bouffonnes de ces imposteurs est de s’en moquer, d’en rire de ce rire qui est « le dédain et la compréhension mêlés » (Flaubert). Anna Smajdor, encore elle, nous a fourni dernièrement une belle occasion d’appliquer cette redoutable méthode. Cette femme savante a en effet écrit avec Joona Räsänen, un professeur de philosophie finlandais qui semble aussi perché qu’elle, un article ahurissant paru dans Journal of Medical Ethics (5). On croit d’abord à un canular – du genre de ceux que Helen Plukrose, James Lindsay et Peter Boghossian firent il y a quelques années afin de dénoncer la vacuité intellectuelle de certaines revues universitaires spécialisées dans les études de genre ou les feminist studies. On comprend rapidement que ce n’en est pas un – et on s’esclaffe. Anna Smajdor et son comparse affirment en effet, dès l’entame de l’article, « qu’il existe des raisons impérieuses de considérer la grossesse comme une maladie. » Suit un résumé hallucinant de la thèse : « Comme une maladie, la grossesse affecte la santé de la personne enceinte, provoquant toute une gamme de symptômes allant de l’inconfort à la mort. Comme une maladie, la grossesse peut être traitée médicalement. Comme une maladie, la grossesse est provoquée par un agent pathogène, un organisme externe envahissant le corps de l’hôte. Comme pour une maladie, le risque de tomber enceinte peut être réduit en utilisant des mesures prophylactiques. »
A lire aussi, Elisabeth Lévy: Aurore Bergé contre #NousToutes: le gouvernement coupera-t-il les subventions?
Les auteurs comparent alors la grossesse à… la rougeole – et ça vaut le détour : « Comme la rougeole, la grossesse est une maladie spontanément résolutive. Elle suit une trajectoire prévisible qui se termine généralement par le rétablissement du patient. La grossesse et la rougeole impliquent également des symptômes qui peuvent altérer la capacité fonctionnelle normale de la personne. […] La grossesse est nocive (comme la rougeole). »Enfin, le summum de cette pitrerie :« Comme la rougeole, la grossesse est également causée par un organisme d’origine externe qui pénètre dans le corps et provoque les conséquences néfastes que nous avons décrites. Ainsi, de ce point de vue, le sperme pourrait être considéré comme un agent pathogène au même titre que le virus de la rougeole. » Les occasions de rire se faisant rares, nous tiendrons nos lecteurs au courant des prochaines publications d’Anna Smajdor, comique agrégée de philosophie délirante au cirque universitaire d’Oslo.
(1) Jean-François Braunstein, La religion woke, 2022, Éditions Grasset.
(2) Jean-François Braunstein, La philosophie devenue folle (le genre, l’animal, la mort), 2018, Éditions Grasset.
(3) Anna Smajdor, Whole body gestational donation, 2022, Theoretical Medicine and Bioethics.
(4) Sylviane Agacinski, L’homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué, 2019, Tracts Gallimard.
(5) Anna Smajdor, Joona Räsänen, Is pregnancy disease ? A normative approach, Journal of Medical Ethics.