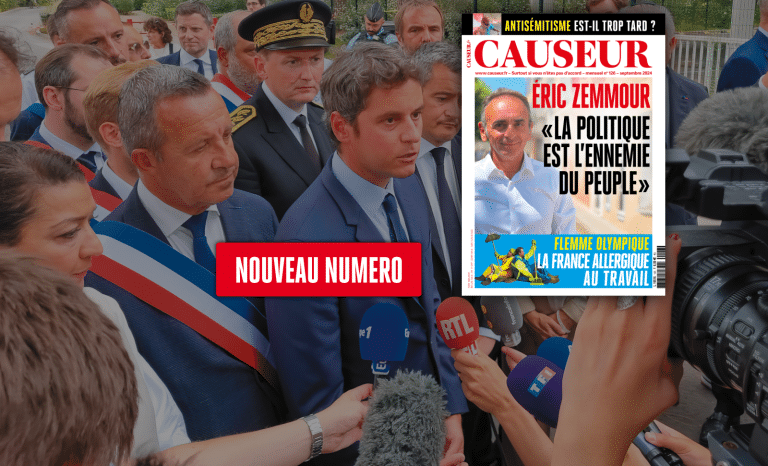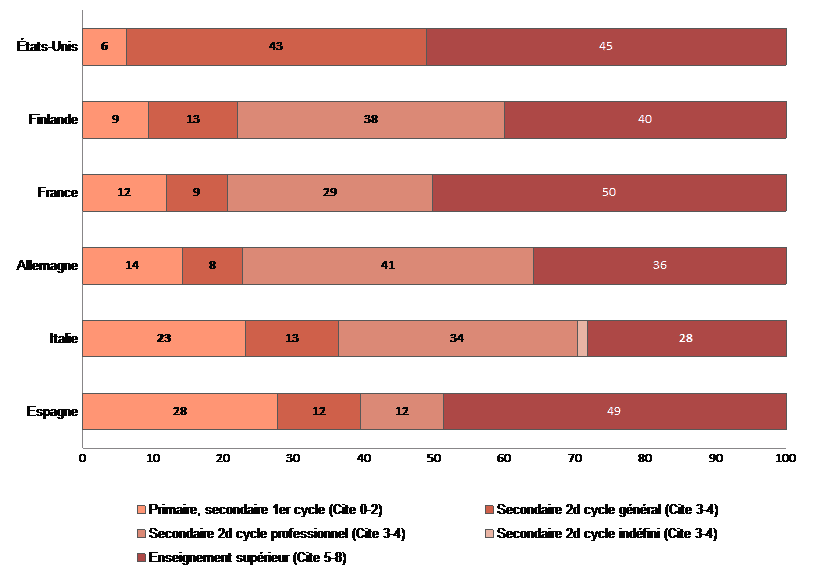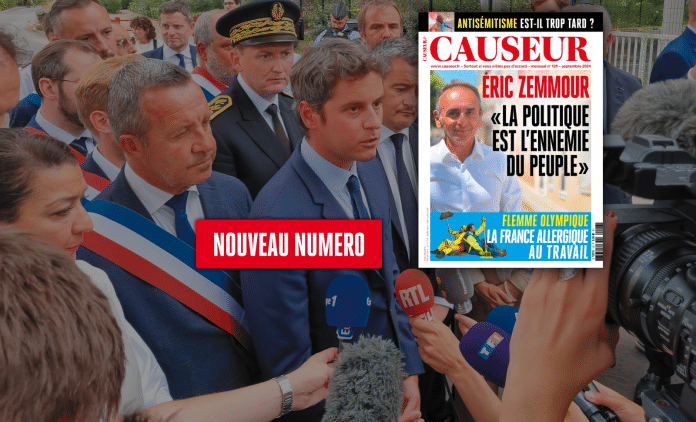Ne déplaise aux olibrius du Nouveau Front populaire, il est dans les prérogatives du président de la République de nommer absolument qui il souhaite Premier ministre. Emmanuel Macron reçoit aujourd’hui à l’Elysée MM. Cazeneuve, Bertrand, Hollande et Sarkozy. Clarification ? Apaisement ? On en est loin… L’hypothèse Cazeneuve, Premier ministre de gauche pour diriger une France de droite, rend fous les LFI. Notre collaboratrice Céline Pina analyse la séquence. Propos recueillis par Martin Pimentel
Martin Pimentel. « Le soumettre ou le démettre » ! Estimant que désormais « les élections ne purgent plus les problèmes politiques mais les aggravent », que le Nouveau Front populaire aurait gagné les élections et qu’Emmanuel Macron se rend coupable d’un « coup de force » en ne nommant pas Lucie Castets à Matignon, Jean-Luc Mélenchon appelle à manifester le 7 septembre. Sa colère est-elle légitime ?
Céline Pina. La colère de Jean-Luc Mélenchon n’est absolument pas légitime. C’est une pure mise en scène destinée à accueillir une fiction tellement grotesque que, dans ce cas-là, seule l’absence de vergogne peut vous sauver. Le premier mensonge du Nouveau Front populaire est de faire croire qu’il a gagné l’élection. Or ce n’est pas le cas, cette coalition n’a pas de majorité et même pas de cohérence. C’est l’union des morts de faim, des bons à rien et de prêts à tout. Pour conserver leur gamelle ou réussir à la remplir, toutes les lignes rouges ont été effacées. La gauche a franchi toutes les barrières morales et a oublié l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Naguère grande pourfendeuse du nazisme et du fascisme, surtout quand il est renvoyé aux poubelles de l’histoire et pouvait être « combattu » sans aucun risque, celle-ci ne voit aujourd’hui aucun inconvénient à ce que la haine des Juifs soit utilisée comme argument électoral.
LFI utilise donc le discours et les clichés antisémites pour capter le vote musulman et le PS, le PC et EELV n’y voient aucun inconvénient. Résultat : les agressions antijuives se multiplient et sont justifiées au nom de la Palestine. Le négationnisme de la majeure partie de la gauche, qui reprend les mensonges des islamistes, dont l’accusation de génocide portée à l’égard d’Israël, est le meilleur déclencheur des passages à l’acte. Mais il y a aussi la lâcheté de nos gouvernants, qui pensent que la communauté musulmane est en majeure partie radicalisée et s’enflammerait si les démocraties occidentales défendaient l’Etat juif. C’est ainsi que nous sommes incapables de réagir alors que le Hamas abat les otages juifs comme des animaux. Pire même nous continuons à verser de l’argent à ces monstres et grâce à nous les tortionnaires sont milliardaires.
A lire aussi, Martin Pimentel: La Grande-Motte: et soudain, Gérald Darmanin a remis sa cravate
Mais revenons à cette gauche, qui a perdu les élections, est minoritaire dans le pays, a perdu tout honneur, toute légitimité et toute crédibilité. Elle n’a plus que la violence comme discours et projet. « Le soumettre ou le démettre », cette phrase aujourd’hui s’adresse à Emmanuel Macron, mais dans la logique conflictuelle et totalitaire qui est celle de LFI, cette phrase sera bientôt adressée au peuple qui devra accepter tous les délires de Mélenchon ou devra être rééduqué. Cette phrase est révélatrice du seul rapport humain que comprend l’extrême-gauche : la domination. Elle ne la dénonce pas en tant que telle mais parce qu’elle ne s’exerce pas à son profit. Voilà pourquoi elle nous propose, au poste de Premier ministre, une candidate sans intérêt, sans histoire, sans parcours et sans véritable programme.
A la rédaction de Causeur, après avoir écouté ses derniers entretiens dans les médias, certains pensent qu’elle a au mieux le profil d’une bonne directrice de crèche, ou, que si vraiment elle a de l’ambition, elle ferait une excellente directrice financière de la filiale française de la chaîne de foot en difficulté DAZN…
Comment l’extrême gauche peut-elle expliquer que refuser de la nommer serait un coup de force ? C’est à la fois une provocation et une façon de tester sa force : fait-on suffisamment peur pour qu’une telle aberration passe ? Le système est-il assez abimé pour que n’importe quoi devienne possible ? Nous avons la réponse : non seulement passé les bornes, il n’y a plus de limite, mais on peut même bâtir des cathédrales de fausses indignations avec du mortier à base de mensonges éhontés. A la fin on a une inconnue illégitime qui explique qu’elle est victime d’un pseudo coup d’Etat parce qu’on ne lui a pas remis les clés de Matignon. Franchement il faut que le leader de LFI pense que nous sommes un peuple de neuneus pour oser se livrer à cette sinistre farce. La seule chose que l’on peut accorder actuellement à Jean-Luc Mélenchon et à cette gauche, c’est que les élections n’ont pas purgé les problèmes politiques mais les ont aggravés. Pourquoi ? Parce que le vote barrage a atteint ses limites. Alors que LFI est vue comme plus dangereuse pour la démocratie et la paix civile que le RN, le président de la République a appelé à voter pour les candidats du Nouveau Front populaire, LFI comprise ! C’est ainsi que nous avons eu la joie de voir un fiché S élu, entre autres personnages abjects qui ont fait leur entrée à l’Assemblée. Si la haine antisémite n’est pas une ligne rouge qui sépare les démocrates des brutes, elle est où la limite ? Comment se sortir d’une situation où un parti minoritaire, de plus en plus rejeté par les Français, qui prône la violence politique et diffuse l’antisémitisme, est jugé légitime à participer à une coalition de gauche, tandis qu’un parti qui a changé de discours, qui a été impeccable après le 7 octobre et dont le discours est conforme à ce que l’on peut attendre d’un parti républicain, est exclu du pouvoir ? Que l’on reste méfiant vis-à-vis du RN peut s’entendre, mais actuellement il est bien plus légitime pour participer à un gouvernement qu’un représentant de LFI. Au vu des évolutions du RN, on ne voit pas ce qui l’empêcherait de soutenir un gouvernement de droite sans participation voire de participer à une coalition.
Le président Macron n’aurait-il pas alors tactiquement mieux fait de ne pas écouter Gabriel Attal, et de ne pas soutenir la stratégie du « front républicain » dans l’entre-deux tours ? Après tout, il préférerait sûrement avoir actuellement Bardella en Premier ministre de cohabitation que de se retrouver dans la situation institutionnelle périlleuse que l’on dit ?
Gabriel Attal a le dos large. Etant donné l’égotisme du président, c’est surtout Emmanuel Macron qui est comptable de ce choix tactique. Mais élever la vieille ficelle effilochée du « front républicain » au rang de stratégie, c’est essayer de faire croire à un homme qui vit dans un monde de soupe que la fourchette est sa meilleure option. Cela ne peut pas fonctionner. Le président est dans une impasse et il s’y est mis tout seul. Personne n’a aujourd’hui les moyens de gouverner et on ne voit guère quelle coalition peut être mise en place. La seule chose que peut espérer le président est de nommer un Premier ministre qui réunisse plus de parlementaires que le NFP, histoire de tordre le cou à la fable du déni de démocratie. Mais celui-ci aura juste les moyens de régler les affaires courantes. Et encore. De toute façon, tant que le système politique décrétera que le vote de 11 millions de Français en faveur du RN doit être méprisé, alors que dans le même temps il ne voit pas de problèmes à utiliser les bulletins d’un parti à la dérive antisémite assumée, la situation restera sans issue. Pire même, une situation de cohabitation aurait permis de redessiner des lignes d’affrontement politique claires. Là cette situation de crise et le fait que trop de représentants du peuple se soient comportés comme s’ils étaient dans une cour d’école a encore accentué la rupture entre les Français et leurs représentants. La crise de confiance est profonde et le spectacle qui nous est montré, fort peu rassurant.
On dit qu’à l’issue de son weekend passé à cogiter à la Lanterne, le président va enfin trancher. Quel profil ou quel nom de personnalité Emmanuel Macron peut-il nommer ? Si vous étiez à sa place, qui nommeriez-vous ?
Tout parait orchestré pour l’annonce de la nomination de Bernard Cazeneuve. Ce n’est pas un mauvais choix, mais cet homme n’a pas pour autant de baguette magique et on ne voit guère comment il pourra transcender une situation politique bloquée et sauver le mandat d’un président encalminé. Surtout qu’aucun des voyants politiques n’est au vert : aucune personnalité d’envergure nationale n’est vue comme faisant office de grand sage ou de référence pour les Français, la société est fracturée et une partie est travaillée par un rêve séparatiste, le système politique est faible en propositions et fort en conflictualité, et les Français ont peur de perdre leur identité culturelle. Le tout dans un monde en crise.
A lire aussi, Philippe Bilger: Nicolas Sarkozy a raison…
La vérité est que je n’aimerais pas être à la place d’Emmanuel Macron, car aucun nom ne me vient qui enverrait un message d’espoir à nos concitoyens. Mais si notre président était à la hauteur de sa tâche, il pourrait changer les choses. Soit en allant au bout et en démissionnant, prenant acte de son échec. Soit en réalisant les clarifications attendues par les Français. Rien ne l’empêche par exemple de dénoncer les accords particuliers qui nous lient à l’Algérie et à d’autres pays en matière d’immigration, rien ne l’empêche de baisser les aides internationales et de jouer le rapport de force pour que les pays étrangers reprennent leurs ressortissants, rien ne l’empêche d’interdire les frères musulmans en France et de démanteler leurs associations cultuelles et culturelles, rien ne l’empêche de cesser de subventionner le Hamas, rien ne l’empêche de faire en sorte que les délinquants perdent aides sociales et droit au logement HLM, rien ne l’empêche de refaire de l’hôpital et de l’école une priorité et d’arrêter avec le collège unique, rien ne l’empêche de sortir de certains dispositifs débiles comme ceux organisant une concurrence stérile en matière de distribution d’électricité sur notre sol…
A force de ne vouloir être clair sur rien, plus personne ne sait pour quoi il vote, quel est le modèle de société que les élus portent, quelle est la vision que les partis défendent. Ce que nous dit notre difficulté à proposer un nom crédible, c’est à quel point les partis, en ne faisant pas leur travail de sélection et en récompensant la médiocrité, ont abimé la démocratie. Emmanuel Macron est l’enfant terrible de la vacuité, mais les partis actuels ont été sa matrice. Si Bernard Cazeneuve est nommé, il gérera les affaires courantes et cela aura peut-être une conséquence annexe intéressante, celle de faire exploser le PS et de donner aux républicains de gauche le courage de rompre avec les malotrus de LFI. Certes ils auront mis le temps, mais que des politiques renouent avec la conscience et l’honneur doit toujours être salué.
On ne sait pas si François Ruffin ira manifester le 7 septembre. Il a rompu avec les Insoumis pendant les législatives. Peut-il tout seul affaiblir Mélenchon ?
Symboliquement oui, en montrant que l’avenir de la gauche radicale n’est pas l’islamo-gauchisme, le mépris du travail et la création d’un homme nouveau par la rééducation. Il porte la version actuelle du communisme « à visage humain », là où LFI fait dans la réactivation du fantasme totalitaire. Ceci étant dit, en politique, les organisations sont plus puissantes que les individus. Or François Ruffin, c’est combien de divisions ? Ajoutons aussi qu’en politique, le charisme ne fait pas tout. Trotski était plus brillant que Staline, mais Staline maitrisait l’organisation bolchevique. Et c’est lui qui a gagné la guerre de succession. Or pour maitriser une organisation il faut énormément d’investissement, d’énergie et de constance, le boulot est ingrat et astreignant, il faut être capable de se le coltiner… Au-delà de ce fait, Jean-Luc Mélenchon n’est pas un perdreau de l’année. Son organisation n’est pas un parti, c’est une forme d’association tenue par très peu de personnes. Jean-Luc Mélenchon contrôle tout et a la main sur les finances. Tous ceux qui s’opposent à lui se retrouvent très vite à poil. Et refonder un parti est long et compliqué quand on n’a pas des soutiens puissants. Pour l’instant François Ruffin peut être une gêne, mais il n’est pas vraiment un facteur d’affaiblissement.
69% des Français estiment que LFI est un parti dangereux pour la démocratie, et 72% pensent même qu’il attise la violence. A gauche, certains l’ont bien compris. Dans cette histoire de « destitution » du président Macron brandie par la gauche populiste, quelle petite musique nous font donc entendre Raphaël Glucksmann, Olivier Faure et François Hollande ?
Le parti socialiste ne soutient pas la proposition de destitution du président réclamée par LFI. Mais comme d’habitude ses représentants le font dans la confusion et l’opacité. François Hollande a expliqué que le président commettait une faute institutionnelle en ne nommant pas Lucie Castets Premier ministre, ce qui ne veut rien dire sur le fond, tout en tentant de faire forte impression sur la forme. Un résumé de l’œuvre de l’ancien président et une explication de son absence de postérité ? Les Hollande et Faure essaient ainsi de s’assurer une forme de respectabilité en envoyant un message aux élites et aux personnes rationnelles, message qui explique qu’ils ne sont pas en phase avec ces zozos de LFI. Dans le même temps, ils laissent entendre qu’Emmanuel Macron viole la constitution, cela pour donner des gages à une jeunesse décérébrée, persuadée que l’on vit en dictature. Cette façon de vouloir tirer des marrons du feu sans avoir ni briquet, ni bois, ni même avoir fait l’effort de la cueillette est la marque des incapables. Quand on a une pensée, une vision et un chemin politique à proposer, on n’en arrive pas à de telles contorsions.
La participation aux législatives était massive, et pourtant la situation politique du pays est bloquée depuis des semaines. Les Français divisés ne peuvent-ils s’en prendre qu’à eux-mêmes, ou bien la classe politique et les boutiquiers dans les partis sont responsables de la situation ?
Les Français ne sont pas si divisés que cela. Ils demandent toujours la même chose aux politiques. Leurs préoccupations ne changent pas. Elles sont à la fois matérielles et culturelles. Ils leur demandent de préserver leur mode de vie, leur organisation sociale et leur niveau de vie. En ce qui concerne les menaces pesant sur la société, les mœurs, us et coutumes, ils ont identifié le problème : la forte présence d’islamistes qui radicalisent une partie de plus en plus notable de la population arabo-musulmane. La jeunesse arabo-musulmane est en majorité sous l’influence de ces idéologues, différentes statistiques et études l’attestent. La fracture de la société est essentiellement là. Le problème c’est qu’aujourd’hui la peur des politiques face aux islamistes les amène à ne pas agir et à refuser de protéger la majorité de la population pour complaire à une minorité radicalisée. Et la première population qu’ils abandonnent aux mains de ces authentiques fascistes est la population musulmane.
A lire aussi, Didier Desrimais: Aurélien Bellanger, dhimmi en chef
Le deuxième problème est que, faute de propositions, les partis ne comptent que sur les votes barrage pour garder le pouvoir. Aujourd’hui ils savent, comme Emmanuel Macron, que l’on peut être minoritaire dans le pays et se faire élire quand même président. Pourquoi se fatiguer à construire des programmes, à rassembler une majorité, à définir des politiques quand il suffit de désigner un ennemi et de le diaboliser ?
Enfin, quand l’ennemi que vous avez choisi, ici le RN, s’empare des sujets qui inquiètent les Français et fait des propositions en phase avec les attentes des Français, vous enclenchez la machine à désigner des fascistes et vous bloquez toute discussion en rendant le sujet incandescent. Le problème est que la censure n’a jamais fait disparaitre les problèmes ; elle les fait grossir tout en invitant à ne jamais les considérer. Aujourd’hui les Français payent la lâcheté de leurs politiques avant tout. Ils payent aussi leur mollesse : cela fait longtemps qu’on les prend pour des idiots et que les politiques leur demandent de faire les castors, élections après élections. Ils le font. Pourquoi les politiques changeraient une tactique qui leur permet de garder le pouvoir sans même se fatiguer à travailler pour l’avenir ?
La rentrée politique est également marquée par le curieux roman d’Aurélien Bellanger. Ce dernier était reçu sur France inter lundi dernier, où il a dénoncé « l’islamophobie » d’une partie de la gauche, 48 heures après une attaque islamiste à la synagogue de la Grande Motte ! Que penser de ce romancier polémique ? La guerre entre deux gauches irréconciliables fait-elle toujours rage concernant la laïcité ?
On peut se dispenser de la lecture d’un ouvrage écrit avec les pieds par un homme qui ne fait que recycler les éléments de langage des islamistes. L’emploi du terme « islamophobie » montre d’ailleurs que l’on est sous cette influence, ce terme signe son islamo-gauchiste.
Mais ce Bellanger n’ayant aucun intérêt, revenons à la question de fond. Bien sûr qu’il y a deux gauches irréconciliables. Qui a envie d’être conciliant avec la gauche qui promeut l’antisémitisme, répand la violence politique et se vautre ? Et pourtant, c’est bien cette gauche-là qui a fait la peau à la gauche traditionnelle, ouvriériste et humaniste. Aujourd’hui la guerre pour préserver la laïcité a été perdue à gauche et celle-ci est devenue le cheval de Troie de l’islamisme. Si le fait de nommer ou de penser à nommer Bernard Cazeneuve Premier ministre permet à ceux qui ne se reconnaissent pas dans la dérive actuelle d’Olivier Faure de trouver le courage de se démarquer et de rompre avec LFI, nous n’aurions pas tout perdu.
Hélas pour reconstruire il faut savoir parfois prendre sa perte matérielle. Le PS de Faure a préféré perdre son âme et sauver ses voitures de fonction. Si l’hypothèse Cazeneuve permettait à la gauche laïque de comprendre qu’elle n’a rien en commun avec la gauche totalitaire, nous aurions déjà gagné quelque chose.