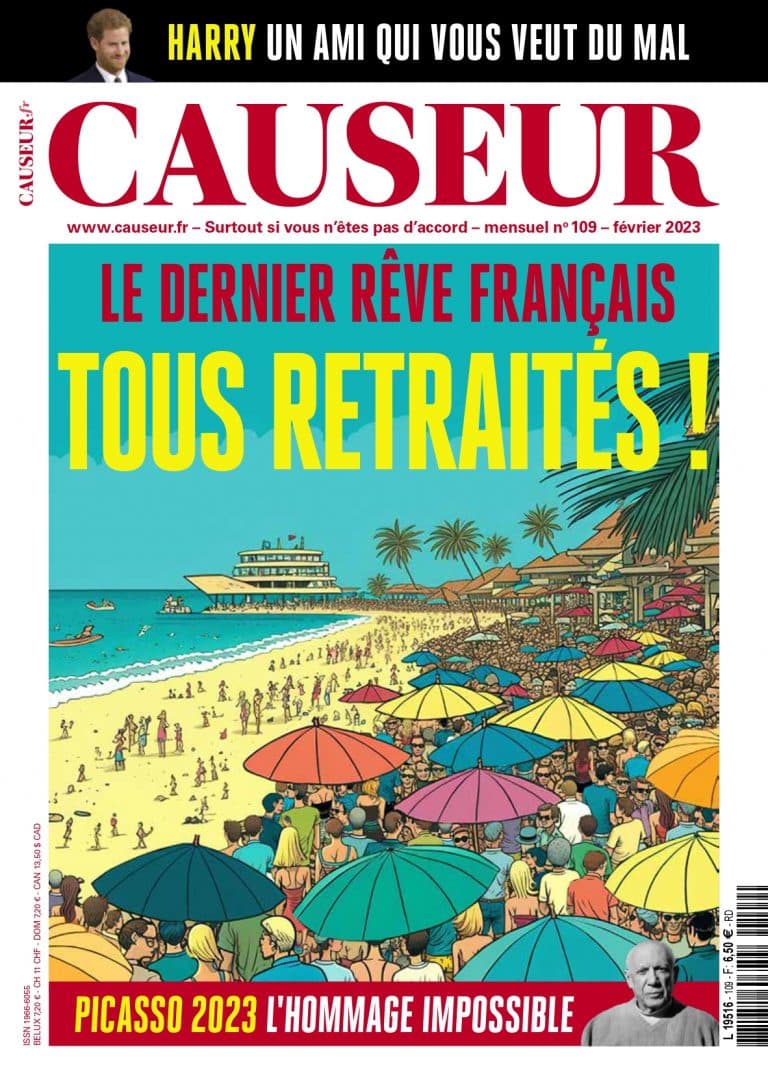La chanteuse et comédienne Marie-Thérèse Orain est le témoin privilégié du Paris des cabarets et des music-halls. Elle a connu les plus grands et les derniers feux d’une époque bénie où la chanson française était un vivier de talents.
Chanteuse et comédienne, Marie-Thérèse Orain aura toute sa vie humblement et passionnément servi son art. Comédienne au boulevard, chanteuse fantaisiste au cabaret, chanteuse lyrique à l’opérette, elle n’a eu de cesse, sa carrière durant, de rebondir vers de nouvelles aventures. Témoin privilégiée de l’époque des « cabarets rive gauche » comme L’Échelle de Jacob ou L’Écluse, Yves Jeuland l’invite en 2012 à raconter cette époque dans son remarquable reportage Il est minuit, Paris s’éveille. En 2015, à l’âge de 80 ans, elle enregistre son premier album, Intacte, laissant enfin une trace de la chanteuse des nuits parisiennes, artiste qui partageait la scène avec Barbara, Brassens, Anne Sylvestre ou encore Patachou.
Aujourd’hui, on a l’impression qu’on ne doit pas pouvoir se remettre d’une main aux fesses. Non vraiment, j’ai du mal à comprendre ce monde…
Sur cet album, d’ailleurs, deux chansons sont consacrées au monde des cabarets, La Chanteuse, de Jacques Debronckart et Va lui dire à la p’tite, texte poignant écrit pour elle par son amie Anne Sylvestre.
Causeur. Vous vouliez devenir comédienne, et vous avez bifurqué vers la chanson et les cabarets. Comment cela s’est-il passé ?
Marie-Thérèse Orain. Je le dois à Patachou ! Après Oscar avec Louis de Funès, on m’a proposé trois petits rôles parlés dans la nouvelle comédie musicale d’Alexandre Breffort (qui venait de faire un triomphe avec Irma la douce). Patachou devait tenir le rôle principal. Durant les répétitions, le metteur en scène était furieux car elle s’absentait souvent pour aller donner des concerts. Il m’a donc proposé d’être sa doublure durant ses absences. J’ai rapidement appris ses airs. Un jour de répétition, j’étais sur scène en train de chanter le rôle principal au milieu des danseurs, très à l’aise, quand Patachou débarque et me voit donc tenir son rôle ! Elle est restée au fond de la salle à me regarder. À la fin de la chanson, elle s’avance jusqu’à la scène et me dit : « T’es chanteuse toi ? » d’un ton assez sec. Je lui réponds que non, qu’on m’a juste demandé de faire ça pour la doubler lors des répétitions. « T’as déjà chanté ? » me lance-t-elle. Je lui assure que non. Elle monte alors sur scène pour que je lui montre ses déplacements que j’avais appris. Et là, à voix basse, elle insiste : « Allez, t’as pas voulu me le dire devant les autres… mais t’as déjà chanté ? » Je lui réponds : « Oui, mais juste un peu, et pas seule, en chœur, dans une revue de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, juste comme ça .» Patachou, surprise, me dit : « T’as jamais chanté seule ?! Eh bah tu devrais ! Allez, chiche ? Je ne te donne pas de directive ni de conseil, tu choisis quatre ou cinq chansons, tu te trouves un pianiste, tu répètes et quand tu es prête, tu me le dis, tu viens me montrer ça à la maison et je te dirai si ça vaut la peine de continuer. » Je me suis directement inscrite dans une école de chant tenue par Christiane Néret. Les cours avaient lieu au Bœuf sur le Toit. On pouvait y aller à n’importe quelle heure, il y avait toujours un pianiste de fonction. J’y suis allée tous les jours après avoir trouvé des chansons dans des maisons d’édition. À l’époque on faisait comme ça. On allait chez un éditeur et on disait : « Bonjour, je cherche des chansons fantaisistes un peu comme ci ou comme ça ». Le type vous disait : « Attendez, je crois que j’ai ce qu’il vous faut. » Il sortait la partition et la donnait à un pianiste de fonction qui vous la jouait. Et si ça nous plaisait, on achetait ! C’était aussi simple que ça de se constituer un petit répertoire. Je prépare donc ces chansons et, lorsque je suis prête, je le dis à Patachou. Elle me reçoit avec ma pianiste dans son somptueux appartement de Neuilly. On se met à table et à la fin du repas, elle me dit : « Allez, on va dans le salon et tu vas me montrer ça ! » J’étais terrifiée. Elle a tout écouté et à la fin elle m’a dit : « Oui, il faut continuer. Et je vois très bien quel répertoire il te faut… le mien ! » Je pensais qu’elle me prenait pour une concurrente plus jeune qu’elle, je pensais que c’était terminé pour moi. Mais pas du tout ! Lorsqu’elle a été directrice artistique du magnifique cabaret de la tour Eiffel, elle m’a engagée pour faire sa première partie. Voilà comment je suis devenue chanteuse !
Comment avez-vous évolué dans ce monde des cabarets ?
En juillet 1962, un type qui m’avait vu chanter au cours Néret – et qui connaissait bien madame Lebrun, la patronne du cabaret L’Échelle de Jacob – m’appelle et me demande : « Est-ce que vous pouvez aller à L’Échelle, ce soir à minuit, avec vos partitions ? Un artiste est malade et il faut d’urgence le remplacer. Comme ça, Suzy Lebrun vous verra ! » J’arrive là-bas avec un trac épouvantable. La salle était vide ! Il n’y avait qu’un couple qui se roulait des pelles sur la banquette du fond. La mère Lebrun a eu pitié de moi et a fait descendre le barman et la fille du vestiaire pour les mettre au premier rang. Je termine mon tour, la patronne vient me voir et me dit : « Bon, très bien. Vous revenez demain ! » Et je suis restée quatre mois. Je jouais dans la pièce Oscar le soir et ensuite je partais à L’Échelle de Jacob faire mon tour de chant. Puis tout s’est enchaîné. J’ai été engagée à La Villa d’Este, un « cabaret bouchon », un « cabaret champagne »… c’est-à-dire qu’il y avait des entraîneuses. C’était à l’Étoile, un cabaret rive droite ! Ça payait mieux que les cabarets rive gauche ! Mouloudji a lui aussi passé des années à chanter à La Villa d’Este.
A lire aussi : Daniel Auteuil et Pierre Perret, deux figures françaises
Vous ne chantiez que dans les cabarets ?
Non, également dans les music-halls [1]. À l’époque il y avait les music-halls de quartier, comme la Gaité Montparnasse. C’étaient des endroits qui avaient essentiellement une clientèle d’arrondissement. J’adorais chanter au Pacra, boulevard Beaumarchais. Le public était composé de petites gens, des concierges, des petits commerçants. Il devait y avoir mille places. L’orchestre était dans la fosse. Les ouvreuses étaient d’époque, c’étaient des dames d’un certain âge qui traînaient la patte. D’ailleurs la régisseuse boitait. C’était une ancienne trapéziste qui s’était cassé la gueule. Ce petit monde du music-hall parisien, c’était quelque chose ! J’adorais ça. C’était une école de vie ! Il fallait travailler, gravir les échelons. Souvent, les chanteurs commençaient dans les cinémas de banlieue car, en ce temps-là, avant le début du film, il y avait des attractions. Parfois un chanteur, parfois un magicien, des jongleurs. Aznavour a commencé comme ça. Après avoir écumé les cinémas de banlieue, les artistes prenaient du galon et passaient aux salles parisiennes. Ensuite seulement, ils accédaient aux music-halls de quartier. Alors, quand on arrivait sur les grandes scènes, on avait du métier.
Combien de temps avez-vous chanté dans les cabarets ?
Malheureusement, j’ai connu la fin des cabarets… Ils ont fermé les uns après les autres. Financièrement, c’était trop difficile pour eux. Les cabarets de la rive gauche étaient taxés autant que ceux de la rive droite – comme La Nouvelle Ève et les boîtes à entraîneuses – où les types dépensaient trois milles balles de champagne dans la nuit, tandis que rive gauche, les gens passaient la soirée à écouter les artistes avec une consommation à vingt balles. La fin des années soixante a été le grand déclin des cabarets.
Dans ces années-là, comment était la nuit parisienne ?
Oh ! Aujourd’hui on ne peut même pas l’imaginer. C’était fantastique ! Moi, avant d’aller chanter au cabaret, vers neuf heures du soir, je m’installais en terrasse sur le boulevard Saint-Michel uniquement pour regarder passer les gens. Ils étaient bien habillés, c’était joyeux, ça bouillonnait ! Je regardais ça émerveillée… puis vers vingt-trois heures, j’allais chanter. La nuit à Paris, il y avait du monde, de l’effervescence, et puis ce n’était pas violent. J’ai été une travailleuse de nuit pendant longtemps, et je peux vous dire qu’en rentrant chez moi tous les soirs après mes prestations, je ne me suis jamais fait voler ou agresser ! Pour moi, la violence et la mauvaise ambiance sont arrivées avec 68. J’ai vu ce monde de la nuit et des cabarets, que j’aimais tant, s’éteindre tout doucement… et là j’ai filé…
A lire aussi : Suzy Solidor: vive l’égérie française!
Filé où ?
J’ai toujours eu de la chance. À chaque fois qu’une chose s’est dérobée sous mes pieds, une autre chose s’est pointée. J’apprends ainsi un jour que monsieur Cartier – directeur du théâtre du Châtelet – a une proposition à me faire. Je suis étonnée car c’est un théâtre lyrique et je ne suis pas chanteuse lyrique. Mais il me reçoit et me dit : « J’ai pensé à vous pour la comédie musicale américaine No, no, Nanette. Je ne vous connaissais pas mais ces derniers jours, quatre personnes m’ont dit que pour le rôle de Pauline, il fallait Marie-Thérèse Orain. » Et voilà comment j’ai été engagée au Châtelet. Sans passer d’audition ! C’était en 1982. Ensuite, j’ai enchaîné les opérettes et les comédies musicales. Ça a duré vingt ans. Et, parfois, avec de très beaux spectacles, comme La Veuve joyeuse mise en scène par Alfredo Arias. Et puis j’ai fait beaucoup de spectacles avec Jérôme Savary, notamment des Offenbach magnifiques comme Le Voyage dans la lune et La Vie parisienne. J’ai chanté dans les plus belles salles durant ces vingt ans… Châtelet, Opéra-Comique, Grand Théâtre de Genève…
Pour en revenir aux cabarets, quelles sont les grandes personnalités qui vous ont marquées ?
J’adorais Christine Sèvres, qui était malheureusement estampillée comme la femme de Ferrat. Mais c’était une grande chanteuse ! J’aimais beaucoup Catherine Sauvage aussi. Ses récitals au Théâtre Montparnasse avec Jacques Loussier au piano étaient bouleversants ! Du grand travail ! Et Barbara ! J’ai fait le cabaret La Tête de l’Art pendant un mois avec elle, dans le même programme. Je l’ai bien connue. Et puis Gribouille… qui est malheureusement partie trop tôt. C’était une des plus grandes. Lorsque je l’ai vue à Bobino, elle m’a tout de suite rappelée Piaf. Il y avait aussi Cora Vaucaire : quelle classe, quelle articulation, c’était remarquable ! Vraiment, il y avait un vivier d’artistes dans la chanson française à cette époque… et puis les Yéyés sont arrivés. Et là, ça a été terminé. Voilà, il n’y en avait plus que pour les Yéyés… On m’a proposé de me « reconvertir », mais je n’ai jamais pu. Chanter des conneries, non merci !
A lire aussi : Qui a peur de la musique française?
Et Brassens ?
C’était un type formidable. J’ai fait deux fois Bobino avec lui. En principe pour les tournées, il ne voulait pas embarquer de femme dans l’équipe. Il disait : « Dès qu’il y a une chanteuse quelque part, la merde commence. » Lors de notre second Bobino ensemble, le soir de la dernière, je vais le voir et je lui dis : « Bon bah, on se dit au revoir. » Il n’aimait pas les au revoir et, comme il sentait que j’allais pleurer, il était très mal à l’aise. Il m’a juste dit : « Si je refais Bobino, tu feras partie du convoi. » Il part, fait trois pas, puis revient et ajoute : « Parce que je vais te dire… pour une bonne femme, tu n’es pas trop emmerdante. » C’était tout Georges : la tendresse, la pudeur, la délicatesse. Il était très délicat, il faisait attention aux autres. Je ne l’ai jamais vu mal parler à qui que ce soit, jamais. Georges, c’était le peuple dans ce qu’il a de plus noble.

Que pensez-vous du monde d’aujourd’hui ?
Je le trouve très inquiétant. L’ambiance n’est plus à la rigolade. Même dans le milieu artistique. Quand on voit la chasse aux sorcières que subissent les hommes… je n’aimerais pas être à leur place. Moi, j’ai du mal à comprendre cela. J’étais mignonnette quand j’étais jeune, des gars qui ont essayé de me coincer, il y en a eu ! J’ai même eu très chaud quelques fois… Mais ça ne m’a jamais traumatisée… franchement ! Ça m’est toujours passé au-dessus. Quand j’y repense, ça aurait plutôt tendance à me faire rire. Aujourd’hui, on a l’impression qu’on ne doit pas pouvoir se remettre d’une main aux fesses. Non vraiment, j’ai du mal à comprendre ce monde que je vois tourner à une vitesse phénoménale, et dans un drôle de sens.
[1] Le music-hall disposait de grandes salles, plutôt luxueuses (Bobino, Alhambra, Olympia, Concert Pacra). On y présentait des revues avec décors, orchestre, etc., mais aussi des chanteurs et des fantaisistes. Au cabaret, la salle était petite et la scène minuscule. Les artistes s’y succédaient durant la soirée seulement accompagnés d’un pianiste. C’était la chanson sans fioritures ni paillettes. (Barbara, Greco, etc.).