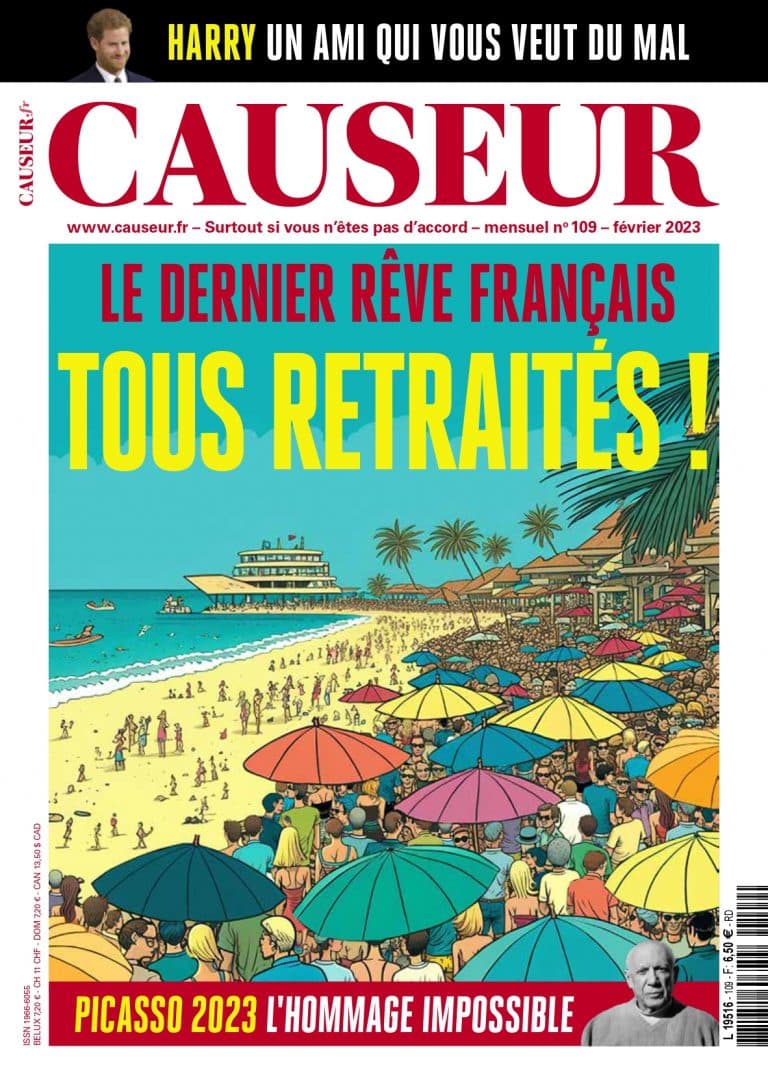Depuis une dizaine d’années, chefs d’entreprise, artisans et commerçants font le même constat: il est de plus en plus difficile d’embaucher de jeunes recrues, même des apprentis. Leur manque de rigueur et d’investissement se double d’une seule obsession: le salaire.
Selon le poète grec ancien, Hésiode, c’est le labeur qui ennoblit l’homme : « En travaillant, tu seras bien plus cher aux dieux et aux mortels : car les oisifs leur sont odieux. Ce n’est point le travail, c’est l’oisiveté qui est un déshonneur[1]. » A-t-on la même vision du travail à notre époque caractérisée par l’hyper-individualisme et l’influence des réseaux numériques, où l’on prône sans cesse le bien-être et la quête personnelle de sens ? Quittons la Grèce d’Hésiode pour les Yvelines modernes afin de recueillir les témoignages de nos artisans et petits entrepreneurs. Serdar, d’origine turque, est maçon. Son entreprise « Tous corps d’état » embauche souvent des salariés malgré les charges sociales et les coûts fixes. Mais depuis six ans, c’est de plus en plus difficile : « Les jeunes ne veulent pas beaucoup travailler. Ils veulent gagner toujours plus d’argent mais l’argent, on doit le mériter. » C’est au point que les candidats, dès le début d’un entretien d’embauche, posent une seule question : « C’est payé combien ? » Beaucoup préfèrent se mettre à leur compte en croyant pouvoir travailler seulement quand ils veulent. Serdar est obligé de leur sous-traiter des tâches quand son entreprise n’arrive pas à embaucher. Mais les sous-traitants sont trop pressés de terminer le travail. « Ils veulent toucher les sous et partir. » En général, les jeunes n’ont pas envie de faire des travaux manuels qui sont trop fatigants, voire usants. Serdar lui-même, qui a 43 ans, sera content de prendre sa retraite à 55. On comprend bien que pour être maçon à notre époque, il faut être fort comme un Turc.
A lire aussi : France qui bosse, France qui glande
Au moment où je l’interviewe, Serdar travaille en collaboration avec Pernelle, dont l’agence d’architecture, ouverte en 2015, est loin de manquer d’activité. Elle forme des stagiaires mais les charges font qu’il serait trop coûteux de les embaucher. Sa collaboratrice actuelle travaille au bureau mais pour son propre compte en facturant l’entreprise pour ses prestations. Sophie, opticienne, forme des apprentis en alternance depuis treize ans. Aujourd’hui, elle a trouvé la perle rare, Éva, qu’elle a embauchée, mais les autres n’étaient pas tous aussi motivés. « Ils n’allaient pas forcément en cours ou ne retenaient pas bien les consignes, de sorte qu’il fallait passer derrière. J’aurais été très hésitante pour les recruter. » Surtout dans une petite entreprise comme la sienne, il faut de la rigueur dans le conseil proposé aux clients. « On a une formation de spécialistes avec une dimension médicale. On n’est pas que des vendeurs comme dans les grandes surfaces. » Les stagiaires qui n’ont pas achevé leur formation se reconvertissent dans des métiers nécessitant moins d’engagement. Sandrine, qui cogère un salon de coiffure, a cessé de prendre des apprentis il y a huit ans car « il n’y avait plus d’investissement du tout. Ils voulaient le salaire sans trop en faire. » Âgée de 43 ans, elle est frappée par le contraste avec sa propre génération. « Il leur manque la passion, l’envie, la vocation… ! » Cela ne coûte pas cher de prendre des apprentis, mais à quoi bon ? On n’est pas motivé soi-même pour transmettre ce qu’on a appris à des personnes qui s’en fichent.
Manque d’implication, refus de la rigueur, hâte de prendre l’oseille et de se tirer… on retrouve le même syndrome dans un métier aussi différent que celui de contrôleur technique automobile. Franck l’exerce depuis 1992, année où il a repris le centre créé par son père. C’est un des univers professionnels les plus réglementés. On y arrive par une formation approfondie et un stage de six mois, et pour garder l’agrément accordé par le préfet, il faut se maintenir au niveau chaque année grâce à 24 heures de cours. Non seulement il faut connaître par cœur les 133 points de contrôle, dont les modalités sont en constante évolution, mais les statistiques des contrôles qu’on effectue sont elles-mêmes contrôlées par les services de l’État : toute anomalie déclenche une visite musclée d’une équipe d’inspecteurs. C’est dire qu’il faut de la rigueur. Franck prend les stagiaires que lui envoient les centres de formation, mais depuis une dizaine d’années tout a changé. « Les premiers que j’ai eus étaient sérieux, avaient envie de bosser. Aujourd’hui, ils s’en foutent. » Le changement de mentalité lui a sauté aux yeux le jour où il a proposé une petite interro à un stagiaire qui a répondu : « Ça ne m’intéresse pas. » Il ne voulait pas acquérir une méthode de travail rigoureuse, mais faire le minimum pour avoir l’agrément. Comment font ces apathiques face aux inspections ? « Il y a beaucoup de roulement dans le métier et une pénurie de contrôleurs. »
A lire aussi : Une retraite ? Plutôt crever
La situation générale est bien résumée par Thomas qui a repris une belle entreprise familiale de travaux électriques, spécialisée dans l’éclairage public. Il prend des apprentis afin de former les futurs salariés de sa société mais depuis sept ans, dès la fin de la formation, ils ont tendance à partir. « Le travail pour eux, c’est une sorte de consommable. » Ils peuvent rester un an dans une entreprise et s’ils ne s’y sentent pas bien, ils vont tenter autre chose. Souvent ils n’exploitent même pas le diplôme qu’ils ont acquis. Les jeunes ne se projettent plus dans une firme. En 2011, l’ancienneté moyenne des employés de Thomas était de vingt à vingt-cinq ans ; aujourd’hui, elle est de quatre à six ans. À qui la faute ? À une jeune génération née avec le péché originel consistant à rechigner à bosser ? Ou les causes sont-elles plus complexes ? Dans son histoire de la notion de travail, le chercheur Olivier Grenouilleau voit dans les paroles de Hésiode un jumelage assez constant dans l’histoire occidentale : le travail est à la fois une malédiction parce que l’homme y est condamné, mais c’est aussi une source de rédemption parce qu’il peut construire son monde[2]. Aujourd’hui, nous avons promis aux jeunes que le travail mène à tout, y compris à l’épanouissement de soi, mais un grand nombre de nos concitoyens ont été déshérités par ce que le géographe américain Joel Kotkin appelle le « néoféodalisme » de notre société postindustrielle. Les richesses sont concentrées entre les mains des oligarques de la Big Tech et les salaires des autres restent comprimés[3]. L’équation entre la malédiction et la rédemption est bancale.
[1] Les Travaux et les Jours (trad.Thomas Gaisford).
[2]. L’Invention du travail, Le Cerf, 2022.
[3]. The Coming of Neo-Feudalism: A Warning to the Global Middle Class, Encounter, 2020.