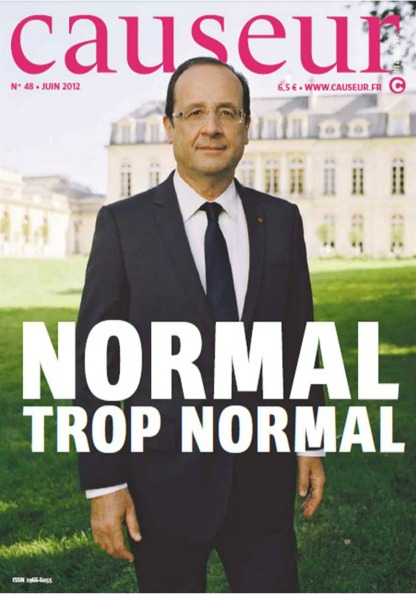Deux événements particulièrement atroces se sont déroulés entre fin mai et début juin. À Miami, un homme nu s’est jeté sur un SDF pour lui dévorer le visage. La police a dû utiliser toute sa puissance de feu pour l’abattre, l’homme continuant sa besogne malgré les balles qui le frappaient. Ensuite, dans le New Jersey, un autre homme, que la police venait arrêter chez lui, a menacé de s’éventrer avec un couteau de cuisine. Non seulement, il l’a fait, mais il s’est ensuite défendu en lançant sur les assaillants des morceaux de ses propres intestins.
Décrits avec la brutalité de dépêches d’agence, ces faits divers provoquent le même effroi et le même écœurement que le cinéma gore américain, né au début des années 1960. Le genre a donné quelques chefs-d’œuvre qui, au-delà des sensations fortes recherchées par un public essentiellement adolescent, relèvent de la critique sociale.[access capability= »lire_inedits »] Ainsi, les films de George Romero, comme La Nuit des morts-vivants ou Zombie crépuscule, dénoncent une certaine aliénation moderne à travers la figure du zombie qui attaque les vivants pour s’en nourrir tout en continuant mécaniquement à se rendre au supermarché ou au travail.
Devant les faits divers de Miami et du New Jersey, on a l’impression que le monde de Romero est devenu le nôtre. On se demande s’il faut se préparer à une forme d’apocalypse zombie pour laquelle, par ailleurs, ont déjà été écrits, aux États-Unis, des manuels de survie, parfois sérieux, parfois ironiques, comme l’excellent Guide de survie en territoire zombie[1. Calmann-Lévy.] de Max Brooks.
Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas de faire ici le énième procès de l’influence des images violentes sur les comportements (l’un des criminels cités plus haut était, semble-t-il, sous l’emprise d’une nouvelle drogue, et l’autre souffrait de troubles mentaux), mais plutôt de chercher une référence permettant de comprendre l’horreur indicible. De même qu’il est difficile, dans un registre plus aimable, d’assister à un coucher de soleil ou de distinguer une cathédrale dans la brume du matin sans penser à Monet qui les a vues mieux que tout le monde, le cannibale de Miami et l’auto-éventreur du New Jersey évoquent irrésistiblement le cinéma gore. En revanche, le « dépeceur de Montréal », qui avait démembré son amant chinois pour en expédier les restes à différents partis canadiens et publié sur Internet le film de son sinistre ouvrage (il fut arrêté en Allemagne) renvoie plutôt aux films à grand succès mettant en scène un serial-killer, le chef-d’œuvre du genre étant Le Silence des agneaux, de Jonathan Demme, dans lequel Jodie Foster affrontait Hannibal-le-cannibale, interprété par l’inoubliable Anthony Hopkins.
Répétons-le : toute ressemblance entre ces œuvres et des faits véridiques ne saurait être que fortuite. Mais on sait, depuis Oscar Wilde, que « la nature imite l’art ». Sans aller jusqu’à prendre cette phrase au pied de la lettre, on admettra que, quand la réalité dépasse la fiction, la fiction peut éclairer la réalité.
Peut-être existe-t-il un point commun entre ces trois crimes d’une atrocité spécifique et tant d’autres qui, depuis quelques années, envahissent nos écrans et les colonnes de nos journaux : leurs auteurs semblent tous rechercher, de manière désespérée, aberrante, monstrueuse, à retrouver leur propre corps, dans des automutilations délirantes ou dans la mutilation de l’autre, soit en le torturant, soit en le mangeant, purement et simplement.
Nous sentons tous, obscurément, que notre civilisation ne cesse de se virtualiser. La rapidité des échanges, le présent perpétuel imposé par Internet, l’impossibilité de plus en plus grande de penser l’avenir, de se souvenir du passé, même proche, les réseaux sociaux avec leurs « amis » que l’on ne voit jamais et qui ont remplacé, pour toute une génération, le journal intime : autant de phénomènes qui, insensiblement, dissolvent non seulement la réalité, mais nos propres personnes. Ici, c’est la littérature qui fournit des clés pour accéder au réel. En effet, dès les années 1950, quelques grandes plumes de la science-fiction ont anticipé l’effacement du réel et de l’identité face à la technologie. Il faut lire par exemple les romans ou nouvelles de Philip K. Dick comme Ubik, La Vérité avant-dernière, Souvenirs à vendre, où il annonce déjà ce qu’analyseront par la suite Guy Debord ou Jean Baudrillard. Écoutons Debord : « Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels, et les motivations efficientes d’un comportement hypnotique. » Ces lignes datent de 1967, mais quiconque a observé des compétitions de joueurs en ligne ou des traders dans une salle de marché sait ce qu’est un « comportement hypnotique »[2. À ce propos, intuition intéressante de Bret Easton Ellis dans son célèbre American Psycho, qui campe un golden boy des années 1980, égaré dans une économie virtuelle et une consommation délirante de marques de luxe, en tueur en série particulièrement sadique.]. Baudrillard, lui, insiste sur un autre aspect : « L’espèce humaine a inventé un mode spécifique de disparition qui n’a rien à voir avec la loi de la nature. Peut-être même un art de la disparition. »
Quand on finit par douter de son existence même, qu’on est au-delà du solipsisme pourtant conceptualisé par Schopenhauer comme le stade ultime de l’enfermement sur soi et le refus de concevoir que l’autre puisse exister en dehors de sa conscience, la souffrance est telle qu’il faut absolument, et de toute urgence, récupérer un corps et se prouver qu’il existe.
J’ai été frappé, ces dernières années, par la généralisation du tatouage et du piercing dans toutes les classes sociales, ou presque, et toutes les générations. Ce qui était autrefois réservé à quelques amateurs sado-masochistes, aux marins, aux routiers, aux soldats des unités d’élite, aux taulards, est apparu chez la jolie lycéenne de bonne famille au visage angélique. Il y a quelques années, le regretté Thierry Jonquet avait consacré un de ses grands romans, Ad Vitam aeternam[3. Seuil.] , à cette mode de la scarification parfois poussée à l’extrême. Là aussi, dans ce roman, il était question de « se sentir » exister au sens physique du terme.
De fait, le cauchemar semble s’être généralisé. Une publicité récente pour une voiture montre une mère BCBG allant chercher sa fille à l’école. Quand celle-ci s’assoit, la mère aperçoit un tatouage sur le dos de la gamine. Elle feint d’être en colère avant de lui montrer en riant le sien, tout au bas du dos, en lui disant : « Voilà un vrai tatouage ! » Je ne sais pas pourquoi − ou plutôt si, je sais −, mais cette scène m’effraie autant que l’idée d’un type nu mangeant en pleine rue un SDF. Bien sûr, de la pub au crime, ce n’est pas le même degré de violence. Mais c’est la même nature. L’obscénité en plus.[/access]
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !