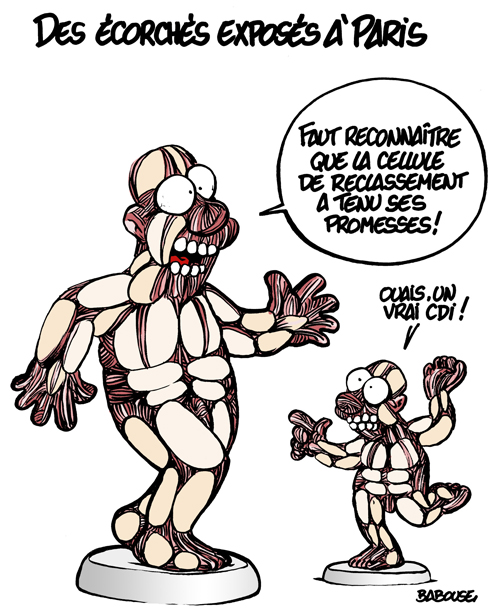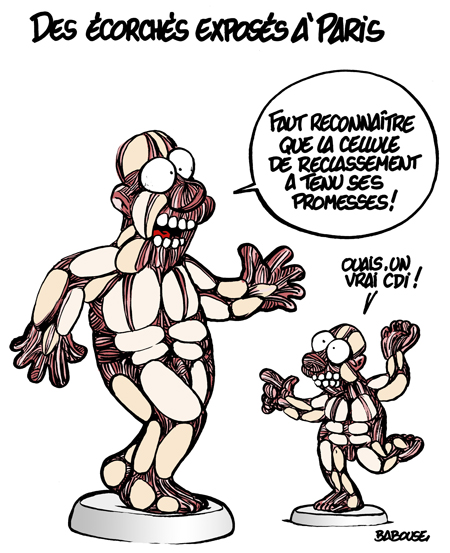Premiers à avoir sombré dans la crise économique et à y précipiter le reste du monde, les Etats-Unis d’Obama sont aussi pionniers pour s’y coltiner. À part le nom, le plan de relance signé par le président américain le 17 février n’a pas grand-chose de commun avec ses équivalents européens ni avec les précédents plans américains. La nouvelle Administration prend à bras-le-corps l’ensemble des dimensions de la crise. Elle a la volonté, la crédibilité et elle met le paquet.
Des plans de relance, nous en voyons par wagons depuis septembre dernier. Avec des résultats pour le moins décevants. On me dira que c’est un peu tôt pour se prononcer. Le problème, c’est que même ceux qui ont concocté ces plans semblent sceptiques quant à l’efficacité de leurs mesurettes puisqu’ils ne cessent d’en annoncer de nouvelles.
Pour juger de l’efficacité d’un plan de relance, il faut se poser six questions : Prend-il en compte l’ensemble des difficultés ? S’attaque-t-il à tous les secteurs d’activité touchés ? Comment est-il financé (argent public/argent privé) ? Les moyens consacrés sont-ils à la hauteur ? Le caractère foncièrement mondial du problème est-il traité ? Enfin, qu’en est-il de la dimension politique du phénomène ? Ce dernier point est crucial : la mobilisation des nations derrière leurs gouvernements est une condition sine qua non pour une sortie de crise. Pour cela, il faut que les peuples aient confiance et qu’ils aient le sentiment que le fardeau sera équitablement partagé. Bref, la crise a beau être mondiale, la réponse dépend des Etats – donc des nations.
Les mesures engagées par l’administration Bush innovaient déjà par les moyens mobilisés et le fait qu’elles marquaient une rupture radicale avec l’idéologie dominante (et la politique) que le staff de W. incarnait jusque-là. Leur principal défaut était un énorme déficit en crédibilité, même si on peut difficilement reprocher à l’équipe Bush de s’être focalisée sur la dimension financière : il lui fallait jouer les pompiers de service. De plus leur responsabilité en aval dans la création de la situation catastrophique a ôté beaucoup d’efficacité à leurs actions. Et de toute façon, on avait affaire à des mesures prises par une Administration en fin de course.
Avec le nouveau plan piloté par le trio Obama, Geithner (au Trésor), Bernanke (à la tête de la Réserve fédérale), les Etats-Unis passent à la vitesse supérieure. Tout d’abord, par l’importance de moyens mobilisés, 787 milliards de dollars annoncés, mais en réalité deux, voire trois fois plus, si on comptabilise tout. L’Administration Obama lance la mère de toutes ses batailles : elle s’attaque en même temps à la crise financière et aux questions d’offre et de demande. À la fameuse « banque de mauvais crédit » qui rachètera (avec l’argent public) les prêts problématiques pour purger les bilans des banques, échoit l’assainissement du marché du crédit. La réponse à l’essoufflement de la demande consistera en aides massives aux consommateurs et aux PME. Quant à la crise immobilière, le séisme qui a déclenché le tsunami, elle sera contrecarrée par un ensemble de dispositifs d’aide aux propriétaires endettés. Plus généralement, une baisse des impôts soulagera un peu les autres débiteurs, surtout dans le domaine des cartes de crédit, un autre champ de mines à traiter d’urgence. Last but not least, on lancera une blitzkrieg sur le front de l’investissement avec comme objectif très ambitieux de jeter les bases (si possible avant les prochaines élections en 2012…) d’une croissance fondée sur l’éducation, la santé et les nouvelles formes d’énergie. Par cet ensemble des mesures budgétaires et monétaires coordonnées, la Fed et le Trésor se mettent ensemble en ordre de marche sous commandement commun.
Avec des dépôts de munitions bien garnis, les Etats-Unis lancent donc une offensive simultanée et coordonnée sur tous les fronts, sans attendre par exemple que l’assainissement nécessaire des bilans du système bancaire ou les investissements massifs portent leurs résultats en matière consommation et d’emploi. Il s’agit de ne pas gâcher l’élan crée par l’élection d’Obama.
Précisément, pour harnacher et pérenniser cette incroyable énergie politique, le nouveau président introduit une innovation majeure – la campagne électorale perpétuelle. Ainsi, représentants et sénateurs républicains et autres récalcitrants ont été soumis à une pression conjuguant lobbysme traditionnel et spots à la télé. Parallèlement, les réseaux de supporters et militants tissés et mobilisés pendant les primaires et la campagne présidentielle restent toujours sur le pied de guerre.
Seul bémol – et pas des moindre – Washington semble sous-estimer les risques liés à la dette publique. L’Etat, jadis providence et aujourd’hui providentiel peut effectivement plus qu’on ne le croyait il y a à peine un an, mais moins que beaucoup semblent le penser maintenant. Un scénario de chute brutale du dollar suite à un endettement public abyssal ne peut être totalement exclu. Mais il n’y a pas le choix.
Reste le talon d’Achille des armées engagées pour sauver l’économie mondiale : la coordination internationale. La stratégie d’Obama tient la route mais l’articulation avec les plans de guerre des autres pays, « le chainon manquant » de la gestion de cette fichue crise, reste à trouver. Ce week-end à Berlin, les membres européens du G20 en ont donné une preuve supplémentaire. Le commerce international et les écarts entre les excédents gigantesques de quelques pays et les déficits abyssaux de nombreux autres, pourtant au cœur du problème, n’ont pas été traités. On s’est satisfait d’un chapelet de vœux pieux, essentiellement des mesures contre les paradis fiscaux et les hedges funds et une réglementation accrue des acteurs des marchés. Tout cela n’est pas de bon augure pour le G 20 du 2 avril à Londres.
L’Europe en est encore à mobiliser ses troupes en ordre dispersé et avec des moyens relativement faibles même quand on cumule tous les efforts nationaux. Les divergences entre Français et Allemands qui n’ont pas du tout le même point de vue sur le système économique européen et mondial n’arrangent rien. Il ne s’agit nullement d’abdiquer toute marge de manœuvre nationale, mais il est difficile de nier qu’un certain nombre de décisions doivent être coordonnées, en particulier celles par lesquelles les Etats protègent leurs emplois – donc leurs peuples. Les premiers signes inquiétants sont déjà manifestés : les différentiels de taux d’intérêt entre les différents pays de la zone euro – la Grèce par exemple paye des intérêts supérieurs de 2,4 points à ceux de l’Allemagne. D’autre part, la menace de récession est encore plus importante de ce côté de l’Atlantique : autant de clignotants rouges vif qu’il ne faut plus ignorer. L’Europe aussi a besoin d’un New Deal.