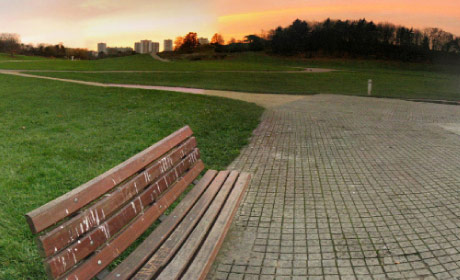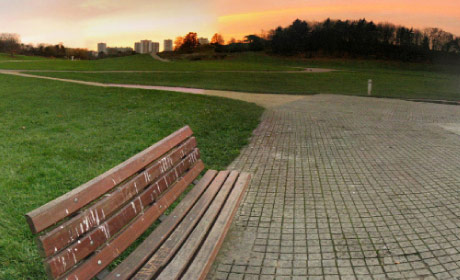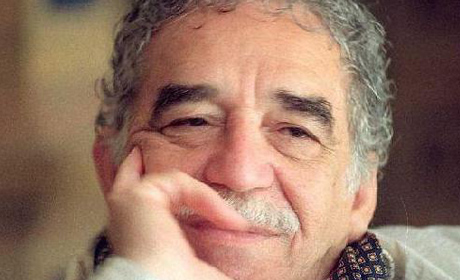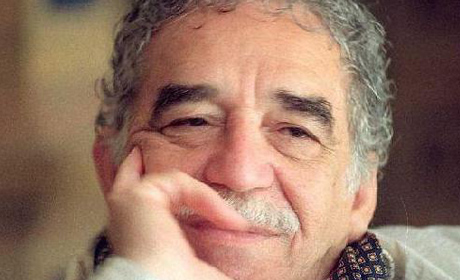Un journaliste français, Mustapha Kessous, a publié, dans Le Monde du 23 septembre, un témoignage sur son expérience du racisme. Toute sa vie, cet homme a encaissé des marques d’hostilité, de rejet, de méprises humiliantes parce qu’il a un visage et un nom « à consonance étrangère ». Son récit montre combien il peut être douloureux, en France, d’être d’origine arabe quand on se heurte à des gens qui ne prennent pas la peine d’apprécier un homme sur sa présentation, son respect, sa politesse ou son sérieux, quand on provoque la méfiance du fait de sa naissance.
Mustapha Kessous a rencontré des Français qui, refusant de pratiquer la discrimination nécessaire pour distinguer le voyou de l’honnête homme, en appliquent une autre sur des critères raciaux. Le journaliste ne tire de ces avanies aucune conclusion et ne juge personne. Mais on pourrait y voir la peinture d’une France raciste, ignorante et victime de préjugés. En entrant dans la réalité des choses, on comprend que certaines réactions, présumées racistes, sont le fruit de l’expérience vécue. Si certains voient en tout Arabe un « zyva » faiseur d’embrouilles, c’est peut-être parce ceux qu’ils voient sont souvent à la fois l’un et l’autre. Les bons payent pour les méchants.
[access capability= »lire_inedits »]Qui se scandalise quand la police de la RATP surveille des bandes de jeunes Roumains ou Roumaines dans le métro ? Est-ce par préjugé raciste ? Si on est honnête, on comprend que ça ne se passe pas comme ça.
Peut-on sérieusement accuser des policiers dont la mission est − entre autres − d’arrêter des immigrés clandestins, de pratiques racistes quand ils contrôlent des étrangers ou des Français qu’ils prennent pour des étrangers ? Les vigiles, dans les supermarchés, qui observent particulièrement les Arabes et les Noirs, font-ils preuve de préjugés racistes ou d’une connaissance empirique de leur prochain ? Les prisons, elles, sont pleines de Français post-jugés dont les deux tiers sont d’origine maghrébine ou subsaharienne. Les juges qui mettent tout ce monde-là derrière les barreaux ne semblent pas noyautés par le Ku Klux Klan.
Il n’est pas raisonnable de jeter l’opprobre sur les policiers ou les vigiles qui contrôlent au faciès. En langage de flic, ça s’appelle du profiling : on arrête moins les dames à caniche que les jeunes à capuche parce que, statistiquement, les dames à caniche sont moins délinquantes que les jeunes à capuche. Tous les artisans que je connais me disent : « On ne fait pas d’affaires avec les Manouches. » Et cette résolution ne porte ni haine, ni préjugé mais une large palette de sentiments qui vont jusqu’à la tendresse, et tout sauf de l’ignorance.
Lorsque nous abordons des hommes et des femmes en tenant compte de leur origine dans la bienveillance, la méfiance voire la neutralité, sommes-nous racistes ? Il paraît qu’un Asiatique a plus de chance qu’un Arabe d’être employé comme salarié dans bien des entreprises, même si les deux présentent aussi bien. Les Chinois, en France, ne disent pas souffrir de racisme. Faut-il en conclure que les Blancs préfèrent le jaune à toutes les autres couleurs ?
En Autriche, une hôtelière a répondu à une demande de réservation : « Nous avons eu de mauvaises expériences, aussi nous n’acceptons plus de clients juifs. » Cette brave dame, qui n’avait peut-être jamais vu jusque-là de juifs dans ces contrées, a peut-être subi un défilé de familles séfarades qui l’ont empêchée de dormir toute une saison. Doit-on la considérer comme antisémite si elle préfère, depuis, accueillir des retraités anglais ?
Il faut se demander d’où vient la mauvaise réputation qui s’attache à certains groupes de Français, et qui pèse sur tous leurs membres sans discrimination. Pas seulement de la délinquance. Les comportements culturels sont souvent à l’origine de la prise de distance des uns par rapport aux autres. Les réactions qui naissent des frictions sont souvent décrétées racistes, mais la question de la race est dépassée par une autre qui a plus à voir avec la culture de chacun.
Racistes, les professionnels de l’immobilier qui, quand ils osent encore, expliquent que les différences de modes de vie dans la société multiculturelle rendent parfois la cohabitation difficile ? Le principe de précaution prévaut et on pénalise des familles parfaitement courtoises et civiles en leur refusant des logements. Il arrive aussi que le discernement d’un bailleur ou d’un propriétaire permette à des personnes de toutes origines de partager dans la cordialité des immeubles avec des Français plus blancs. Raciste, le chauffeur de taxi tunisien qui a confié à une amie qu’il ne prenait plus d’Arabes le soir ? Tous ceux qu’il avait pris n’avaient pas fait des problèmes mais, à chaque fois qu’il avait eu des problèmes, c’était avec des Arabes. Racisme ou prudence – forcément − mal placée ?
Les Français, quelles que soient leurs origines, bénéficient des mêmes droits. Si certains groupes sont, plus que d’autres, victimes de rejet, il faut peut-être en chercher la cause ailleurs que dans un racisme français. Les communautés de Hollandais qui font revivre des villages abandonnés dans des régions reculées, ouvrent des gîtes ou des restaurants, sont plutôt bien vues. Si demain, certains de leurs membres se faisaient remarquer pour leurs incivilités, leurs pratiques délinquantes ou criminelles, on verrait monter chez leurs voisins ce qu’on appellerait un peu vite un racisme anti-hollandais. Si les pratiques culturelles de ces protestants bataves traduisaient un rejet de la culture française, si leurs enfants affichaient fièrement leur haine de la France, la méfiance et la défiance monteraient sûrement dans la population autochtone.
L’image pour le moins contrastée qui colle aux populations musulmanes plane, qu’il le veuille ou non, au-dessus de Mustapha Kessous. C’est une injustice. Ils sont des millions à en souffrir. Faut-il éduquer la majorité des Français à l’antiracisme et leur inculquer l’abolition de la méfiance ? Certaines communautés doivent-elles s’attacher à redonner confiance ? Lequel de ces deux mouvements sera le plus susceptible de mener tous les groupes humains qui composent la nation vers un authentique vivre-ensemble ? Je vous laisse juges.[/access]