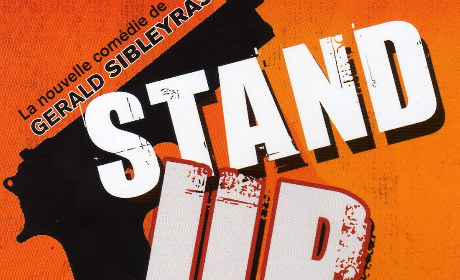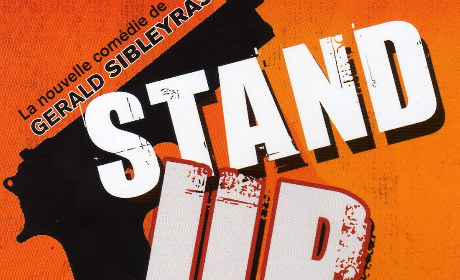Tomber à gauche ou pantoufler à droite ? Tel est le dilemme auquel est aujourd’hui confronté notre flamboyant ministre des Affaires étrangères. Il vient d’apporter sa contribution à la pièce de théâtre microcosmique mise en scène par un Nicolas Sarkozy qui a fixé, avec une prématurité diaboliquement calculée, l’horizon du prochain remaniement gouvernemental.
Comment partir la tête haute, et éventuellement rebondir, pour ceux qui n’ont aucune illusion sur le sort qui leur est réservé dans quelques semaines ? La méthode Kouchner relève de la comédie légère : il laisse traîner négligemment une lettre de démission manuscrite sur son bureau en recevant un journaliste d’un hebdo où il compte beaucoup d’amis. Quelques bribes de la missive se retrouvent illico sur le site internet du Nouvel Obs, car c’est de lui qu’il s’agit, et le microcosme médiatique et politique se met à vibrionner. À l’Elysée, on feint la surprise : lettre de démission ? Quelle lettre de démission ? Jamais reçue ! N’empêche, le message est passé, et son contenu est limpide : moi, Bernard Kouchner, détenteur d’un capital de popularité inoxydable dans l’opinion publique ne saurais être licencié comme un vieux serviteur devenu inutile. Je peux encore mordre, et je le prouve en mettant en cause des conseillers du président qui m’auraient « humilié ». Mais, si on me réserve, à ma sortie du Quai d’Orsay, une fonction et un palais de la République à la hauteur de mes mérites éminents, on pourra revoir la question de mon attitude lors de l’élection présidentielle de 2012.
Une addiction médiatique que l’âge n’a pas affaiblie
Défenseur des droits ? Pourquoi pas ? Bien logé, convenablement rémunéré, utilisable pour rendre service à des amis, ce poste de médiateur de la République vient d’être renforcé par l’intégration du « Défenseur des enfants », au grand dam de son actuelle titulaire, Dominique Versini. Et surtout, mieux que Jean-Paul Delevoye, Bernard Kouchner saura utiliser cette fonction pour se porter régulièrement aux avant-postes médiatiques, une addiction que l’âge n’a pas affaiblie, bien au contraire.
La gauche n’épargne pas ses quolibets à celui qui fut, naguère, sa tête d’affiche morale avant de se laisser séduire par les sirènes du sarkozysme. Principale incarnation de la politique d’ouverture du Sarkozy de 2007, il a eu la faiblesse, ou la vanité, de croire qu’il allait vraiment exercer la fonction de ministre des Affaires étrangères. Pour cela, Nicolas Sarkozy avait déjà tout ce qu’il lui fallait à la maison, notamment le redoutable Jean-David Lévitte, dont la proverbiale discrétion se double d’une connaissance approfondie des rouages de la politique mondiale. L’usage de Bernard Kouchner dans le dispositif sarkozyste était purement récréatif : il fallait au président un compagnon qui le distraie lors de ses multiples et souvent assommants déplacements à l’étranger. Il est incontestable que l’ami Bernard excelle en la matière : on ne s’ennuie jamais avec lui, il a de l’humour, de la répartie et un convenable stock d’histoires drôles pour détendre l’atmosphère lors des arides sommets européens, ou réunions des G8, 20 ou plus si affinités.
Mais pour ce qui était des choses sérieuses, la hard policy, celle où le réalisme l’emporte toujours sur les bons et grands sentiments, on lui fit gentiment, puis plus fermement, savoir qu’il devait se tenir à sa place, et laisser faire les professionnels, officiels et officieux, dont le président avait pris grand soin de s’entourer. À Guaino le grand projet (aujourd’hui en quenouille) d’Union de la Méditerranée, à Lévitte la délicate relation avec Washington et les grandes négociations internationales, à Guéant les palabres avec la Syrie pendant que Kouchner croit pouvoir jouer sa carte personnelle au Liban. Quand les choses se gâtent en Afrique, c’est à un avocat libanais, Robert Bourgi, que l’on confie la mission d’arranger les bidons avec Laurent Gbagbo ou Ali Bongo. Quand le torchon brûle avec Pékin à cause des manifestations parisiennes contre le passage de la flamme olympique, Jean-Pierre Raffarin est dépêché dans l’Empire du milieu pour arrondir les angles.
Une bonne manière : Ockrent à France 24
Comme on n’est pas des brutes, tout de même, à l’Elysée on concède au ministre en titre le pouvoir de placer quelques un(e)s de ses ami(e)s à des postes diplomatiques aussi agréables à vivre que bien rémunérés. C’est bien le moins, et Nicolas Sarkozy, de surcroît, vole au secours de Kouchner lorsqu’il est mis en cause par Pierre Péan pour des « affaires africaines » qui ne relèvent pas seulement de l’altruisme mondialiste du french doctor. La nomination de sa compagne Christine Ockrent, en tandem avec Alain de Pouzilhac à la tête de l’audiovisuel extérieur français (RFI et France 24) était encore une bonne manière faite à Bernard, en dépit du fait que cette nomination altérait notablement la crédibilité de ces médias dans des pays où on se méfie de la connivence de la presse et du pouvoir[1. La reine Christine, bien connue pour semer la zizanie dans toutes les rédactions qu’on a la mauvaise idée de lui confier, a fini par tellement exaspérer Alain de Pouzilhac que ce dernier est venu récemment demander sa tête à Nicolas Sarkozy. Sans succès, pour le moment]
Tout cela, Bernard Kouchner fait mine de le découvrir alors qu’il semble plus près de la sortie que de l’augmentation. Foin de fausse modestie : dès juillet 2008, je constatais, pour le déplorer, le statut de potiche de luxe (au moins du Sèvres, il n’y a que ça au Quai) que l’on faisait jouer à Bernard Kouchner. Cela me valut un coup de téléphone furibard de son directeur de cabinet, à l’époque Philippe Etienne, qui me gratifia d’un certain nombre de noms d’oiseaux rarement utilisés par les diplomates de carrière.
Pour être un grand ministre des Affaires étrangères, ou plus modestement un bon ministre, il faut être une franche crapule comme Talleyrand ou Roland Dumas ou un technicien retors comme Hubert Védrine. Et surtout servir un président doté d’une intelligence du monde et des hommes lui permettant d’utiliser au mieux les quelques atouts dont notre pays dispose encore pour faire valoir ses intérêts sur cette planète. Bernard Kouchner ne relevant d’aucune des catégories précitées, le souvenir de son passage au Quai d’Orsay relèvera davantage de l’histoire de la vie mondaine à Paris au début du XXIème siècle que de celle de la diplomatie planétaire pendant la même période.