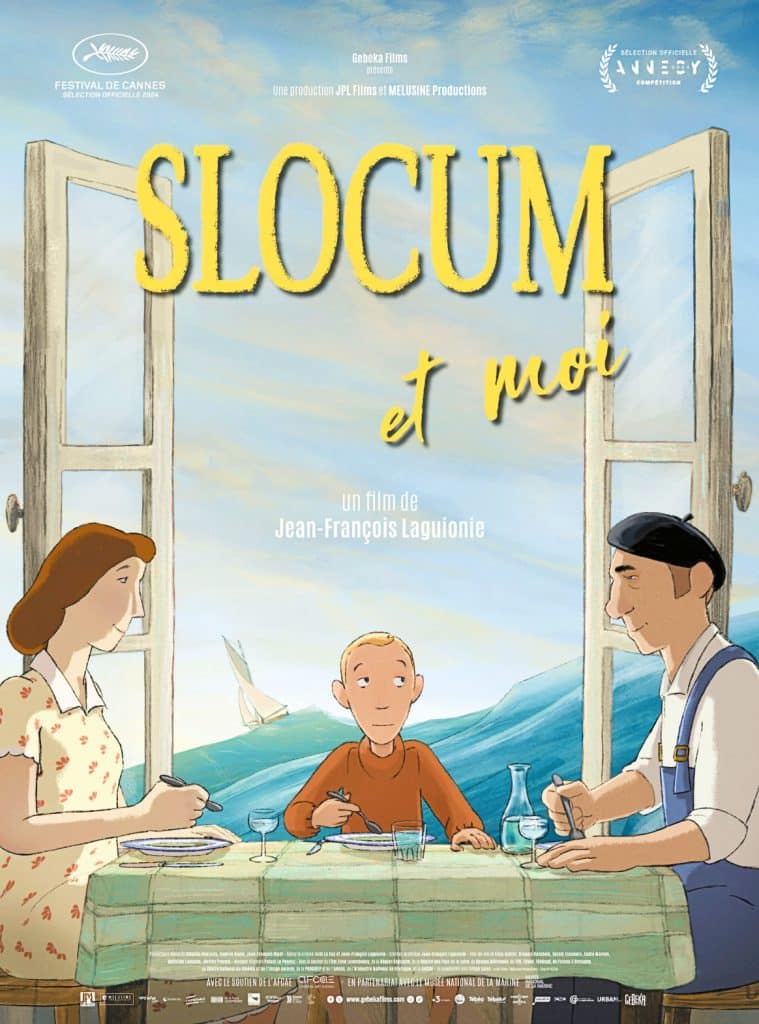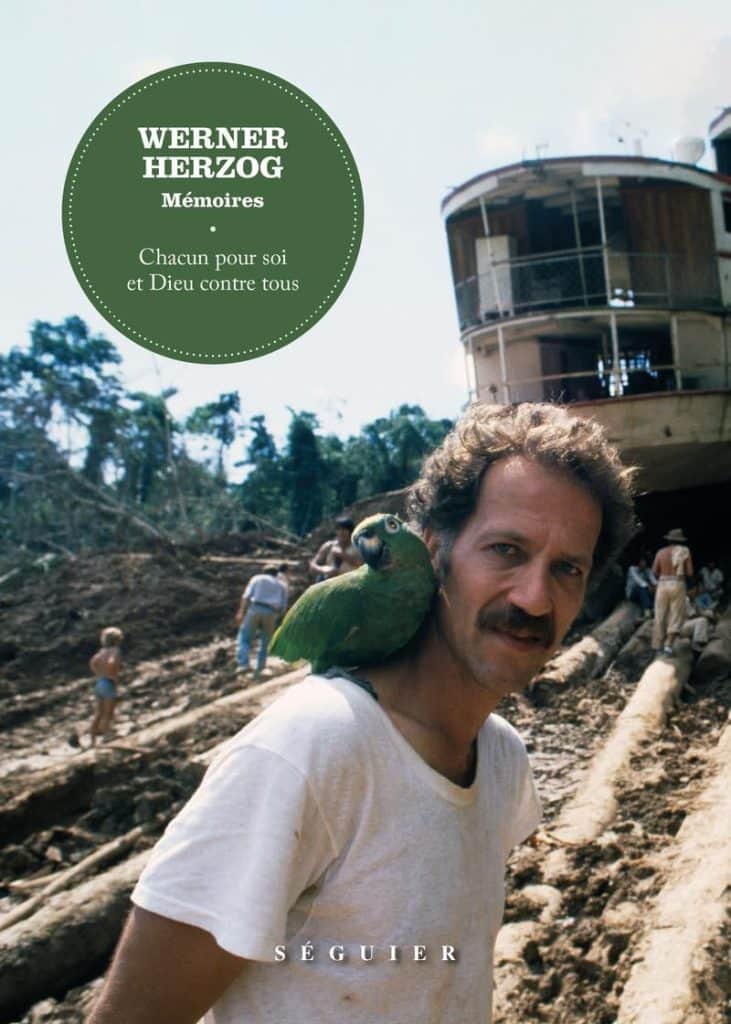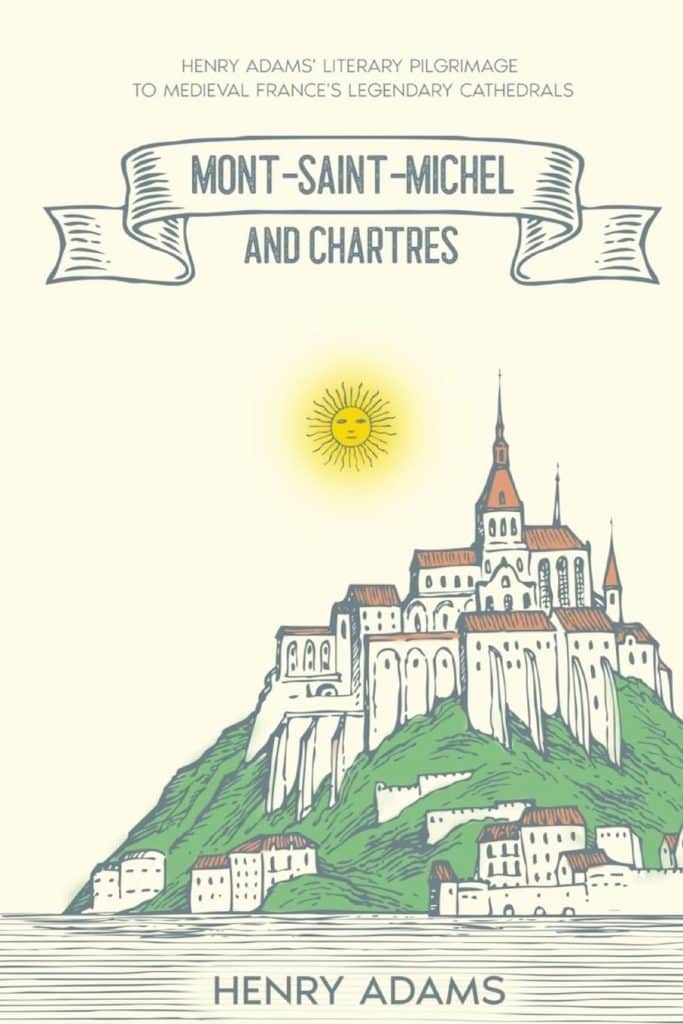Patrice Jean et Bruno Lafourcade ont commencé à se lire sans se connaître. Puis ils se sont écrit. Les Mauvais fils compile cet échange épistolaire entre deux écrivains qui ont, chacun à sa manière, déclaré la guerre à leur époque. Leur plume et leur humour prouvent que la correspondance littéraire n’est pas morte !
Sous l’hégémonie du progressisme et sur une scène littéraire qu’aseptisent la bien-pensance et le politiquement correct, le verbe périclite, la parole s’assèche. On ne se parle plus, on n’échange plus. Tout au plus s’envoie-t-on quelques signaux de pâle fumée aussitôt dissipés par les vapeurs toxiques du temps. On était donc résigné : on croyait les grandes correspondances littéraires, où s’échangent les idées avec la chair des mots, reléguées dans le passé. La correspondance de Flaubert repose dans les volumes de la Pléiade ; quant à Chardonne et Morand, ils ne s’écrivent plus depuis longtemps.
Nous voici heureusement détrompés avec Les Mauvais Fils. Patrice Jean et Bruno Lafourcade nous offrent un choix de lettres qu’ils se sont écrites ces dernières années. L’échange débute en 2017, année où, entrant tous deux dans la cinquantaine, ils se lient d’amitié et, « avec des fortunes diverses, tentent de sortir de l’ombre et de leurs nuits jumelles » ; il s’achève en 2022. Dans cette relation épistolaire, « on parle boutique » bien sûr, et on cause du monde littéraire. Mais surtout, on cherche à se connaître pour comprendre l’autre, son semblable et son frère. Et au-delà des anecdotes savoureuses, cette correspondance invite à se regarder soi-même avec autodérision. On pense également à Montaigne : « Qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition. »
Dans La Vie des spectres, le dernier roman de Patrice Jean, un modeste héros oppose le bon sens à la bêtise contemporaine. Quant à Bruno Lafourcade, il a publié, avec le réalisateur Laurent Firode, Main basse sur le cinématographe, un essai qui torpille les lieux communs et les fables qui innervent le milieu du cinéma.
Après les avoir lus, Causeur les a fait parler.
Causeur. Comment est née votre amitié ?
Patrice Jean. J’ai été le premier à écrire à Bruno, via Messenger : j’avais lu son essai sur le suicide et voulais le féliciter. Je crois qu’il est la seule personne que j’aie jamais contactée de cette façon ! C’était le bon moment, nous allions tous les deux publier un nouveau roman auquel nous attachions beaucoup d’importance. Nous avons constaté que nous étions nés la même année, et que nous avions eu des parcours à la fois suffisamment proches et différents pour nous comprendre, confronter notre expérience.
Bruno Lafourcade. Patrice allait publier L’Homme surnuméraire et moi L’Ivraie… La naissance de notre amitié mêle les deux mondes, l’ancien (celui des bibliothèques) et le nouveau (celui d’internet) : nous avons lu nos livres, puis nous avons fait connaissance sur les réseaux sociaux. Ce qui nous a rapprochés, c’est l’âge, les origines, la situation sociale et nos ouvrages.

À travers vos déboires et vos réussites, votre correspondance offre un panorama de la vie littéraire, avec ses figures indispensables (éditeurs, critiques), mais aussi ses « petites mains » (correcteurs, bibliothécaires, etc.).
B. L. D’un certain point de vue, c’est un livre sur l’adversité, sur l’humiliation, et, pour ma part, sur une certaine conception pugilistique de l’existence, y compris littéraire. On se heurte, surtout, quand on est jeune, à ceux qui considèrent la volonté d’écrire comme une occupation dérisoire ou prétentieuse. On le ressent comme la négation de ce que l’on est, d’autant qu’une part de soi donne raison à cette négation. On écrit contre tous ceux qui s’y opposent : parents, collègues, éditeurs, journalistes, libraires ou correcteurs, et nous en donnons effectivement des exemples dans Mauvais Fils.
P. J. Je partage cette analyse. Avant d’être publié, un apprenti écrivain vit dans l’humiliation de ses ambitions littéraires, que Gombrowicz définissait, avec simplicité, comme l’aspiration à devenir plus important que les autres. Après la publication, on se heurte, contre toute attente, à des centaines de malentendus : je pensais me faire comprendre, et, en bien des circonstances, j’ai observé qu’il n’en était rien. C’est pourquoi il faut sans cesse remettre son ouvrage sur le métier.
Si beaucoup de choses vous rapprochent, on note aussi des différences littéraires : Patrice Jean est essentiellement romancier alors que Bruno Lafourcade a aussi publié des chroniques, des essais, des pamphlets…
B. L. Il y a entre nous des différences de caractère : je suis plus sanguin et impatient que Patrice. Il en ressort des différences dans les genres littéraires : j’aime bien les pamphlets, Patrice n’en a jamais écrit ; je préfère le bref au long : je n’ai pas écrit de roman de l’ampleur de ceux de Patrice. Pour le reste, il a aussi publié un essai, des nouvelles, des articles de revue, de sorte qu’il n’a pas que le roman à son arc.
P. J. Pas mieux, comme on disait à « Des chiffres et des lettres » !
Vous n’avez pas mené la même vie : Patrice Jean, vous êtes professeur de lycée ; Bruno Lafourcade, vous avez un itinéraire moins régulier, plus marginal. Vos parcours ont-ils influencé votre vie d’écrivain ?
P. J. J’aurais aimé publier plus tôt, j’ai même longtemps cru qu’il était trop tard. J’avais embrassé la carrière de professeur en pensant qu’elle me laisserait le temps d’écrire : ce fut loin d’être le cas, elle m’a épuisé. J’ai remonté le courant, avec l’énergie du désespoir, pour commencer à écrire sérieusement.
B. L. Nous avons l’un et l’autre publié des livres assez tardivement. Je voulais vivre avant d’écrire, et ce fut assez chaotique. Puis j’ai appris à écrire, et comme je ne suis pas bien malin, ça m’a pris du temps. Mais une fois que j’ai su écrire, ça m’a amusé de continuer.
La question de la transmission, du passage de témoin d’une génération à une autre revient souvent dans votre correspondance. Que vous a transmis la génération précédente (vous évoquez notamment Finkielkraut et Muray) et que transmettrez-vous à celle qui vous succédera ?
P. J. La génération précédente nous a appris à lire, à compter, puis, comme l’écrit Bruno dans Une jeunesse les dents serrées, elle nous a jetés dans la vie, sans jamais nous aider. Pour la génération suivante, notre génération n’existe pas : nous sommes déjà, à leurs yeux, des « boomers », et l’ensemble de l’humanité, au fond, n’est qu’une vaste espèce de boomers.
B. L. (Rires) C’est vrai : tout ce qui est plus âgé qu’elle, morts ou vivants, est constitué de boomers. Quant aux vrais boomers, c’est la génération Moloch : elle a cherché à tuer les fils, après avoir tué le père. Puis, elle a préféré transmettre à ses petits-enfants plutôt qu’à ses enfants ; donc la génération qui vient n’a que faire de nous. Elle est déjà au pouvoir.
Votre abordez aussi le travail, l’école, jusqu’au foot et la télé-réalité ! L’un de vous parle également de la douleur qu’il a éprouvée en regardant un film des années soixante-dix. L’un l’explique par « l’inévitable nostalgie de notre jeunesse », l’autre par « la disparition de l’humilité ». Pouvez-vous nous en dire davantage ?
B. L. C’était La Femme d’à côté. Truffaut me laisse plutôt indifférent, comme la Nouvelle Vague en général, où je n’aime vraiment que Paul Gégauff. Devant ce monde englouti, où des Odile et des Roland, parlant un français simple et naturel, vivent dans un village paisible de l’Isère, j’ai eu le cœur serré par tout ce que nous avions perdu, qui était un rapport pacifié et humble à l’espace, au corps et au langage : on parlait à voix basse, on s’habillait pour sortir, on tenait compte des autres…
P. J. Je pense aussi qu’il y avait, dans nos jeunes années, encore un souci de l’élégance, moins de tape-à-l’œil. La nostalgie est légitime : je regrette ma jeunesse, pas l’époque de ma jeunesse. Et la nouvelle génération, dans trente ans, regrettera les années 2020.
Vous ne portez pas un regard tendre sur notre époque. Comment la décririez-vous ?
P. J. Je n’aime pas beaucoup mon époque, mais je n’en aurais aimé aucune car, dans tous les siècles, toutes les régions, les imbéciles règnent en maîtres. Bruno est un hypersensible, toute bêtise le fout en rage. Il est plutôt du côté d’Alceste, et moi du côté de Philinte. Mais j’ai des attaques de misanthropie, comme d’autres ont des vapeurs.
B. L. Alceste et Philinte ? C’est bien possible… L’époque est passionnante et hystérique, fondée sur une inversion fondamentale : l’élève enseigne, le juge libère, le dominant s’imagine être dominé. Patrice évoque par exemple deux vertueuses, bien en cour, pensant droit comme une règle d’architecte, sans une incorrection dépassant de leur frange. Or ce sont elles, pour qui les micros et les journaux s’ouvrent comme la mer Rouge, qui font la leçon à Patrice, et lui reprochent de faire partie des dominants…
Ce que vous dites des femmes m’a beaucoup fait rire, bien que ce ne soit pas toujours très aimable. Il me semble cependant que vous les aimez. En fait, que leur reprochez-vous ?
P. J. Je préfère les femmes, car je les trouve plus jolies que les hommes.
B. L. Patrice est un extrémiste. Il y a quand même des femmes moches et des hommes beaux… « J’aime les femmes », c’est un mot de misogyne, de cynique : on n’aime personne quand on aime tout le monde. On aime toujours un homme ou une femme en particulier, « parce que c’est lui, parce que c’est moi », avec son visage, son rire, son intelligence. On aime la chair, parce que c’est aussi de l’esprit. On n’aime pas des abstractions. Mais, évidemment, certaines femmes se donnent du mal pour qu’on ne les aime pas. On en montre des échantillons dans ces pages.
L’humour est-il indispensable ?
P. J. Le rire est une réponse de perdants : c’est une façon de ne pas perdre la face en prenant des coups. J’ajouterai, et j’en suis persuadé, que tous les hommes sont des perdants et des ratés. Moi compris, bien sûr. Et toutes les femmes aussi, cela va de soi. Charlie Chaplin, dans Les Feux de la rampe, prétend que nous ne vivons pas assez longtemps pour devenir autre chose que des amateurs. Sans le rire, nous serions une espèce détestable.
B. L. Le rire est une vertu. Rien n’est efficace comme la satire pour mettre en perspective l’absurdité ou la violence d’une époque. C’est une des dimensions que j’aime dans les romans de Patrice.
Êtes-vous nostalgiques du « monde d’hier » au point de vouloir en laisser une trace dans votre œuvre ?
B. L. Je ne regrette pas le monde où l’on mourrait de la tuberculose à trente-cinq ans, où les ouvriers turbinaient douze heures par jour et où l’on crevait dans les tranchées. Je ne regrette pas non plus mon enfance ni mon adolescence ; je ne les revivrais pour rien au monde. Pourtant, oui, j’éprouve de la nostalgie. Je suppose que c’est un paradoxe. Mais ce que l’on peut souhaiter à un auteur, c’est en effet que ses livres conservent un peu de ce monde englouti.
P. J. Comme je l’ai dit, je suis nostalgique de ma jeunesse, au sens où, à cette époque, j’avais la vie devant moi. Aujourd’hui, l’air se raréfie, le temps restant à vivre diminue. Mais, comme Bruno et comme Dave : « Je ne voudrais pas refaire le chemin en arrière, et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant, le temps du bonheur, à l’ombre d’une fille en fleurs. » Notre monde est plus beau qu’il y a cent ans, pour les raisons dites par Bruno. Il est aussi plus laid, car l’art et la littérature y jouent désormais un rôle marginal.
À lire :
La vie des spectres - rentrée littéraire 2024 - prix Maison Rouge 2024
Price: 22,50 €
18 used & new available from 13,68 €