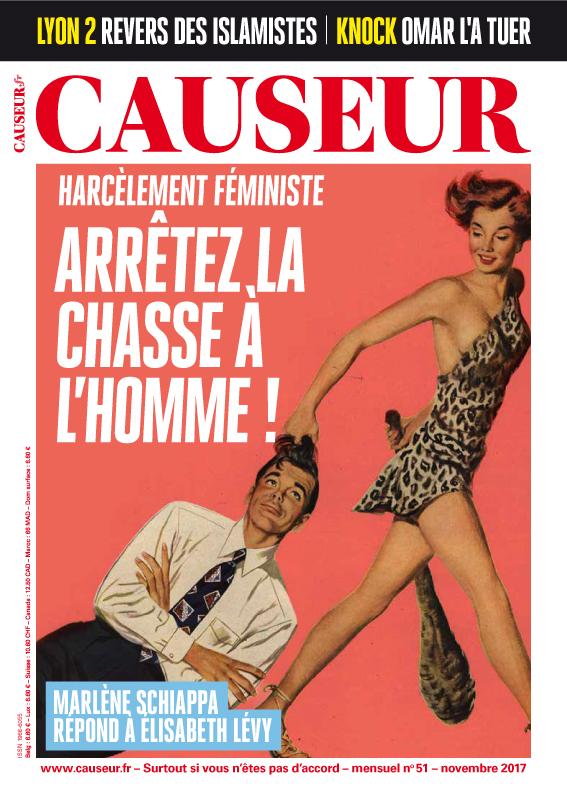La France connaît son « moment Gauguin » : une rétrospective au Grand Palais, une biographie fouillée chez Fayard, et même un biopic plein de vahinés avec Vincent Cassel.
L’exposition du Grand Palais, « Gauguin l’alchimiste », possède au moins un grand mérite : elle démontre la puissance et l’obstination créatrices de Gauguin (1848-1903), la diversité de ses talents, son acharnement à ouvrir des voies artistiques qu’allait emprunter l’art moderne. Elle présente des œuvres que leur éloignement rendait invisibles, par exemple Les Aïeux de Teha’amana » (Art Institute, Chicago), Eh quoi ! Tu es jalouse ? (musée Pouchkine, Moscou), et encore Dans les vagues (Museum of Art, Cleveland), d’une extraordinaire conception qu’on pourrait croire manquée alors qu’elle traduit supérieurement la progression d’un corps féminin dans l’eau, les petits assauts des vagues contre la chair, le rythme d’un exercice très sensuel de nage et de danse mêlées. Ce que nous révèle aussi l’exposition, c’est l’œuvre du sculpteur Gauguin, en particulier ses « bois ». Ses contemporains ont cru discerner dans sa manière un « art de matelot », mais nous voyons mieux aujourd’hui quelle mutation artistique, quel détournement de forme signalent ces sculptures. Il n’y aura pas avant longtemps une telle occasion de considérer l’ampleur d’un artiste aussi radical, aussi influent.
Détournement de mineur sous les tropiques
Vincent Cassel incarne le peintre dans Gauguin – Voyage de Tahiti. Ce n’est pas le lieu de livrer une critique de ce « biopic vahiné », que nous n’avons pas l’intention de visionner dans l’immédiat. En revanche, il est intéressant de noter qu’il a provoqué une ulcération de la conscience chez quelques-uns : « Un film qui gomme la réalité coloniale », titrait Le Monde. Sur le site de Jeune Afrique, Léo Pajon dénonce une falsification des faits, relativement au comportement sexuel de Gauguin dans son « paradis » tahitien. Son article reproche au metteur en scène, Édouard Deluc, de terribles omissions : « Ce film pourrait être un biopic convenu de plus consacré aux maîtres de la peinture, mais des ellipses opportunes dans le scénario en font une œuvre au mieux incroyablement maladroite, au pire parfaitement abjecte. Car, ce que cette histoire ne dit à aucun moment c’est que Tehura (qui s’appelait aussi Teha’amana) avait seulement 13 ans lorsque Gauguin (alors âge de 43 ans) la prit pour “épouse” en 1891. Et malgré ce que pourrait laisser croire le biopic, elle ne fut pas la seule à partager la vie de l’artiste dans l’île : il y eut aussi la jeune prostituée métisse Titi, ainsi que Pau’ura et Vaeoho (toutes deux 14 ans). Enfin, dernier “oubli”, le maître était atteint de syphilis, maladie sexuelle potentiellement mortelle, qu’il distribua généreusement à Tahiti. Dans le film, Gauguin se voit seulement diagnostiquer un méchant diabète… On en pleurerait de rire si ce n’était aussi grave. »
Le grand récit
David Haziot ne cèle rien, dans son Gauguin, publié par Fayard, du goût du peintre pour les jeunes filles, de ses « tentations coloniales », de son caractère difficile, de sa dureté. Il dit tout ce qu’il sait, ce qu’il a appris de ce personnage, qui n’entraîne pas la sympathie, mais plutôt une sorte de fascination. On dira désormais : « Pour Gauguin, voyez Haziot ! » Dans une biographie, tout est dans la manière et, comme pour un roman, cela se joue dès les premières pages : ou l’on s’y ennuie, et l’on se décourage, ou l’on est emporté, et l’on s’engage derrière l’auteur. Que reste-t-il d’une vie, celle d’un rond-de-cuir ou d’un aventurier ? Il reste un récit, qui trouve la preuve d’un destin dans l’enchevêtrement des origines, des hasards, des hésitations, des erreurs et des entêtements ; un récit qui veut un auteur pour être rapporté.
Pour Paul Gauguin, il fallait la curiosité d’un détective anglo-saxon et l’élégance d’un écrivain français : « 1855. Au début de l’année, été austral. Navire à voiles perdu dans l’océan Atlantique. Aline Gauguin, née Chazal, est inquiète. Elle a quitté le Pérou depuis de longues semaines et fuit vers la France. La situation politique de son pays d’adoption où elle a vécu à l’abri, dans sa famille maternelle, les Tristan y Moscoso (…) était devenue préoccupante. Encore un mois de navigation et elle abordera les rivages de cette France, elle-même abandonnée six ans plus tôt, après la Révolution de 1848. Que va-t-elle découvrir à son retour ? (…) Ses deux enfants l’accompagnent. Une fille aînée de 8 ans, Marie, et Paul, un garçon de 6 ans qui parle espagnol et sait à peine deux ou trois mots de français. (…) Comme plus tard ceux de Lautréamont, né à Montevideo, ses yeux sont emplis d’images qui ne doivent rien à l’Europe et aux canons grecs à travers elle. Aline collectionne (…) ces étranges poteries précolombiennes des époques Chimú, Mochica, Nazca, et des figurines incas en argent massif. Leurs formes curieuses sont familières aux yeux de Paul et sacralisées par l’amour maternel. Aline en emporte des pièces dans ses malles. Elles rappelleront le paradis perdu, le pays des rouges, aux yeux de l’enfant. »
Petit séminaire et marine marchande
Peut-on mieux esquisser les lignes de fuites qui formeront la « perspective Gauguin » ? Elles se trouvent sur ce voilier, qui l’emporte vers l’Europe : elles évoquent la navigation, l’éternelle errance, le souffle d’un vent sauvage sur la nuque, les influences ultramarines, la quête chromatique. Les « rouges » sont une allusion directe aux variations de cette couleur, et surtout à son intensité dans certaines contrées. Le métier de marin sera comme une vocation éprouvée très tôt, à 13 ans. Il veut soudainement préparer le concours d’entrée à l’École navale. Après en avoir reçu un excellent enseignement dans toutes les matières (il le reconnaîtra), il quitte le petit séminaire de Saint-Mesmin, près d’Orléans, dirigé par Mgr Dupanloup (fin pédagogue), plein d’une rancœur fondatrice : « (…) je crois que c’est là où j’ai appris dès le jeune âge à haïr l’hypocrisie, les fausses vertus, la délation (…) ; à me méfier de tout ce qui était contraire à mes instincts, mon cœur et ma raison. » David Haziot a raison de discerner dans cette déclaration la « protection forcenée du moi intégral (…) contre toute menace d’où qu’elle vienne ». Sa mère le fait entrer dans la pension Loriol, rue d’Enfer (devenue Denfert-Rochereau), à Paris. C’est sans doute dans cet établissement qu’il reçoit la meilleure formation au dessin. En effet, outre les mathématiques, les futurs officiers de marine devaient maîtriser les crayons et les pinceaux, afin de produire des relevés géographiques ainsi que des croquis et des portraits des populations rencontrées. Mais il ne demeure guère à la pension Loriol, et ne peut se présenter au concours. Il naviguera, cependant, et participera même, comme fusilier marin, à la guerre de 1870. Cependant, « après cinq ans et quatre mois de navigation, il n’avait plus envie de remonter sur un bateau comme marin. Et ces années passées en subordonné condamné à obéir sans cesse, lui donnaient une envie furieuse de prendre sa revanche », écrit Haziot.
Le refus de la Grèce
Il exerce encore le métier, très lucratif, d’agent de change à la bourse de Paris ; il s’installe, épouse la jolie Mette-Sophie Gad, danoise d’origine. Le couple aura cinq enfants. Puis il croise la route de Pissarro : il sera peintre, et encore sculpteur, il partira loin d’ici, il connaîtra toutes les métamorphoses d’un artiste complet, jamais repu de connaître, de transformer, de « fracturer » les formes qu’il rencontre, de leur donner un sens neuf. Il semble qu’il n’aura suivi qu’un seul commandement, celui-là même qu’il donnait à George-Daniel de Monfreid (1856-1929, le père de Henry), peintre lui aussi, et son confident, en février 1897 : « Ayez toujours devant vous les Persans, les Cambodgiens et un peu l’Égyptien. La grosse erreur, c’est le Grec, si beau soit-il. » (février 1897.) Tout Gauguin est dans cette recommandation : il s’est volontairement tenu à l’écart du grand effort de l’art européen. Par souci d’« ensauvagement », et pour nourrir son art, il a refusé l’influence des Grecs anciens, celle de l’humanisme, et le grand effort intellectuel et culturel de la Renaissance. Il a su très tôt, en regardant ses origines, que sa légitimité était ailleurs.
Gauguin est l’un des plus grands artistes de tous les temps.
Quant à l’homme…
« J’ai été bon quelquefois : je ne m’en félicite pas. J’ai été méchant souvent ; je ne m’en repens pas. »[tooltips content=’Paul Gauguin, Avant et après, cité par David Haziot.’]1[/tooltips]