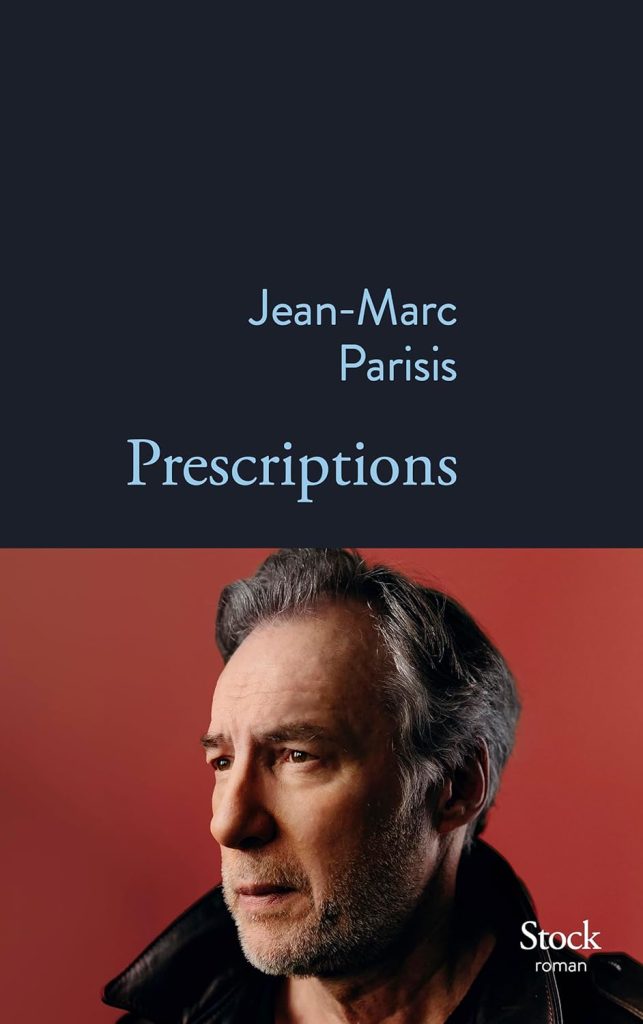En pleine promotion de sa nouvelle comédie sur les migrants, l’actrice franco-américaine rigolote qui, croyait-on, ne se prend jamais trop au sérieux, a estimé que la situation était «extrêmement préoccupante» en France.
Le 18 septembre sortira sur nos écrans un film dont le sujet est d’une telle originalité qu’il eût été dommage de ne pas en parler. Ça s’appelle Les Barbares. C’est l’histoire d’un village breton qui a décidé d’accueillir des réfugiés ukrainiens en échange de subventions gouvernementales. Mais, au lieu de voir arriver des Ukrainiens, les habitants dudit village voient débarquer des migrants syriens. « Et certains ne voient pas l’arrivée de leurs nouveaux voisins d’un très bon œil. Alors, au bout du compte, c’est qui les barbares ? » (extrait du synopsis, site AlloCiné). L’actrice et réalisatrice franco-américaine Julie Delpy fait en ce moment la promotion de son film, lequel a ouvert le Festival du film francophone d’Angoulême le 27 août.
Enfin un film « engagé » !
Le même jour, sur France Inter, Léa Salamé a accueilli cette réalisatrice « audacieuse, singulière et culottée » en rassurant immédiatement les auditeurs : « Les Barbares n’est pas un film à message ». On se demande vraiment ce qui a pu lui laisser croire qu’il y aurait des gens pour imaginer ça. Néanmoins, précise-t-elle quelques instants plus tard, « cette comédie explose les préjugés sur la France, sur l’accueil et la différence ». En plus de ces réflexions saisissantes, que d’aucuns trouveront peut-être contradictoires, nous apprenons que Julie Delpy est féministe, qu’elle était en avance sur le mouvement MeToo et s’étonnait déjà en 1988 qu’un « réalisateur puisse être avec une jeunette », qu’elle ne s’est jamais laissé embobiner par le patriarcat et qu’elle votera Kamala Harris aux prochaines élections présidentielles américaines. Fin de ce passionnant entretien.
A lire aussi: Aurélien Bellanger, dhimmi en chef
Le magazine Marie-Claire a également rencontré cette réalisatrice « indignée, rebelle aux injustices depuis toujours » et « ne se résolvant pas au repli identitaire ». Les choses se précisent. Si son film n’est pas un film à message, cela n’a pas empêché Julie Delpy de le préparer rigoureusement en visionnant « pas mal de documentaires sur les migrants » et en réalisant « une multitude d’entretiens avec des Syriens installés en France ». Bon, reconnaît la réalisatrice, il y a bien un message, mais c’est un « message positif », plein d’espoir, qui transparaît à la fin de ce film qui se veut avant tout une comédie : les quelques habitants de ce village breton qui étaient récalcitrants à la venue de migrants syriens comprennent finalement qu’ils étaient des gros beaufs arriérés et bouffés par leurs préjugés et qu’il y a « des Syriens qui réussissent leur insertion et qui vivent normalement en France ».
Julie Delpy, consciente des enjeux autour du genre et de la « race »
Mais ça, c’est au cinéma. Dans la vraie vie, Julie Delpy est très inquiète. Il y a, selon elle, une « coulée générale qui va dans une mauvaise direction ». Ce n’est pas parce qu’elle demeure essentiellement à Los Angeles – « ville très progressiste sur les questions de genre et de race », s’extasie-t-elle au passage – qu’elle ignore les maux qui dévastent le monde en général et la France en particulier, pays où « la situation est extrêmement préoccupante ». Heureusement, il existe des personnes qui ne baissent pas les bras devant les injustices. Elle-même, assure-t-elle, ne se résignera jamais et est prête à en découdre car, cette attitude audacieuse mérite d’être soulignée, elle ne « supporte pas ce qui est raciste, xénophobe, sexiste, homophobe, et tout ce qui symbolise une haine de l’autre ». D’ailleurs, confie-t-elle au journaliste de Marie-Claire, juste avant d’arriver pour cet entretien elle s’est fritée dans le métro avec « un mec qui commençait à être agressif avec une jeune Maghrébine » mais qui s’est calmé une fois qu’il a eu compris à qui il avait affaire. Ce que c’est que le hasard, quand même ! Elle aurait pu tomber sur un pickpocket rom, un migrant afghan se frottant à tout ce qui bouge ou un jeune homme d’origine africaine insultant une famille juive, ce sont des choses qui se voient – mais non, il a fallu qu’elle tombe sur un raciste de souche tout ce qu’il y a de plus franchouillard, c’est-à-dire le genre d’individu qu’elle a en horreur et qu’elle dénonce dans son film qui n’est pas un film à message.
Pendant ce temps, Vincent Lindon récompensé à la Mostra de Venise…
Ceci étant dit, nous attendons maintenant impatiemment l’entretien que ne manquera pas d’organiser Léa Salamé avec Delphine et Muriel Coulin, les réalisatrices de Jouer avec le feu, film qui sortira en janvier 2025 et dans lequel Vincent Lindon joue le rôle d’un père, militant socialiste, confronté à « la dérive de son fils se rapprochant de groupes d’extrême droite ».
Avant cela, sans doute la journaliste de France Inter recevra-t-elle Boris Lojkine, le réalisateur de L’Histoire de Souleymane, dont la sortie est prévue le 9 octobre. Télérama affirme que c’est un « film à montrer à tous les citoyens persuadés que la vie d’un immigré sans papiers en France est celle d’un assisté spoliateur », un film dans lequel « on n’a jamais ressenti aussi fort la brutalité et l’hostilité d’un monde qui a perdu le sens de l’accueil ».
Naturellement, une question nous vient immédiatement à l’esprit : ces films sont-ils des films à message ou non ? Nous comptons sur Léa Salamé pour nous éclairer.