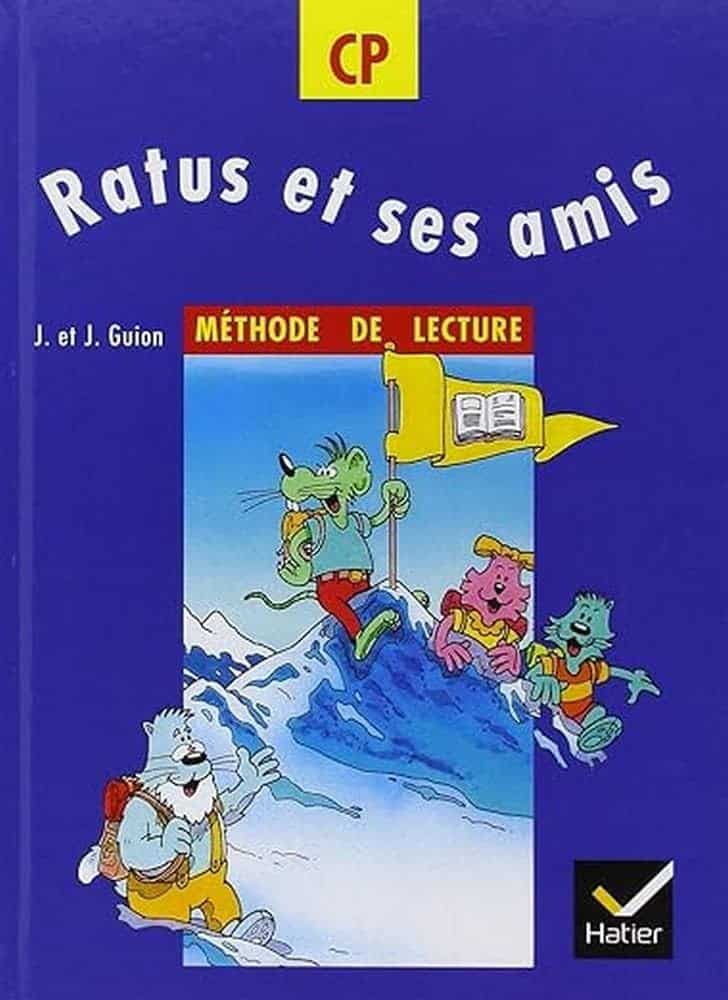Le LR Othman Nasrou a un temps été pressenti pour prendre la tête d’un ministère de la Laïcité au sein du gouvernement Barnier. Islamophobe ! a immédiatement dénoncé la gauche. Finalement, Monsieur Nasrou dirigera un Secrétariat d’État à la Citoyenneté et à la lutte contre les discriminations. Le regard libre d’Elisabeth Lévy
On a failli avoir un ministère de la Laïcité. Pendant trois jours ! Dès que l’idée a fuité, on a eu droit aux grandes orgues. La laïcité, qui a longtemps été le combat de la gauche quand la droite défendait le pouvoir de l’Église, a accompagné, baigné, irrigué l’aventure de la République et singulièrement celle de l’école républicaine.
Jaurès disait que « la laïcité, c’est la fin des réprouvés », une définition admirable. Eh bien, pour une grande partie de la gauche, la laïcité est aujourd’hui une insanité, une insulte, une menace. Pire : une idée de droite ! Un concept raciste destiné à persécuter les musulmans… Elle est contestée et menacée à l’école, à l’hôpital, dans les entreprises, dans toute la vie sociale. Elle est vomie par les islamistes. D’ailleurs, le combat contre la laïcité était la raison sociale du CCIF, dissous pour séparatisme.
A lire aussi: Les «Blouses blanches pour Gaza»: pas bien claires!
À l’annonce de ce possible ministère de la Laïcité, la gauche insoumise et crypto-insoumise a fait des vocalises sur le thème de l’islamophobie, terme ânonné par tous les idiots utiles des Frères musulmans. Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, a ainsi dénoncé une « provocation qui va mettre le feu aux poudres. Ce sera un ministère de l’islamophobie. »
Toute la gauche n’est heureusement pas sur cette ligne. Mais, il faut croire que Jérôme Guedj et Bernard Cazeneuve pèsent moins que Jean-Luc Mélenchon et sa bande d’agitateurs communautaristes. Emmanuel Macron et Michel Barnier ont donc reculé. Exit la laïcité ; à la place : un Secrétariat d’Etat à la Citoyenneté et à la lutte contre les discriminations, confié au même Othman Nasrou. C’est une abdication. Comme si nous avions peur d’être nous-mêmes.
A lire aussi: Sophia Chikirou, le « martyr » du Hamas et la chute de la maison Mélenchon
Vous pensez que j’exagère ? Qu’après tout, ce n’est qu’un changement de nom ? Non ! Un ministère de la Laïcité n’aurait sans doute pas changé grand-chose. Mais, reculer même sur le mot, c’est proclamer et entériner qu’on abandonne la chose. Et on l’abandonne précisément pour s’attirer les bonnes grâces de la gauche et surtout pour ne pas froisser nos concitoyens musulmans – ou du moins une bonne partie d’entre eux hostiles à la laïcité et qu’on traite comme des enfants susceptibles. J’ai bien peur de lire en sous-texte du nouvel intitulé de ce ministère que le véritable obstacle à une citoyenneté pleine et entière, ce ne serait pas le séparatisme, mais les discriminations et les injustices. Vous êtes des victimes et la collectivité a une dette envers vous.
Pourtant, la laïcité, c’est le mode d’emploi du vivre-ensemble à la française. Il n’y a rien de raciste ou de désobligeant à demander aux derniers arrivés et à leurs descendants de le respecter. Inutile de mentir, de répéter comme Gabriel Attal que la laïcité n’est que bienveillante. Oui elle est bienveillante, mais contraignante. Elle demande une certaine discrétion religieuse dans l’espace public, d’accepter que les autres puissent se moquer de votre dieu. C’est souvent douloureux. Mais c’est aussi la promesse pour chacun, quelle que soit sa naissance, son origine, son clan, de pouvoir penser librement. Malheureusement, on dirait que ce n’est plus la promesse française.
Cette chronique a d’abord été diffusée sur Sud Radio
Retrouvez Elisabeth Lévy dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin