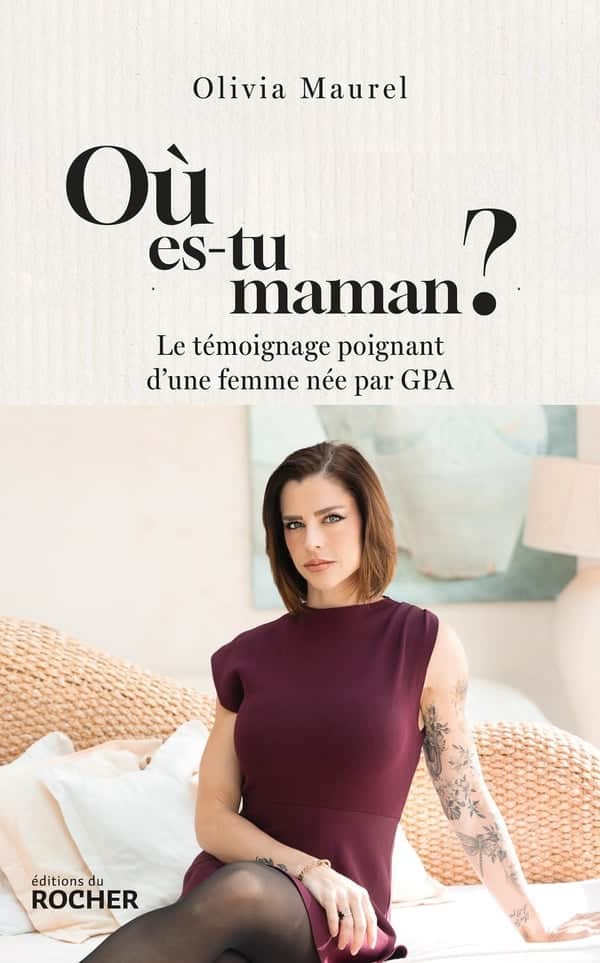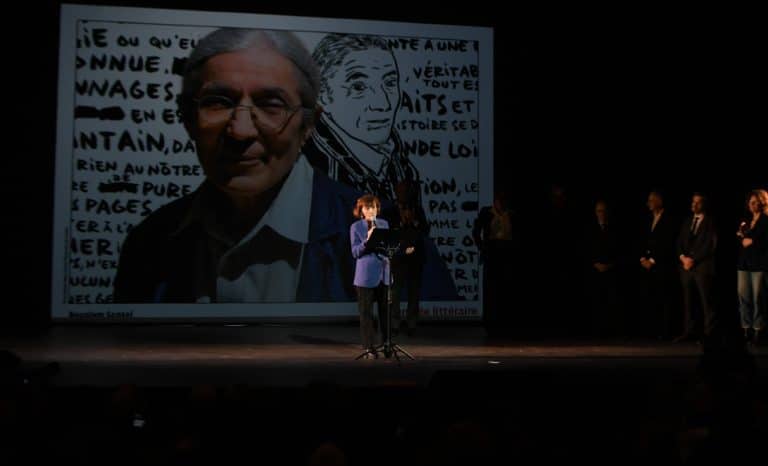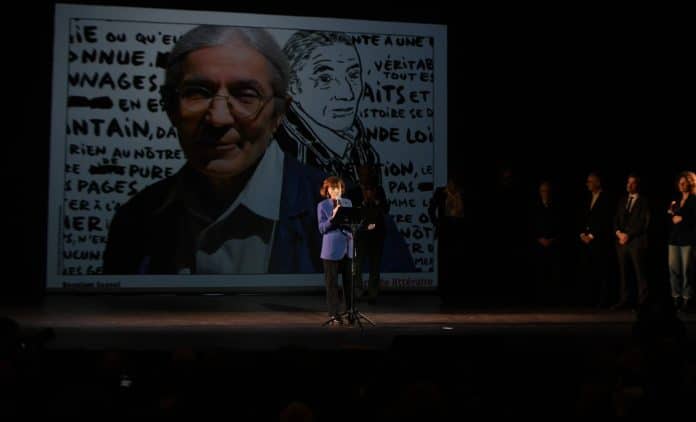À quelques jours de l’ouverture du 49ème Rétromobile, le salon des automobiles anciennes de la Porte de Versailles, Monsieur Nostalgie perçoit comme un changement d’air dans les médias conventionnels. L’Histoire des voitures n’est plus cachée ou ostracisée. Serait-ce un retour de l’auto dans le cercle de la raison ?

J’ai cru avoir la berlue, un dimanche de janvier, dans les rues de Paris. Elles étaient des centaines, en liberté, allant de la Place Vendôme à la Butte de Montmartre, une faune métalleuse, sans restriction, sans zone d’exclusion, sans péage, sans déchéance d’identité, à la vue des passants et des touristes, accueillant banlieusards en utilitaires anciens et gentlemen drivers des banlieues huppés en italiennes dévergondées. La Concorde recevait en son sein, ce jour-là, toutes les nationalités et toutes les carrosseries, toutes les opinions, dans la communion d’une « mobilité » heureuse. Dans ce parking improvisé et soi-disant « viriliste », abject aux yeux de nos nouveaux inquisiteurs, on parlait très peu de boulons et de ferraille, plutôt de cette onde nostalgique qui drape les Hommes de bonne volonté. La mémoire était vive, aucunement rabougrie, aucunement passéiste, elle était pacifique et partageuse. On parlait, entre les pare-chocs, de cinéma, d’architecture, de sculpture, de sports mécaniques, des mots interdits comme « miracle économique italien », « trente glorieuses », « île Seguin », « carrossiers », « Monte-Carlo 1965 », « Connolly » ou « l’épicier ambulant de mon village » venaient fouetter les idées reçues.
À lire aussi: Roger Scruton ne plaît pas qu’à Viktor Orban…
L’hibernation de notre patrimoine a assez duré ; les génuflexions victimaires aussi. La peur va bientôt changer de camp. L’auto est plus qu’un art de vivre, c’est un art de penser la société industrielle avec l’œil d’un esthète et le souvenir d’un enfant. Comme dirait l’humaniste Patrick Sébastien, c’est que de l’amour. Est-ce l’effet Trump ? La libération de la parole du pick-up et des « muscles cars » dans une société oublieuse de son passé. Un retour de flamme du moteur à explosion, après vingt ans de purgatoire où il fut accusé de tous les maux et de toutes les vilénies. Selon la formule célèbre, « un barbu, c’est un barbu, trois barbus, c’est des barbouzes », « Une DS, c’est une DS, trois DS auxquels j’ajoute une Jaguar MK II, une Pagode, une R18 break et, entre autres, une Estafette, c’est une révolution ». Les mentalités ne sont plus figées dans la vieille « agit-prop » qui faisait jusqu’à très récemment de l’auto, la mascotte de notre culpabilité. Car nous étions forcément coupables d’avoir aimé les autos, leur imaginaire et leur style, de nous être complus dans un consumérisme effréné qui apportait jadis de l’emploi, du progrès, du confort, de la sécurité, des échanges et des voyages. Nous étions des salauds attachés à leur petite auto individuelle qui n’avaient pas le droit de s’émouvoir des départs en vacances sur la Nationale 7 et de pépé au volant de son Renault Galion, je ne serai pas cet homme-là, celui du renoncement. Je croyais être seul, je me rends compte que nous sommes des milliers à ne pas rejeter la voiture car elle était l’expression de notre humanité triomphante. Nous pourrons constater, dans quelques jours, du 5 au 9 février sur le salon Rétromobile, que les amoureux de toutes les locomotions anciennes ne sont pas des tortionnaires, mais des passeurs, des entremetteurs, des éclaireurs de nos richesses mécaniques d’antan. Le programme de cet événement qui annonce le top départ de la saison car, dès le printemps, ce sera une déferlante dans tout l’hexagone, de manifestations, sorties de clubs, rallyes et concours d’élégance.

À la Porte de Versailles, il y a aura cette année des blindés en provenance de Saumur, des « avant-guerre », des Formule 1 « Made in France », l’anniversaire des 70 ans de la Citroën DS, des ventes aux enchères et des petits papiers, livres, documentations d’époque et autres affiches. L’auto, la belle auto, populaire et élitiste, est le canevas de nos émotions. Ne la trahissons pas ! Quand je vous parlais de changement de paradigme, il suffit de voir la programmation d’Arte. En ce moment, sur la plateforme de la chaîne culturelle franco-allemande, sont diffusées les trois parties du documentaire « Une brève histoire de l’automobile »[1] et si cela ne suffisait pas, les programmateurs ont ressorti en ligne le reportage « Bugatti, l’ivresse de la vitesse »[2] datant de 2016. Comme quoi au royaume de la bien-pensance, il y a du flottement dans le volant. Après avoir vu une Bugatti 35 sur les routes de Molsheim en action, en mouvement, je connais peu d’hommes qui peuvent résister à cet appel « Bleu de France » !
Informations pratiques : https://www.retromobile.com/fr-FR/infos-pratiques/dates-horaires-plan
[1] https://www.arte.tv/fr/videos/RC-026050/une-breve-histoire-de-l-automobile/
[2] https://www.arte.tv/fr/videos/069103-000-A/bugatti-l-ivresse-de-la-vitesse/