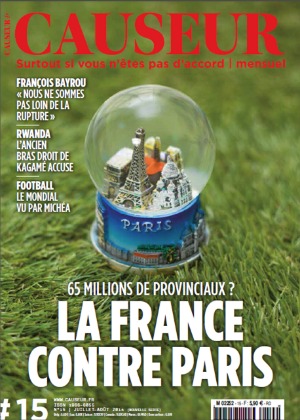On imagine qu’avec le chômage et le reste, l’art est le cadet de leurs soucis. Mais les Français sont tout de même un peu peinés de pressentir à quel point leur pays, autrefois terre d’élection des arts et des artistes, est à présent marginalisé. La France, loin derrière la Chine et les États-Unis, loin derrière l’Allemagne et la Grande-Bretagne, est devenue, sur le plan artistique, ce que l’on pourrait appeler un pays de troisième zone. On aimerait bien savoir comment on en est arrivé là, alors même qu’il existe en France et seulement en France un ministère de la Culture doté de moyens importants et débordant de projets. L’omniprésence des pouvoirs publics dans le paysage artistique est bien une exception française. Et c’est cette exception qu’il faudrait questionner. L’engagement massif et durable de la puissance publique ne serait-il pas à l’origine de l’affaiblissement artistique de la France ? La consécration publique d’un goût « officiel » (et les financements qui vont avec) aurait-elle donné naissance à une sorte d’académisme, présenté comme impertinent, mais dépourvu de crédibilité ?[access capability= »lire_inedits »]
L’action de l’État en faveur des arts plastiques peut paraître mineure à l’aune des sommes mobilisées. Mais s’agissant d’un secteur de petite taille, son impact s’avère déterminant. Une batterie de lignes de crédit procure des aides directes à une minorité d’artistes, de galeries et de médiateurs : attribution d’ateliers et contributions à l’installation, soutiens à la « recherche », subventions à la création en ses diverses étapes et pour ses multiples protagonistes, et bien entendu achats d’œuvres. Cependant, le moyen d’intervention décisif réside sans doute dans les innombrables établissements et pseudo-associations, établis sur le territoire et à l’étranger, qui relayent la politique du ministère. Depuis les années 1980, un véritable maillage des régions s’est organisé à travers les Centres d’art, les Fonds d’art contemporain et autres institutions muséales. Quant aux institutions plus anciennes, comme les Écoles d’art, elles ont subi un aggiornamento parfois musclé. À l’étranger, l’ex-Association française d’action artistique, maintenant fondue dans l’Institut français, est priée de contribuer à la promotion des artistes appréciés en haut lieu. En fin de compte, tout un réseau public et parapublic œuvre au service d’une certaine idée de l’art contemporain.
Il n’est pas choquant en soi que l’État ait une politique de l’art. L’ennui, c’est que la plupart des œuvres et des manifestations produites dans ces circuits ont ceci de particulier (et de commun) qu’elles sont accompagnées d’importants textes explicatifs. Cette caractéristique paraît d’autant plus étrange au profane qu’il s’agit souvent de textes filandreux, voire carrément obscurs. Il n’est pas rare que les objets présentés soient d’une insignifiance inversement proportionnelle à l’enflure des commentaires qui les soutiennent. Pourtant, si l’on a sincèrement envie de faire partager une idée ou une sensibilité, on essaye de se mettre à la portée des autres. On s’efforce de s’exprimer clairement. Quand on veut impressionner et que l’on vise une sorte de respectabilité plus mondaine qu’intellectuelle, on peut céder à la tentation de l’enfumage.
Une certaine prose, appréciée de quelques-uns mais un peu lourde au goût des autres, accompagne donc généralement la forme d’art dont il est question ici. Seulement, il s’agit d’un usage à haut risque. En effet, si la réception d’une œuvre nécessite une explication, sait-on ce que deviendra le précieux commentaire lorsqu’elle sera présentée à l’étranger ? Sera-t-il traduit ? Sera-t-il perdu ? Le style, parfois « hyperintellectualisé », sera-t-il perçu, loin de chez nous, positivement ou négativement ? Les mêmes questions se posent au sujet de la transmission d’une œuvre dans le temps : qu’adviendra-t-il du mode d’emploi dans quelques décennies ? Qu’y comprendra-t-on dans quelques siècles ? Les œuvres dont l’existence dépend d’un discours sont à l’évidence moins exportables et moins durables que celles qui portent en elles-mêmes une richesse de sens et d’émotions. Au-delà même des considérations esthétiques, le choix des réseaux publics d’encourager l’art dans cette voie paraît très risqué.
Critiquable également est la propension à privilégier les formes qui s’adressent principalement à des institutions, comme les « installations », au détriment des peintures, plus classiques peut-être, mais qui intéressent toujours – et, semble-t-il, de plus en plus – les collectionneurs.
On a parfois même l’impression que l’administration et ses relais ont pour ambition de lutter contre le goût du public, et pas seulement du « grand public », mais aussi du public cultivé. Ainsi, on enchaîne à un rythme soutenu les présentations d’objets improbables dilués – et supposément sublimés, sans doute – dans d’immenses locaux repeints en blanc. On accumule les catalogues d’exposition de 500 pages rédigés dans un style néoscolastique. Le visiteur lambda déploie des trésors de bonne volonté. Et pour les récalcitrants, il reste l’argument d’autorité : on leur rappelle que leurs ancêtres ont déjà loupé Manet, Van Gogh et les débuts de la modernité. Autrement dit, ils ne peuvent plus refuser de « comprendre », sauf à vouloir faire figure d’incurables blaireaux.
Il est assez docile, le public. En apparence en tout cas. Il se rebiffe rarement contre l’art qu’on a prévu pour lui. Mais il préfère se consacrer à autre chose. C’est aussi simple que ça. Il n’y a pas conflit, mais évitement. Les Centres d’art sont presque vides à longueur d’année, hormis, bien sûr, les scolaires qu’on y promène.
En somme, les Français s’intéressent peu à l’art qu’on leur prescrit, souvent ennuyeux et sottement élitiste. Mais ils hésitent à se tourner vers d’autres formes d’art, craignant de se ridiculiser en admirant ou en achetant une œuvre ne relevant pas des genres validés. Ils sont comme des gens à qui on aurait imposé un mariage arrangé et qui ne se sentiraient pas autorisés à aller voir ailleurs. Leur désir est en berne.
Or, cela ne s’explique nullement par une désaffection générale pour la culture ; pas du tout. Tous les jours, des romans, des films, des musiques, des architectures suscitent l’engouement − justifié ou non, ce n’est pas la question. Il y a incontestablement une indifférence spécifique du public français à l’art contemporain. Dans ce domaine, il devient difficile de monter une émission de télé ou une opération de mécénat, difficile de mobiliser les salariés d’une entreprise – en réalité, difficile d’entreprendre quoi que ce soit. La demande d’art en France est anémiée. Malheureusement, sans un marché interne vivant et solide, il n’est guère envisageable de briller sur la scène internationale.
Dans un rapport au ministère des Affaires étrangères qui date déjà d’une dizaine d’années, le sociologue Alain Quemin donnait l’alerte. Il soulignait que la France, à l’étranger, est suspectée de « promouvoir un art officiel toujours soupçonné de médiocrité », et que « ses artistes font bien souvent l’objet d’un certain discrédit a priori ». On trouve aussi dans ce document d’intéressants verbatim de collectionneurs internationaux qui excluent d’acheter français au-delà d’un montant relativement bas, en raison d’un préjugé négatif sur notre pays. Le rapport Artprice 2013, qui situe les plasticiens français en bas de l’échelle des prix, montre que ce diagnostic garde toute son actualité. Les quelques artistes français qui ont percé à l’étranger n’ont d’ailleurs pas nécessairement rendu heureux le ministère, bien au contraire. Ainsi, en a-t-il été, par exemple, du peintre Gérard Garouste, dont la première exposition à New York, chez le prestigieux galeriste Leo Castelli, est ainsi évoquée par la sociologue Nathalie Heinich : « Un responsable culturel français lui déclara qu’il n’aimait pas sa peinture et qu’elle ne représentait en rien l’art français. Il n’eut aucun soutien des institutions de son pays. »
L’action des pouvoirs publics et de leurs relais est également curieuse, s’agissant de leurs relations avec la population des artistes dans son ensemble. En effet, la plupart des autres administrations sectorielles se sentent chargées des femmes, des hommes et des entreprises relevant de leurs attributions. Par exemple, le ministère de l’Agriculture travaille en partenariat avec les syndicats agricoles et fait son possible pour développer la filière agroalimentaire. En ce qui concerne le ministère de la Culture, c’est moins clair. On le sent tiraillé entre deux objectifs souvent contradictoires : d’un côté, venir en aide à ses administrés et, de l’autre, mener une politique de prestige pour son propre compte. L’exemple des salons du Grand Palais est significatif. L’État a obligé les associations à entasser presque tous les salons historiques en une seule manifestation générique dénommée « Art en Capital ». La présentation, extrêmement compacte et réduite à quelques jours, est dissuasive. On comprend que, pour les « inspecteurs de la création », il s’agit là d’artistes extrêmement ringards et de « peintres du dimanche ». Ce jugement est d’ailleurs loin d’être faux : il y a de tout dans ce genre de salon. Je ne peux pas dire le contraire. Mais le problème n’est pas là. Des pays comme la Grande-Bretagne comprennent l’intérêt de soutenir le monde associatif, aussi perfectible soit-il, parce qu’il constitue une sorte de terreau irremplaçable. Pour prendre un autre exemple, le ministère de la Jeunesse et des Sports favorise des pratiques accessibles à tous, en pariant qu’il en sortira, un jour, quelque champion. Au Grand Palais l’administration a préféré créer elle-même une manifestation de prestige, « Monumenta », la bien-nommée. L’ensemble de la nef y est attribué à un seul plasticien de renom, généralement étranger, et pour une longue période. La plupart des artistes français restent pauvres et exclus des circuits autorisés. Un grand nombre d’entre eux dépendent du RSA et sont condamnés à regarder de loin les fastes de l’art officiel.
L’interventionnisme des pouvoirs publics dans le domaine artistique soulève donc de nombreuses questions. Cependant, il ne semble pas qu’une réorientation, ni même une évaluation, soit à l’ordre du jour. L’immobilisme résulte en grande partie du fait qu’il y a peu de débats, peu de contestations, juste des choses à « comprendre » et à aimer : l’art officiel est un phénomène unilatéral.
Eh bien, justement, cela doit changer ! Il faut que des points de vue divers, voire divergents, entrent dans le jeu. Exprimons-nous, exprimez-vous ! Il est important de dire ce que l’on pense, quitte à passer pour un plouc. Je crois qu’il y a moins de honte à être un blaireau sincère qu’un pédant branché.[/access]
*Photo: AVENTURIER PATRICK/SIPA.00639253_000007
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !