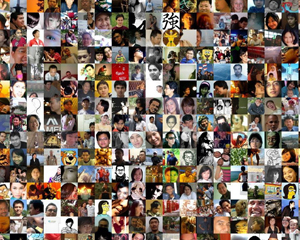Depuis une douzaine d’années, nos fashionistas suiveuses ne jurent que par les sacs à mains géants, limite cabas. Une façon de montrer que, même à minuit chez Régine, on reste une femme hyperactive, à la vie terriblement trépidante. Cette manie, lancée d’abord aux USA, fut hélas exportée chez nous à l’occasion des défilés via les épouvantables chroniqueuses du New York Times et du Vogue US, pour qui tout ce qui est ugly est forcément beautiful. Aussi, nous ne pourrons qu’applaudir l’excellent Karl Lagerfeld, qui a expliqué sur Paris Première, lors de son dernier défilé, ce qu’il pensait de cette tendance lourde : « Quand je vois ces pauvres filles qui s’acharnent à fouiller au fond de leur sac pour essayer de retrouver leur portable, j’ai l’impression qu’elles font les poubelles. »
La drôle de crise
Nous sommes officiellement en crise depuis septembre, comme nous fûmes officiellement en guerre à partir de septembre 1939. Aujourd’hui comme à l’époque, on parle de quelque chose de grave, de très grave, d’encore plus grave qu’avant. En 1939, c’était 1914 qui servait de référence à cette chose catastrophique qui couvait et qu’on soupçonnait d’être encore plus grave, mais sans savoir exactement quel visage aurait cette « gravité », à quel point il y aurait rupture entre le connu et l’inédit. Maintenant, c’est 1929 – l’antichambre de 1939 – qui hante notre imaginaire et alimente tous les fantasmes.
Mais puisque l’histoire, on le sait bien, ne se répète pas bêtement, il y a tout de même quelques différences entre ces deux moments de l’histoire – la drôle de guerre de 39-40 avait ses chansons. Côté français, on déterra la Madelon de 1914 pour remettre le monde dans l’ambiance « poilu », ce mélange vaudevillo-militaire à base de cul et de pinard : « Quand Madelon vient nous servir à boire, Sous la tonnelle on frôle son jupon… » Les Britanniques, quant à eux, débarquaient en France, promettant à pleins poumons et en rimes, non sans un certain culot, d’aller pendre leur linge sur la ligne Siegfried (« We’re going to hang out the washing on the Siegfried Line »). Et le PCF, pour ajouter la petite touche comique dont on le sait coutumier, lançait son mot d’ordre : « Une heure de moins pour la production, c’est une de plus pour la révolution. » Comme quoi pour certains, aujourd’hui comme jadis, le pire semble tout près – un petit effort et on y est !
Sans chansons ni communistes, notre drôle de guerre est un peu tristounette. On nous promet des horreurs, des fin-du-monde-tel-qu’on-l’avait-connu. Et on nous dit que ce truc qui nous est tombé dessus, comme la neige le 15 août, tout le monde l’avait prédit… Du coup on n’a qu’une seule hâte : que ça commence bientôt, que ça arrive, qu’on puisse enfin voir sa gueule, quoi !
Côté bouffe, on est prêt ! Après des décennies d’anathème culinaire, les topinambours et les rutabagas resurgissent dans les meilleurs établissements gastronomiques sous le label rétro de « légumes oubliés », comme quoi le devoir de mémoire ne s’arrête pas à la porte de la cuisine. Fort heureusement, nous n’aurons pas à débourser un centime pour acquérir ces tubercules « qui ont presque le goût de la pomme de terre ». Car, prévoyant comme d’habitude, le gouvernement a fait voter récemment une loi permettant l’utilisation de tickets-restaurant pour l’achat de fruits et légumes, signalant ainsi – mais discrètement pour éviter des mouvements de panique – un retour vers les tickets d’alimentation qui nous rappellent, comme dit l’autre, les marchés les plus noirs de notre histoire.
Et, qui plus est, les ersatz de café et de sucre de jadis – chicorée, orge grillée etc. – ont aujourd’hui droit de cité et sont même plus chers encore que l’original. Les frustrations et privations de nos aïeux sont aujourd’hui tendance.
La récup’ est à la mode, le tricot fait main revient très fort et on nous rebat les oreilles avec le pouvoir d’achat qui dégringole – la parenthèse « baby-boom » se referme et nous redeviendrons pauvres, exactement comme nos grand-parents ! La boucle est bouclée. Qu’elle vienne donc cette crise, et qu’on en finisse car on en a déjà marre !
Football en crise

Du mauvais goût ? A peine. À l’issue du match LOSC-Lyon disputé au Stade de France, deux jeunes supporters ont été tués, happés par un RER, alors qu’ils tentaient de regagner leur bus. Retrouvez chaque jour les impubliables de Babouse sur son Carnet.
La crise œcuménique s’aggrave
Aux dernières informations, il semblerait que l’OPA hostile menée depuis vingt ans par la SARL FSSPX[1. Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.] à l’encontre de l’EUSCA[2. Eglise Une Sainte Catholique et Apostolique.] Inc. n’aboutisse pas. Il n’y aura ni fusion, ni absorption. A travers ce rapprochement, les gérants de l’entreprise familiale sise à Ecône comptaient en effet imposer leurs méthodes commerciales à leur nouveau partenaire. Ils espéraient lui faire abandonner le plan marketing – décidé au Vatican, entre 1962 et 1965 – qu’ils jugeaient un peu audacieux et contraire à leurs statuts. Ils considéraient aussi qu’il s’était accompagné d’une baisse significative de la qualité de la production due, selon eux, à un mauvais respect du savoir-faire traditionnel. La constitution d’une telle holding aurait permis à la FSSPX de devenir leader mondial dans son domaine. En attendant, elle va devoir continuer à affronter la concurrence de l’UCIU[3. Union Catholique Internationale d’Utrecht (Eglise « vieille-catholique »).] et de la CAEF[4. Communautés et Assemblées Evangéliques de France.], cette dernière lui prenant des parts de marché croissantes. Si l’on ajoute la désastreuse campagne publicitaire – bien que n’étant pas conçue par Séguéla – lancée récemment par le country manager de sa branche argentine, la FSSPX traverse une sérieuse période de turbulences qui pourrait bien se répercuter sur sa cote en Bourse. Un jeudi noir en perspective ?
La querelle des amis et des friends
Facebook est mon drame. Avant le lancement de la fameuse plate-forme de socialisation je lisais beaucoup, je voyais des amis, je m’asseyais à la terrasse des cafés de la Contrescarpe pour regarder passer les filles en lisant du Claudel. Bref je vivais. Mais depuis que j’ai un compte sur Facebook, c’est fini. Rideau ! Plus de littérature ! Plus de potes ! Plus de filles ! Maintenant, dès que j’ai cinq minutes à perdre je vais sur Facebook… j’espionne ce que font mes « ex », je m’abonne à des groupes d’intérêt débiles, j’affiche ma pride d’être « fan » de l’Atomium de Bruxelles ou de Xavier Darcos, je laisse des commentaires spirituels sous les photos de mes « friends ». C’est tellement plus moderne d’avoir des « friends » que d’avoir des « amis ». Les amis, ce sont les collègues du bureau, les anciens de la fac, les potes du club de squash. C’est pas top. Les « friends », c’est autre chose. Je compte parmi mes friends de vraies pointures, genre Yves Montand (car, oui, sur Facebook on peut être ami avec des morts)… mais, pour être honnête, ceux que je préfère, ce sont les hommes et les femmes politiques.
Eux je ne sais pas comment ils font avec Facebook. Où vont-ils chercher le temps de renseigner ou modifier leurs profils ? Car sur Facebook, on n’a pas de personnalité, mais un « profil ». Et il faut l’entretenir ce profil, le mettre à jour, changer l’eau des plantes, aérer de temps en temps. Penser à mettre à jour sa « situation » amoureuse. Comment font-ils, mes « friends » politiques pour s’occuper de tout ça ? Parce que c’est du boulot. Il ne faut pas cocher une case à la légère… sur Facebook, tout est question de cases à cocher. Lorsque toute la complexité de l’égo humain se réduit à un « profil » numérique, l’homme ne recherche plus que quatre grandes choses dans la vie : l’amitié, cochez 1, des rencontres, cochez 2, une relation, cochez 3, ou le réseau professionnel, cochez 4. Comment font-ils ces politiques qui possèdent des profils sur Facebook ?
Je sais bien comment ils font : ils font faire le boulot par leurs esclaves habituels. Car l’enjeu est de taille. Communiquer via un « média » aussi moderne qu’un site de socialisation, modernise mécaniquement le discours d’un politique, aussi ringard soit-il. Avoir son « profil » sur Facebook c’est « exister » dans le monde numérique. C’est-à-dire dans le monde moderne.
Un politique, sur Facebook, nous informe d’abord de son emploi du temps, de son activité du moment, et des dossiers sur lesquels il travaille. L’utilisateur de Facebook peut aisément dire au monde entier ce qu’il est en train de faire grâce à la fonction « statut ». L’interface vous demande « Que faites-vous en ce moment ? » – nul ne semble avoir mesuré le caractère policier de cette question. C’est vrai, bordel, que faisiez-vous rue Quincampoix entre 17 heures et 19 heures ? Réponds ! Alors il faut bien dire ce que l’on est en train de faire. Nous autres, mortels, nous avons des vies quotidiennes. Nos « friends » politiques, eux, ont une actualité, qui se déploie dans un emploi du temps diaboliquement serré.
Par exemple, Michel Barnier, le ministre de l’Agriculture, nous informe en ces termes de son actualité : « Savoie : nouveau drame de la montagne. Je serai demain au Lycée agricole de La Motte-Servolex pour dire notre émotion et notre solidarité. » La montagne, cette salope, a encore frappé ! De son côté, Mike Borowsky, des jeunes UMP, est indigné : « Les Jeunes Sarkozystes condamnent l’expédition punitive faite dans un lycée de Gagny. » Qui ne condamnerait pas ce genre d’activités espiègles ? Nicole Guedj, ancienne ministre des « victimes » dans le gouvernement Raffarin, elle-même victime d’un remaniement, nous donne – pêle-mêle – ses opinions sur le dîner du Crif, ou sur le droit des homosexuels. Elle nous informe : « Je me suis tout autant félicitée de l’excellent discours de Richard Prasquier, président du Crif, que de la remarquable intervention de François Fillon. » Nous voilà bien contents.
Certains politiques sont très « agenda »… ils ne vivent que sur rendez-vous. Yves Jégo nous indique ainsi – dans son statut – qu’il « est l’invité de J-M Apathie ce lundi sur RTL », ce qui provoque un certain nombre de réactions enthousiastes de militants : « Bonne chance », « Excellente prestation monsieur le Ministre ! » On voit, d’ailleurs, sur le profil de Jégo cette mention énigmatique : « Yves est désormais marié(e) à Ann-Katrin Jégo. » Le profil de Ann-Katrin renvoie à la fiche d’une jolie blonde souriante. Roger Karoutchi, de son côté, ne parle pas de mariage, il est sur le terrain: « Roger Karoutchi sera avec les adhérents du 16e arrondissement mercredi 11 mars à 19 heures. » Mais à force de creuser son sillon, Karoutchi a laissé passer quelques fautes de goût notoires sur son profil. On repère parmi ses films favoris quelques nanars de bas étages tels que Taxi ou Les rivières pourpres… Ah ! Jeunisme quand tu nous tiens ! Le bougre prétend adorer « faire les courses au Monoprix ». J’offre un calva à la terrasse du Flore à toute caissière de Monoprix ayant croisé un jour Karoutchi.
Le ministre Eric Woerth, de son côté, lâche : « Je serai ce soir l’invité de Laurence Ferrari au JT de TF1 » Le chanceux… immédiatement après le « rendez-vous », les réactions ne tardent pas, de la part des « friends » impressionnés. « Bravo pour votre intervention sur TF1 », « Bravo monsieur le ministre, je suis d’accord avec vous », « Très bonne prestation, toujours aussi brillant et décontracté ! » Facebook, école de l’éloge et de la flatterie. Nathalie Kosciusko-Morizet indique, quant à elle, 4918 amis… et dire que moi je plafonne à 260 environ. Les dés sont pipés d’avance. Nous ne sommes pas du même monde elle et moi…bien qu’elle avoue aimer Barbara et Serge Gainsbourg… Son statut précise : « Nathalie Kosciusko-Morizet discute avec Gilbert Montagné du numérique pour dépasser le handicap. Il est formidable. » Oui, il est foooooooormidable !
Le dissident le plus rebelle de toute l’histoire de l’UMP, J-L Romero n’y va pas avec le dos de la main morte… il s’engage pour de bon, pour en découdre avec les ignobles ennemis de la liberté : « Jean-Luc Romero appelle à la mobilisation pour Florence Cassez ! » Et bien… pas moi. Une admiratrice répond : « que pouvons-nous faire pour Florence Cassez ?? Si je peux vous aider en quoi que ce soit… » Encore une âme de bonne volonté qui va finir par coller des affiches ou ronéotyper des tracts !
A gauche, le profil de Bertrand Delanoë est une perle du genre. Le brillant édile y précise que ses « employeurs » sont « les Parisiennes et les Parisiens »… et leur adresse ces mots pétris d’humanité et d’amour : « J’ai été très touché par vos soutiens, par le nombre et par la qualité des échanges. » Son adjointe, Anne Hidalgo, indique sur son propre profil : « Anne a assisté au triomphe des féminines du Rugby Club Paris XV »… et c’est vrai, un triooooooomphe… Et puis Anne n’est pas la moitié d’une femme, et elle le prouve : « Anne se mobilise en vue de la Journée Internationale des Femmes. » Et moi aussi. J’ai invité une copine au restaurant, et c’est elle qui a payé !
Sans surprise, la plupart des politiques se sont saisis de ce nouveau média de « socialisation » pour en faire un très classique outil de propagande, véhiculant toujours cette même satanée langue de bois. Ces « profils » fantomatiques sont parfaitement inhabités… car les politiques ne sont véritablement accessibles ni à leurs « friends », ni à leurs électeurs. La vraie vie privée c’est pour les « amis », par pour les « friends » – heureusement d’ailleurs. Facebook devait être un nouveau continent à explorer. Ce n’est qu’une ville-fantôme.
Vertige de la mort
La musique se passe, peut-être, comme la littérature, de bons sentiments. Elles n’en épousent pas pour autant, toutes deux, les mauvais. Ni les larmes ni les pleurs ne font jamais une bonne musique, ni un bon texte non plus. Il faut de la vie, de la joie, de l’amour, beaucoup de vie, de joie et d’amour jusqu’à l’excès, pour pouvoir créer quelque chose qui vous surpasse et échappe au nihilisme de tout temps. La chose est claire depuis Bach : Jésus, que ma joie demeure reste l’unique leitmotiv de tout art possible.
Bashung est mort. Il est mort ce soir. On le savait malade, d’une crétinerie qu’on appelle le cancer et qui est, depuis que les médecins se sont mêlés de ces histoires-là, l’autre nom de la vie-même. Il n’avait pas oublié Bach ; il le continuait juste par d’autres moyens. Il y avait même du Kurt Weill, chez cet homme-là : Bashung admirait Weill qu’il avait découvert dans sa jeunesse alsacienne. Et toute l’œuvre d’Alain Bashung n’est jamais qu’une autre tentative sans cesse répétée d’écrire un nouvel Opéra de Quatre-Sous. Ni plus, ni moins.
Voyez, vous qui croyez au rock, vous qui n’y croyez pas, les épousailles célestes de Joséphine et de Mackie Messer. Et Gabi regarde du coin de l’œil. Ils s’aiment et se retrouvent à présent, comme si seule la musique pouvait nous procurer, à nous autres les hommes, les vertiges vrais de l’amour.
L’un de ses plus proches amis, Rodolphe Burger, vous le dira : Bashung était devenu un vrai chanteur à la fin de sa vie. Il avait trouvé sa voix. Non pas celle du crooner aigu qu’il avait été à ses tout débuts, mais cette voix qui unifie le rythme, les paroles et la musique dans un même mouvement.
Et puis, et puis, Alain était un homme. Un vrai. Si vrai que Diogène n’aurait pas eu longtemps à chercher pour en trouver un en notre monde. Loin des people et des show-business plan qui font les mauvais artistes, il était resté lui-même. La première fois que nous nous sommes rencontrés, au hasard des gatherings de la Laiterie à Strasbourg (surprenant et inoubliable bœuf avec Burger, Higelin, Balibar et Bashung), je l’avais entrepris sur Elsass blues, l’une des ses plus inconnues chansons et l’une de mes préférées. Il était déjà malade, mais loin de me traiter de con ou d’importun, nous avons passé deux heures à parler de la musique, de la vie et de nos grands-mères alsaconnes. « Nul chagrin ne peut être supporté si l’on n’en raconte pas l’histoire. » Voilà toute l’histoire du blues, du rock et de la vie qui va : une petite entreprise où l’on recoud sans cesse les cœurs déchirés et les héroïques épopées du hasard.
Bashung est mort, ce soir. Pas de larmes, pas de drame. Aucun œil humide. Un homme ne pleure pas. Juste quelques mots, un petit air de rien. « Faisons envie, restons en vie. Afin que rien ne meure pour que jamais, tu ne m’oublies.[1. Alain Bashung, Faisons envie, album L’imprudence, 2002.] » Et merde, je pleure ce soir. Et je chiale comme un môme qui est déjà un homme.
[mdeezer + 2238925 + M]
Niquez la crise !
Ridicules. Profondément ridicules, les news magazines, qui se nomment hebdomadaires d’information, parce que ça en jette et que ça fait sérieux. Les lecteurs vont donc se bouffer du franc-mac, comme tous les ans une fois au moins. Et deux fois la même semaine, pour deux fois le prix… Il s’agit de démontrer que les Frères noyautent la présidence, le gouvernement et le Parlement. Comme on nous l’a annoncé et vendu déjà pour tous les présidents, tous les gouvernements, tous les Parlements. Rien de neuf donc, dormez braves gens, on se fout de vous, on vous fourgue de la daube, parce qu’on vous prend pour des gogos, des cibles de marketing.
Pire encore, si les Rouletabille du Point et de L’Express avaient fait leurs propres enquêtes, on aurait pu se dire que c’était du journalisme d’investigation, vous savez, cet alpha et cet oméga des gens de plume. Eh bien, non ! Voilà deux hebdos qui font en couv la promotion d’un bouquin, même pas encore paru, de Sophie Coignard, intitulé Un Etat dans l’Etat. Le nouveau journalisme consiste à faire du copié-collé !
Rassurez-vous, personne, dans les rédactions concernées, ne se mettra en grève. La semaine prochaine nous aurons droit au salaire des cadres, ou à Sarkozy et l’argent, à moins que cela n’ait déjà été fait. Encore que les bis repetita ne font pas peur à FOG et Barbier. Plutôt que de porter dans tous les médias la bonne parole hypertinente, on aimerait qu’ils se comportent en laborieux besogneux, et fassent preuve d’imagination.
Et L’Obs, alors ? Le roi des hebdos n’a rien publié sur les francs-maçons, qui pire que les trotskystes noyautent, vérolent et prébendent. Là-bas, un crétin, qu’il me pardonne ma franchise confraternelle, un crétin impardonnable, prétendait tout m’apprendre sur les prix de l’immobilier dans ma région. Peut-être bien que je l’ai attendu ce crétin-marketingueur pour savoir comment se portent les prix de l’immobilier chez moi. Pour cela, j’ai une presse locale et régionale, des journaux d’annonces et des agences à la pelle à un bistrot de distance. Et je n’ai pas attendu qu’un veni-vidi-connerie vienne m’apprendre ce que je sais mieux et plus vite que lui. Mais, dans ce cas encore, il doit se trouver des gogos qui s’imaginent que c’est mieux quand ça vient de Paris, sur papier glacé.
Quand des types payés très cher pour penser, pour réfléchir, pour imaginer, comprendront que ce marketing à la noix, qu’ils mettent à la une chaque semaine est éculé, en dessous de la ligne de flottaison, qu’ils déshonorent une profession entière et qu’ils ne respectent pas leurs clients, qui vont les quitter de plus en plus nombreux, on aura avancé. On peut les prendre pour des prunes, les lecteurs, mais jamais trop longtemps, ils finissent par s’en apercevoir et désertent les kiosques.
Ces remarques, je le sais, sont bien peu confraternelles, mais je n’en retire pas un mot. Parce que ce que tous ces myopes à l’égo enflé sont en train de faire gonfler la bulle qui va les faire crever. Tous ceux qui ne le savaient pas avant l’auront appris de la crise. Une bulle se forme toujours quand on vend quelque chose qui n’a pas de contrepartie. Des actions pourries, des certificats de dette vérolés, et de l’information qui n’en est pas. Pas grave. Ensuite, on ira mendier du fric à l’Etat. Tout en défendant avec des trémolos dans la voix la pluralité, la liberté de la presse et la démocratie et tutti quanti.
Vous, je ne sais pas, mais moi j’ai décidé de ne plus les acheter ces « hebdomadaires d’information », j’aime qu’on me respecte et que pour trois euros cinquante je n’aie pas en plus l’impression, qu’une fois encore, on m’a pris pour une bille. Trois mags à trois cinquante la semaine, multiplié par 52 cela me fait économiser 546 euros par an. En pleine crise, ce n’est pas rien. Cela me rembourse en tout cas largement le prix de ma liaison haut débit. Et, vous allez rire, on en apprend plus et mieux sur la France dans la presse étrangère disponible sur internet que dans nos feuilles nationales. Tant mieux pour elle, tant pis pour elles. Dona eis requiem.
Texte paru sur Homoimbecillus, le carnet de Gérard Scheer.
Le procès Madoff, une escroquerie ?
On le sait, dans l’affaire Madoff, le procureur Marc Litt, a indiqué qu’il allait requérir 150 ans de prison. On ne sait pas si le juge Denny Chin, chargé de déterminer le verdict, le 16 juin prochain, le suivra jusqu’au bout. Après tout, si l’on estime le préjudice à 50 milliards de dollars, ça ne fait jamais qu’un jour de prison par million de dollars volés aux épargnants, ce qui est d’une clémence insigne. D’un autre côté, compte tenu des statistiques d’espérance de vie, il est fort peu probable que Madoff puisse effectuer l’intégralité de son siècle et demi de réclusion. Après avoir sciemment promis des revenus qu’il était bien incapable de verser, Bernard Madoff se verrait cette fois, bien malgré lui, dans l’impossibilité de payer sa dette à la société…
Merci Roselyne !
On finira par trouver ça suspect. Mais il me faut une nouvelle fois voler au secours de Roselyne Bachelot, avant qu’elle ne succombe sous le poids de la critique et qu’il ne subsiste plus d’elle, dépassant des décombres de sa charge ministérielle, qu’un oripeau rosâtre.
Interdire le gras, le sucre, le redbull, l’alcool, les open bars ou le téléchargement gratuit de pinard sur Internet : ce sont là d’excellentes mesures. Eloigner les adolescents de la bouteille relève de la salubrité publique : êtres mi-hommes, mi-enfants, pas tout à fait finis, ils s’occuperont désormais à percer leur bubons d’acné plutôt que de se pochtronner tout habillés de noir.
Il se trouve pourtant quelques esprits chagrins pour regretter les décisions courageuses de la ministre française de la Santé. Savent-ils seulement ce qu’est un adolescent ? En ont-ils jamais vu un de près ? C’est l’animal le plus inutile de toute la Création. Le plus nuisible aussi. Ça geint et gémit, se plaint d’un rien, alterne borborygmes incompréhensifs et cris hystériques. Comme ses cheveux sentent le pubis, l’hygiène publique réclame qu’on le parque loin des odorats normaux, dans ces lycées où il essaie de se reproduire, mais n’y arrive pas, à cause de la muselière inoxydable que lui a posée l’orthodontiste. Donnez un peu d’alcool à cet être vil et repoussant, et vous aurez devant vous le pire : un animal stupide, mais désinhibé.
C’est que la Nature a bien fait les choses : se rendant compte qu’elle s’était trompée en créant l’adolescent, elle l’a chargé d’inhibitions, de névroses et d’une prodigieuse dextérité à rédiger des sms – ce qui a la vertu de le rendre relativement silencieux et amorphe la plupart du temps. Servez-lui un verre et il se met à brailler son malheur à la face du monde comme une génisse qu’on égorge. On ne saluera donc jamais assez le beau geste de Roselyne Bachelot, par lequel elle permet aux adolescents de ne pas sombrer dans les ravages de l’alcoolisme, mais de se soumettre dès leur plus jeune âge aux neuroleptiques et antidépresseurs[1. Et encore, ça ne marche plus à chaque coup : depuis qu’ils surfent sur Internet, ils matent des films X qui leur échauffent les sangs. Là encore, il faudrait sévir.].
Quant à l’interdiction des open bars, il faut être vraiment inconscient pour critiquer cette sage disposition. Je le dis d’autant plus volontiers que je fréquente depuis longtemps les open bars. Dès qu’un ami ou une connaissance sait qu’en France ou en Allemagne un bistrot s’apprête à tenir une telle soirée, il me prévient. J’arrive. Je me mets assise au comptoir et je commande ma première caïpirinha.
Généralement, au bout du douzième verre, le garçon prend un air navré pour me dire qu’il n’a plus de citron vert, plus de cachaça ou plus la force nécessaire pour piler de la glace. A ce moment-là, j’essaie de croiser comme je peux son regard pour le fixer dans les yeux et je lui lance un terrible et retentissant : « Mojito ! » S’il se montre récalcitrant, je me termine au champ, à la vodka, à la bière ou à l’essence de térébenthine. Enfin à ce qu’il reste dans la taule, s’il reste quelque chose.
C’est du moins ce que je faisais jusqu’à ce que, informée d’un open bar dans le coin, je me rende récemment à Berlin. A l’Orya, petit troquet de l’Oranienstrasse[1. Orya, Oranienstr., 22, Berlin-Kreutzberg.], j’assistai au plus touchant des spectacles. Je venais d’entrer, je m’étais installée au comptoir et j’avais à peine allumé ma première cigarette qu’un sournois murmure parvint à mes oreilles : « Elle est là. »
Le patron du bistrot, un Turc du Kreuzberg, pleurait en me regardant. Sa femme lui présenta ses trois enfants dont il baisa le front comme s’il les quittait à jamais, puis elle le serra dans ses bras, effondrée en larmes. Au bout d’un long moment, l’homme se détacha d’elle, passa derrière le bar et se planta devant moi : « Caïpirinha ? »
Il n’eut pas le temps de déposer le bilan après sa soirée open bar. On le retrouva pendu le lendemain matin. C’est dommage, c’était un as de la Caïpirinha.
Impressions d’Amérique
Pardonnez-moi, mais j’aime bien l’Amérique. Il y a encore quatre mois, cet aveu était passible du pire. Mais peut-être n’est-il plus nécessaire de se justifier. Vous l’aurez remarqué, depuis l’élection d’Obama, tout le monde aime l’Amérique ! Même Télérama et Le Monde Diplo, les profs laïcards et les cailleras à keffieh. Everybody loves Barack. Mais tout cela n’est pas très raisonnable et ne devrait pas durer. On attend le moment, proche, où Obama passera chez nous pour un Oreo cookie, noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur. Un digne successeur de Bush, version light, un Sarkozy basané qui sème la zone aux quatre coins de la planète. On en reparlera le moment venu.
Comme toute personne normalement constituée, je dois la majorité de mes émois culturels à des artistes américains[1. Note d’EL : Ah ? Proust, Mozart, Dostoïevski, Shakespeare… bons à jeter, cher David ? Je dois être anormalement constituée.]. Des Ramones à Philip Roth en passant, au hasard, par Elvis, Kurt Cobain, John Ford, Larry Clark ou les Marx Brothers, la société américaine a enfanté une cohorte de génies en tous genres. Il m’est donc permis d’émettre quelques réserves sans entrer dans le club très couru chez nous des antiaméricains primaires (« l’antiaméricanisme, le progressisme des cons », comme disait Pascal Bruckner).
Je me suis rendu une bonne cinquantaine de fois aux États-Unis en tant que journaliste. J’y ai habité un moment, et j’ai même trouvé le moyen d’épouser une de leurs ressortissantes. Si je connais un peu ce pays et sa société, ce n’est pas uniquement à travers les livres de Philippe Labro, les films du populiste Michael Moore et les revues de la presse étrangère de Marie Colmant.
Mes deux derniers voyages au pays de l’Oncle Sam, en pleine crise des subprimes, m’ont particulièrement marqué. La déconfiture économique est une chose dans la bouche de Jean-Pierre Gaillard, elle devient une réalité écrasante quand on discute avec l’Américain moyen qui vit dans une ville moyenne où les maisons mises en vente forcée (foreclosure) se comptent par dizaines de milliers. Ils font froid dans le dos, ces panneaux bank owned ou for sale by owner, plantés devant la porte des pavillons. A Fort Myers, Floride, on voit des camions de déménagement à tous les coins de rue. Sur les pelouses, on voit des frigos, des vélos, ou les tuyauteries que les familles vendent avant de partir refaire leur vie ailleurs. Des quartiers entiers ressemblent à des villes fantômes. Il y a encore quelques mois, ces mêmes familles organisaient des barbecues avec leurs voisins. Les types en pantalon chino partaient au boulot en 4X4 le matin et les femmes rejouaient Desperate Housewives en veillant sur leurs têtes blondes. L’American way of life, dans toute sa banalité, semblait devoir durer pour toujours. Game over.
Aujourd’hui, c’est le même spectacle d’exode un peu partout aux États-Unis. Pour autant, et c’est peut-être le plus surprenant, pas de panique apparente, pas d’émeutes (imaginez la même chose en France…). On serre les dents. On parle d’une passe difficile, mais jamais de la fin d’une époque dorée. Il ne semble venir à l’idée de personne que l’American way of life, le modèle économique du pays basé sur la consommation de masse, doit être sérieusement remis en cause. « In this economy, difficile de s’offrir ceci ou cela », disent les gens en grimaçant. « In this economy, this… In this economy, that… » Comme si l’économie, cet animal imprévisible et coquin, n’allait plus tarder à reprendre ses esprits. Comme si la sortie de route des classes moyennes n’était qu’un accident – terrible, certes –, et que le plan de relance d’Obama allait bientôt permettre de refermer cette sinistre parenthèse.
« L’american way of life n’est pas négociable », avait dit George Bush père en 1992 au moment de la première guerre du Golfe. La doctrine n’a pas changé depuis l’élection d’Obama. Le nouveau locataire de la Maison Blanche ne se risquera jamais sur ce terrain aussi tabou qu’impopulaire. Par une sorte d’aveuglement idéologique, la sortie de la crise du crédit n’est jamais associée à la nécessité d’un aggiornamento. Obama parle tout juste d’un improbable virage vert (quand l’empreinte carbone d’un Américain équivaut à celle de quatre Allemands…). Bref, pas question de briser le rêve, même si le cadre se fissure de tous côtés. Qu’on ne s’y trompe pas, l’Américain moyen ne ressemble pas du tout au branché de la côte Ouest qui conduit une voiture hybride, recycle ses déchets, a renoncé à la clim et aux sacs en plastique… Le péquin de base, qui forme l’immense majorité de la population sans la collaboration de laquelle rien ne pourra changer, consomme toujours comme une brute, n’a pas renoncé à son 4X4, et jongle avec les cartes de crédit pour continuer comme si de rien n’était. Obama parviendra-t-il à convaincre le péquin de base de changer de comportement ? En a-t-il seulement la volonté ?
En cette période noire, la surexploitation des ressources naturelles et le gaspillage énergétique dément qui caractérisent l’Amérique, sautent aux yeux avec plus de force que d’habitude. La semaine dernière à Miami, en me baladant dans un luxueux shopping mall sur-climatisé, alors que le givre se formait presque sur mes lunettes, l’Amérique m’a fait penser au Titanic fonçant droit sur l’iceberg. L’équipage a enfilé les gilets de sauvetage et mis les chaloupes à la mer. Pendant ce temps, les passagers continuent à danser en sirotant un Manhattan.
Sac de nœuds
Depuis une douzaine d’années, nos fashionistas suiveuses ne jurent que par les sacs à mains géants, limite cabas. Une façon de montrer que, même à minuit chez Régine, on reste une femme hyperactive, à la vie terriblement trépidante. Cette manie, lancée d’abord aux USA, fut hélas exportée chez nous à l’occasion des défilés via les épouvantables chroniqueuses du New York Times et du Vogue US, pour qui tout ce qui est ugly est forcément beautiful. Aussi, nous ne pourrons qu’applaudir l’excellent Karl Lagerfeld, qui a expliqué sur Paris Première, lors de son dernier défilé, ce qu’il pensait de cette tendance lourde : « Quand je vois ces pauvres filles qui s’acharnent à fouiller au fond de leur sac pour essayer de retrouver leur portable, j’ai l’impression qu’elles font les poubelles. »
La drôle de crise
Nous sommes officiellement en crise depuis septembre, comme nous fûmes officiellement en guerre à partir de septembre 1939. Aujourd’hui comme à l’époque, on parle de quelque chose de grave, de très grave, d’encore plus grave qu’avant. En 1939, c’était 1914 qui servait de référence à cette chose catastrophique qui couvait et qu’on soupçonnait d’être encore plus grave, mais sans savoir exactement quel visage aurait cette « gravité », à quel point il y aurait rupture entre le connu et l’inédit. Maintenant, c’est 1929 – l’antichambre de 1939 – qui hante notre imaginaire et alimente tous les fantasmes.
Mais puisque l’histoire, on le sait bien, ne se répète pas bêtement, il y a tout de même quelques différences entre ces deux moments de l’histoire – la drôle de guerre de 39-40 avait ses chansons. Côté français, on déterra la Madelon de 1914 pour remettre le monde dans l’ambiance « poilu », ce mélange vaudevillo-militaire à base de cul et de pinard : « Quand Madelon vient nous servir à boire, Sous la tonnelle on frôle son jupon… » Les Britanniques, quant à eux, débarquaient en France, promettant à pleins poumons et en rimes, non sans un certain culot, d’aller pendre leur linge sur la ligne Siegfried (« We’re going to hang out the washing on the Siegfried Line »). Et le PCF, pour ajouter la petite touche comique dont on le sait coutumier, lançait son mot d’ordre : « Une heure de moins pour la production, c’est une de plus pour la révolution. » Comme quoi pour certains, aujourd’hui comme jadis, le pire semble tout près – un petit effort et on y est !
Sans chansons ni communistes, notre drôle de guerre est un peu tristounette. On nous promet des horreurs, des fin-du-monde-tel-qu’on-l’avait-connu. Et on nous dit que ce truc qui nous est tombé dessus, comme la neige le 15 août, tout le monde l’avait prédit… Du coup on n’a qu’une seule hâte : que ça commence bientôt, que ça arrive, qu’on puisse enfin voir sa gueule, quoi !
Côté bouffe, on est prêt ! Après des décennies d’anathème culinaire, les topinambours et les rutabagas resurgissent dans les meilleurs établissements gastronomiques sous le label rétro de « légumes oubliés », comme quoi le devoir de mémoire ne s’arrête pas à la porte de la cuisine. Fort heureusement, nous n’aurons pas à débourser un centime pour acquérir ces tubercules « qui ont presque le goût de la pomme de terre ». Car, prévoyant comme d’habitude, le gouvernement a fait voter récemment une loi permettant l’utilisation de tickets-restaurant pour l’achat de fruits et légumes, signalant ainsi – mais discrètement pour éviter des mouvements de panique – un retour vers les tickets d’alimentation qui nous rappellent, comme dit l’autre, les marchés les plus noirs de notre histoire.
Et, qui plus est, les ersatz de café et de sucre de jadis – chicorée, orge grillée etc. – ont aujourd’hui droit de cité et sont même plus chers encore que l’original. Les frustrations et privations de nos aïeux sont aujourd’hui tendance.
La récup’ est à la mode, le tricot fait main revient très fort et on nous rebat les oreilles avec le pouvoir d’achat qui dégringole – la parenthèse « baby-boom » se referme et nous redeviendrons pauvres, exactement comme nos grand-parents ! La boucle est bouclée. Qu’elle vienne donc cette crise, et qu’on en finisse car on en a déjà marre !
Football en crise

Du mauvais goût ? A peine. À l’issue du match LOSC-Lyon disputé au Stade de France, deux jeunes supporters ont été tués, happés par un RER, alors qu’ils tentaient de regagner leur bus. Retrouvez chaque jour les impubliables de Babouse sur son Carnet.
La crise œcuménique s’aggrave
Aux dernières informations, il semblerait que l’OPA hostile menée depuis vingt ans par la SARL FSSPX[1. Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.] à l’encontre de l’EUSCA[2. Eglise Une Sainte Catholique et Apostolique.] Inc. n’aboutisse pas. Il n’y aura ni fusion, ni absorption. A travers ce rapprochement, les gérants de l’entreprise familiale sise à Ecône comptaient en effet imposer leurs méthodes commerciales à leur nouveau partenaire. Ils espéraient lui faire abandonner le plan marketing – décidé au Vatican, entre 1962 et 1965 – qu’ils jugeaient un peu audacieux et contraire à leurs statuts. Ils considéraient aussi qu’il s’était accompagné d’une baisse significative de la qualité de la production due, selon eux, à un mauvais respect du savoir-faire traditionnel. La constitution d’une telle holding aurait permis à la FSSPX de devenir leader mondial dans son domaine. En attendant, elle va devoir continuer à affronter la concurrence de l’UCIU[3. Union Catholique Internationale d’Utrecht (Eglise « vieille-catholique »).] et de la CAEF[4. Communautés et Assemblées Evangéliques de France.], cette dernière lui prenant des parts de marché croissantes. Si l’on ajoute la désastreuse campagne publicitaire – bien que n’étant pas conçue par Séguéla – lancée récemment par le country manager de sa branche argentine, la FSSPX traverse une sérieuse période de turbulences qui pourrait bien se répercuter sur sa cote en Bourse. Un jeudi noir en perspective ?
La querelle des amis et des friends
Facebook est mon drame. Avant le lancement de la fameuse plate-forme de socialisation je lisais beaucoup, je voyais des amis, je m’asseyais à la terrasse des cafés de la Contrescarpe pour regarder passer les filles en lisant du Claudel. Bref je vivais. Mais depuis que j’ai un compte sur Facebook, c’est fini. Rideau ! Plus de littérature ! Plus de potes ! Plus de filles ! Maintenant, dès que j’ai cinq minutes à perdre je vais sur Facebook… j’espionne ce que font mes « ex », je m’abonne à des groupes d’intérêt débiles, j’affiche ma pride d’être « fan » de l’Atomium de Bruxelles ou de Xavier Darcos, je laisse des commentaires spirituels sous les photos de mes « friends ». C’est tellement plus moderne d’avoir des « friends » que d’avoir des « amis ». Les amis, ce sont les collègues du bureau, les anciens de la fac, les potes du club de squash. C’est pas top. Les « friends », c’est autre chose. Je compte parmi mes friends de vraies pointures, genre Yves Montand (car, oui, sur Facebook on peut être ami avec des morts)… mais, pour être honnête, ceux que je préfère, ce sont les hommes et les femmes politiques.
Eux je ne sais pas comment ils font avec Facebook. Où vont-ils chercher le temps de renseigner ou modifier leurs profils ? Car sur Facebook, on n’a pas de personnalité, mais un « profil ». Et il faut l’entretenir ce profil, le mettre à jour, changer l’eau des plantes, aérer de temps en temps. Penser à mettre à jour sa « situation » amoureuse. Comment font-ils, mes « friends » politiques pour s’occuper de tout ça ? Parce que c’est du boulot. Il ne faut pas cocher une case à la légère… sur Facebook, tout est question de cases à cocher. Lorsque toute la complexité de l’égo humain se réduit à un « profil » numérique, l’homme ne recherche plus que quatre grandes choses dans la vie : l’amitié, cochez 1, des rencontres, cochez 2, une relation, cochez 3, ou le réseau professionnel, cochez 4. Comment font-ils ces politiques qui possèdent des profils sur Facebook ?
Je sais bien comment ils font : ils font faire le boulot par leurs esclaves habituels. Car l’enjeu est de taille. Communiquer via un « média » aussi moderne qu’un site de socialisation, modernise mécaniquement le discours d’un politique, aussi ringard soit-il. Avoir son « profil » sur Facebook c’est « exister » dans le monde numérique. C’est-à-dire dans le monde moderne.
Un politique, sur Facebook, nous informe d’abord de son emploi du temps, de son activité du moment, et des dossiers sur lesquels il travaille. L’utilisateur de Facebook peut aisément dire au monde entier ce qu’il est en train de faire grâce à la fonction « statut ». L’interface vous demande « Que faites-vous en ce moment ? » – nul ne semble avoir mesuré le caractère policier de cette question. C’est vrai, bordel, que faisiez-vous rue Quincampoix entre 17 heures et 19 heures ? Réponds ! Alors il faut bien dire ce que l’on est en train de faire. Nous autres, mortels, nous avons des vies quotidiennes. Nos « friends » politiques, eux, ont une actualité, qui se déploie dans un emploi du temps diaboliquement serré.
Par exemple, Michel Barnier, le ministre de l’Agriculture, nous informe en ces termes de son actualité : « Savoie : nouveau drame de la montagne. Je serai demain au Lycée agricole de La Motte-Servolex pour dire notre émotion et notre solidarité. » La montagne, cette salope, a encore frappé ! De son côté, Mike Borowsky, des jeunes UMP, est indigné : « Les Jeunes Sarkozystes condamnent l’expédition punitive faite dans un lycée de Gagny. » Qui ne condamnerait pas ce genre d’activités espiègles ? Nicole Guedj, ancienne ministre des « victimes » dans le gouvernement Raffarin, elle-même victime d’un remaniement, nous donne – pêle-mêle – ses opinions sur le dîner du Crif, ou sur le droit des homosexuels. Elle nous informe : « Je me suis tout autant félicitée de l’excellent discours de Richard Prasquier, président du Crif, que de la remarquable intervention de François Fillon. » Nous voilà bien contents.
Certains politiques sont très « agenda »… ils ne vivent que sur rendez-vous. Yves Jégo nous indique ainsi – dans son statut – qu’il « est l’invité de J-M Apathie ce lundi sur RTL », ce qui provoque un certain nombre de réactions enthousiastes de militants : « Bonne chance », « Excellente prestation monsieur le Ministre ! » On voit, d’ailleurs, sur le profil de Jégo cette mention énigmatique : « Yves est désormais marié(e) à Ann-Katrin Jégo. » Le profil de Ann-Katrin renvoie à la fiche d’une jolie blonde souriante. Roger Karoutchi, de son côté, ne parle pas de mariage, il est sur le terrain: « Roger Karoutchi sera avec les adhérents du 16e arrondissement mercredi 11 mars à 19 heures. » Mais à force de creuser son sillon, Karoutchi a laissé passer quelques fautes de goût notoires sur son profil. On repère parmi ses films favoris quelques nanars de bas étages tels que Taxi ou Les rivières pourpres… Ah ! Jeunisme quand tu nous tiens ! Le bougre prétend adorer « faire les courses au Monoprix ». J’offre un calva à la terrasse du Flore à toute caissière de Monoprix ayant croisé un jour Karoutchi.
Le ministre Eric Woerth, de son côté, lâche : « Je serai ce soir l’invité de Laurence Ferrari au JT de TF1 » Le chanceux… immédiatement après le « rendez-vous », les réactions ne tardent pas, de la part des « friends » impressionnés. « Bravo pour votre intervention sur TF1 », « Bravo monsieur le ministre, je suis d’accord avec vous », « Très bonne prestation, toujours aussi brillant et décontracté ! » Facebook, école de l’éloge et de la flatterie. Nathalie Kosciusko-Morizet indique, quant à elle, 4918 amis… et dire que moi je plafonne à 260 environ. Les dés sont pipés d’avance. Nous ne sommes pas du même monde elle et moi…bien qu’elle avoue aimer Barbara et Serge Gainsbourg… Son statut précise : « Nathalie Kosciusko-Morizet discute avec Gilbert Montagné du numérique pour dépasser le handicap. Il est formidable. » Oui, il est foooooooormidable !
Le dissident le plus rebelle de toute l’histoire de l’UMP, J-L Romero n’y va pas avec le dos de la main morte… il s’engage pour de bon, pour en découdre avec les ignobles ennemis de la liberté : « Jean-Luc Romero appelle à la mobilisation pour Florence Cassez ! » Et bien… pas moi. Une admiratrice répond : « que pouvons-nous faire pour Florence Cassez ?? Si je peux vous aider en quoi que ce soit… » Encore une âme de bonne volonté qui va finir par coller des affiches ou ronéotyper des tracts !
A gauche, le profil de Bertrand Delanoë est une perle du genre. Le brillant édile y précise que ses « employeurs » sont « les Parisiennes et les Parisiens »… et leur adresse ces mots pétris d’humanité et d’amour : « J’ai été très touché par vos soutiens, par le nombre et par la qualité des échanges. » Son adjointe, Anne Hidalgo, indique sur son propre profil : « Anne a assisté au triomphe des féminines du Rugby Club Paris XV »… et c’est vrai, un triooooooomphe… Et puis Anne n’est pas la moitié d’une femme, et elle le prouve : « Anne se mobilise en vue de la Journée Internationale des Femmes. » Et moi aussi. J’ai invité une copine au restaurant, et c’est elle qui a payé !
Sans surprise, la plupart des politiques se sont saisis de ce nouveau média de « socialisation » pour en faire un très classique outil de propagande, véhiculant toujours cette même satanée langue de bois. Ces « profils » fantomatiques sont parfaitement inhabités… car les politiques ne sont véritablement accessibles ni à leurs « friends », ni à leurs électeurs. La vraie vie privée c’est pour les « amis », par pour les « friends » – heureusement d’ailleurs. Facebook devait être un nouveau continent à explorer. Ce n’est qu’une ville-fantôme.
Vertige de la mort
La musique se passe, peut-être, comme la littérature, de bons sentiments. Elles n’en épousent pas pour autant, toutes deux, les mauvais. Ni les larmes ni les pleurs ne font jamais une bonne musique, ni un bon texte non plus. Il faut de la vie, de la joie, de l’amour, beaucoup de vie, de joie et d’amour jusqu’à l’excès, pour pouvoir créer quelque chose qui vous surpasse et échappe au nihilisme de tout temps. La chose est claire depuis Bach : Jésus, que ma joie demeure reste l’unique leitmotiv de tout art possible.
Bashung est mort. Il est mort ce soir. On le savait malade, d’une crétinerie qu’on appelle le cancer et qui est, depuis que les médecins se sont mêlés de ces histoires-là, l’autre nom de la vie-même. Il n’avait pas oublié Bach ; il le continuait juste par d’autres moyens. Il y avait même du Kurt Weill, chez cet homme-là : Bashung admirait Weill qu’il avait découvert dans sa jeunesse alsacienne. Et toute l’œuvre d’Alain Bashung n’est jamais qu’une autre tentative sans cesse répétée d’écrire un nouvel Opéra de Quatre-Sous. Ni plus, ni moins.
Voyez, vous qui croyez au rock, vous qui n’y croyez pas, les épousailles célestes de Joséphine et de Mackie Messer. Et Gabi regarde du coin de l’œil. Ils s’aiment et se retrouvent à présent, comme si seule la musique pouvait nous procurer, à nous autres les hommes, les vertiges vrais de l’amour.
L’un de ses plus proches amis, Rodolphe Burger, vous le dira : Bashung était devenu un vrai chanteur à la fin de sa vie. Il avait trouvé sa voix. Non pas celle du crooner aigu qu’il avait été à ses tout débuts, mais cette voix qui unifie le rythme, les paroles et la musique dans un même mouvement.
Et puis, et puis, Alain était un homme. Un vrai. Si vrai que Diogène n’aurait pas eu longtemps à chercher pour en trouver un en notre monde. Loin des people et des show-business plan qui font les mauvais artistes, il était resté lui-même. La première fois que nous nous sommes rencontrés, au hasard des gatherings de la Laiterie à Strasbourg (surprenant et inoubliable bœuf avec Burger, Higelin, Balibar et Bashung), je l’avais entrepris sur Elsass blues, l’une des ses plus inconnues chansons et l’une de mes préférées. Il était déjà malade, mais loin de me traiter de con ou d’importun, nous avons passé deux heures à parler de la musique, de la vie et de nos grands-mères alsaconnes. « Nul chagrin ne peut être supporté si l’on n’en raconte pas l’histoire. » Voilà toute l’histoire du blues, du rock et de la vie qui va : une petite entreprise où l’on recoud sans cesse les cœurs déchirés et les héroïques épopées du hasard.
Bashung est mort, ce soir. Pas de larmes, pas de drame. Aucun œil humide. Un homme ne pleure pas. Juste quelques mots, un petit air de rien. « Faisons envie, restons en vie. Afin que rien ne meure pour que jamais, tu ne m’oublies.[1. Alain Bashung, Faisons envie, album L’imprudence, 2002.] » Et merde, je pleure ce soir. Et je chiale comme un môme qui est déjà un homme.
[mdeezer + 2238925 + M]
Niquez la crise !
Ridicules. Profondément ridicules, les news magazines, qui se nomment hebdomadaires d’information, parce que ça en jette et que ça fait sérieux. Les lecteurs vont donc se bouffer du franc-mac, comme tous les ans une fois au moins. Et deux fois la même semaine, pour deux fois le prix… Il s’agit de démontrer que les Frères noyautent la présidence, le gouvernement et le Parlement. Comme on nous l’a annoncé et vendu déjà pour tous les présidents, tous les gouvernements, tous les Parlements. Rien de neuf donc, dormez braves gens, on se fout de vous, on vous fourgue de la daube, parce qu’on vous prend pour des gogos, des cibles de marketing.
Pire encore, si les Rouletabille du Point et de L’Express avaient fait leurs propres enquêtes, on aurait pu se dire que c’était du journalisme d’investigation, vous savez, cet alpha et cet oméga des gens de plume. Eh bien, non ! Voilà deux hebdos qui font en couv la promotion d’un bouquin, même pas encore paru, de Sophie Coignard, intitulé Un Etat dans l’Etat. Le nouveau journalisme consiste à faire du copié-collé !
Rassurez-vous, personne, dans les rédactions concernées, ne se mettra en grève. La semaine prochaine nous aurons droit au salaire des cadres, ou à Sarkozy et l’argent, à moins que cela n’ait déjà été fait. Encore que les bis repetita ne font pas peur à FOG et Barbier. Plutôt que de porter dans tous les médias la bonne parole hypertinente, on aimerait qu’ils se comportent en laborieux besogneux, et fassent preuve d’imagination.
Et L’Obs, alors ? Le roi des hebdos n’a rien publié sur les francs-maçons, qui pire que les trotskystes noyautent, vérolent et prébendent. Là-bas, un crétin, qu’il me pardonne ma franchise confraternelle, un crétin impardonnable, prétendait tout m’apprendre sur les prix de l’immobilier dans ma région. Peut-être bien que je l’ai attendu ce crétin-marketingueur pour savoir comment se portent les prix de l’immobilier chez moi. Pour cela, j’ai une presse locale et régionale, des journaux d’annonces et des agences à la pelle à un bistrot de distance. Et je n’ai pas attendu qu’un veni-vidi-connerie vienne m’apprendre ce que je sais mieux et plus vite que lui. Mais, dans ce cas encore, il doit se trouver des gogos qui s’imaginent que c’est mieux quand ça vient de Paris, sur papier glacé.
Quand des types payés très cher pour penser, pour réfléchir, pour imaginer, comprendront que ce marketing à la noix, qu’ils mettent à la une chaque semaine est éculé, en dessous de la ligne de flottaison, qu’ils déshonorent une profession entière et qu’ils ne respectent pas leurs clients, qui vont les quitter de plus en plus nombreux, on aura avancé. On peut les prendre pour des prunes, les lecteurs, mais jamais trop longtemps, ils finissent par s’en apercevoir et désertent les kiosques.
Ces remarques, je le sais, sont bien peu confraternelles, mais je n’en retire pas un mot. Parce que ce que tous ces myopes à l’égo enflé sont en train de faire gonfler la bulle qui va les faire crever. Tous ceux qui ne le savaient pas avant l’auront appris de la crise. Une bulle se forme toujours quand on vend quelque chose qui n’a pas de contrepartie. Des actions pourries, des certificats de dette vérolés, et de l’information qui n’en est pas. Pas grave. Ensuite, on ira mendier du fric à l’Etat. Tout en défendant avec des trémolos dans la voix la pluralité, la liberté de la presse et la démocratie et tutti quanti.
Vous, je ne sais pas, mais moi j’ai décidé de ne plus les acheter ces « hebdomadaires d’information », j’aime qu’on me respecte et que pour trois euros cinquante je n’aie pas en plus l’impression, qu’une fois encore, on m’a pris pour une bille. Trois mags à trois cinquante la semaine, multiplié par 52 cela me fait économiser 546 euros par an. En pleine crise, ce n’est pas rien. Cela me rembourse en tout cas largement le prix de ma liaison haut débit. Et, vous allez rire, on en apprend plus et mieux sur la France dans la presse étrangère disponible sur internet que dans nos feuilles nationales. Tant mieux pour elle, tant pis pour elles. Dona eis requiem.
Texte paru sur Homoimbecillus, le carnet de Gérard Scheer.
Le procès Madoff, une escroquerie ?
On le sait, dans l’affaire Madoff, le procureur Marc Litt, a indiqué qu’il allait requérir 150 ans de prison. On ne sait pas si le juge Denny Chin, chargé de déterminer le verdict, le 16 juin prochain, le suivra jusqu’au bout. Après tout, si l’on estime le préjudice à 50 milliards de dollars, ça ne fait jamais qu’un jour de prison par million de dollars volés aux épargnants, ce qui est d’une clémence insigne. D’un autre côté, compte tenu des statistiques d’espérance de vie, il est fort peu probable que Madoff puisse effectuer l’intégralité de son siècle et demi de réclusion. Après avoir sciemment promis des revenus qu’il était bien incapable de verser, Bernard Madoff se verrait cette fois, bien malgré lui, dans l’impossibilité de payer sa dette à la société…
Merci Roselyne !
On finira par trouver ça suspect. Mais il me faut une nouvelle fois voler au secours de Roselyne Bachelot, avant qu’elle ne succombe sous le poids de la critique et qu’il ne subsiste plus d’elle, dépassant des décombres de sa charge ministérielle, qu’un oripeau rosâtre.
Interdire le gras, le sucre, le redbull, l’alcool, les open bars ou le téléchargement gratuit de pinard sur Internet : ce sont là d’excellentes mesures. Eloigner les adolescents de la bouteille relève de la salubrité publique : êtres mi-hommes, mi-enfants, pas tout à fait finis, ils s’occuperont désormais à percer leur bubons d’acné plutôt que de se pochtronner tout habillés de noir.
Il se trouve pourtant quelques esprits chagrins pour regretter les décisions courageuses de la ministre française de la Santé. Savent-ils seulement ce qu’est un adolescent ? En ont-ils jamais vu un de près ? C’est l’animal le plus inutile de toute la Création. Le plus nuisible aussi. Ça geint et gémit, se plaint d’un rien, alterne borborygmes incompréhensifs et cris hystériques. Comme ses cheveux sentent le pubis, l’hygiène publique réclame qu’on le parque loin des odorats normaux, dans ces lycées où il essaie de se reproduire, mais n’y arrive pas, à cause de la muselière inoxydable que lui a posée l’orthodontiste. Donnez un peu d’alcool à cet être vil et repoussant, et vous aurez devant vous le pire : un animal stupide, mais désinhibé.
C’est que la Nature a bien fait les choses : se rendant compte qu’elle s’était trompée en créant l’adolescent, elle l’a chargé d’inhibitions, de névroses et d’une prodigieuse dextérité à rédiger des sms – ce qui a la vertu de le rendre relativement silencieux et amorphe la plupart du temps. Servez-lui un verre et il se met à brailler son malheur à la face du monde comme une génisse qu’on égorge. On ne saluera donc jamais assez le beau geste de Roselyne Bachelot, par lequel elle permet aux adolescents de ne pas sombrer dans les ravages de l’alcoolisme, mais de se soumettre dès leur plus jeune âge aux neuroleptiques et antidépresseurs[1. Et encore, ça ne marche plus à chaque coup : depuis qu’ils surfent sur Internet, ils matent des films X qui leur échauffent les sangs. Là encore, il faudrait sévir.].
Quant à l’interdiction des open bars, il faut être vraiment inconscient pour critiquer cette sage disposition. Je le dis d’autant plus volontiers que je fréquente depuis longtemps les open bars. Dès qu’un ami ou une connaissance sait qu’en France ou en Allemagne un bistrot s’apprête à tenir une telle soirée, il me prévient. J’arrive. Je me mets assise au comptoir et je commande ma première caïpirinha.
Généralement, au bout du douzième verre, le garçon prend un air navré pour me dire qu’il n’a plus de citron vert, plus de cachaça ou plus la force nécessaire pour piler de la glace. A ce moment-là, j’essaie de croiser comme je peux son regard pour le fixer dans les yeux et je lui lance un terrible et retentissant : « Mojito ! » S’il se montre récalcitrant, je me termine au champ, à la vodka, à la bière ou à l’essence de térébenthine. Enfin à ce qu’il reste dans la taule, s’il reste quelque chose.
C’est du moins ce que je faisais jusqu’à ce que, informée d’un open bar dans le coin, je me rende récemment à Berlin. A l’Orya, petit troquet de l’Oranienstrasse[1. Orya, Oranienstr., 22, Berlin-Kreutzberg.], j’assistai au plus touchant des spectacles. Je venais d’entrer, je m’étais installée au comptoir et j’avais à peine allumé ma première cigarette qu’un sournois murmure parvint à mes oreilles : « Elle est là. »
Le patron du bistrot, un Turc du Kreuzberg, pleurait en me regardant. Sa femme lui présenta ses trois enfants dont il baisa le front comme s’il les quittait à jamais, puis elle le serra dans ses bras, effondrée en larmes. Au bout d’un long moment, l’homme se détacha d’elle, passa derrière le bar et se planta devant moi : « Caïpirinha ? »
Il n’eut pas le temps de déposer le bilan après sa soirée open bar. On le retrouva pendu le lendemain matin. C’est dommage, c’était un as de la Caïpirinha.
Impressions d’Amérique
Pardonnez-moi, mais j’aime bien l’Amérique. Il y a encore quatre mois, cet aveu était passible du pire. Mais peut-être n’est-il plus nécessaire de se justifier. Vous l’aurez remarqué, depuis l’élection d’Obama, tout le monde aime l’Amérique ! Même Télérama et Le Monde Diplo, les profs laïcards et les cailleras à keffieh. Everybody loves Barack. Mais tout cela n’est pas très raisonnable et ne devrait pas durer. On attend le moment, proche, où Obama passera chez nous pour un Oreo cookie, noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur. Un digne successeur de Bush, version light, un Sarkozy basané qui sème la zone aux quatre coins de la planète. On en reparlera le moment venu.
Comme toute personne normalement constituée, je dois la majorité de mes émois culturels à des artistes américains[1. Note d’EL : Ah ? Proust, Mozart, Dostoïevski, Shakespeare… bons à jeter, cher David ? Je dois être anormalement constituée.]. Des Ramones à Philip Roth en passant, au hasard, par Elvis, Kurt Cobain, John Ford, Larry Clark ou les Marx Brothers, la société américaine a enfanté une cohorte de génies en tous genres. Il m’est donc permis d’émettre quelques réserves sans entrer dans le club très couru chez nous des antiaméricains primaires (« l’antiaméricanisme, le progressisme des cons », comme disait Pascal Bruckner).
Je me suis rendu une bonne cinquantaine de fois aux États-Unis en tant que journaliste. J’y ai habité un moment, et j’ai même trouvé le moyen d’épouser une de leurs ressortissantes. Si je connais un peu ce pays et sa société, ce n’est pas uniquement à travers les livres de Philippe Labro, les films du populiste Michael Moore et les revues de la presse étrangère de Marie Colmant.
Mes deux derniers voyages au pays de l’Oncle Sam, en pleine crise des subprimes, m’ont particulièrement marqué. La déconfiture économique est une chose dans la bouche de Jean-Pierre Gaillard, elle devient une réalité écrasante quand on discute avec l’Américain moyen qui vit dans une ville moyenne où les maisons mises en vente forcée (foreclosure) se comptent par dizaines de milliers. Ils font froid dans le dos, ces panneaux bank owned ou for sale by owner, plantés devant la porte des pavillons. A Fort Myers, Floride, on voit des camions de déménagement à tous les coins de rue. Sur les pelouses, on voit des frigos, des vélos, ou les tuyauteries que les familles vendent avant de partir refaire leur vie ailleurs. Des quartiers entiers ressemblent à des villes fantômes. Il y a encore quelques mois, ces mêmes familles organisaient des barbecues avec leurs voisins. Les types en pantalon chino partaient au boulot en 4X4 le matin et les femmes rejouaient Desperate Housewives en veillant sur leurs têtes blondes. L’American way of life, dans toute sa banalité, semblait devoir durer pour toujours. Game over.
Aujourd’hui, c’est le même spectacle d’exode un peu partout aux États-Unis. Pour autant, et c’est peut-être le plus surprenant, pas de panique apparente, pas d’émeutes (imaginez la même chose en France…). On serre les dents. On parle d’une passe difficile, mais jamais de la fin d’une époque dorée. Il ne semble venir à l’idée de personne que l’American way of life, le modèle économique du pays basé sur la consommation de masse, doit être sérieusement remis en cause. « In this economy, difficile de s’offrir ceci ou cela », disent les gens en grimaçant. « In this economy, this… In this economy, that… » Comme si l’économie, cet animal imprévisible et coquin, n’allait plus tarder à reprendre ses esprits. Comme si la sortie de route des classes moyennes n’était qu’un accident – terrible, certes –, et que le plan de relance d’Obama allait bientôt permettre de refermer cette sinistre parenthèse.
« L’american way of life n’est pas négociable », avait dit George Bush père en 1992 au moment de la première guerre du Golfe. La doctrine n’a pas changé depuis l’élection d’Obama. Le nouveau locataire de la Maison Blanche ne se risquera jamais sur ce terrain aussi tabou qu’impopulaire. Par une sorte d’aveuglement idéologique, la sortie de la crise du crédit n’est jamais associée à la nécessité d’un aggiornamento. Obama parle tout juste d’un improbable virage vert (quand l’empreinte carbone d’un Américain équivaut à celle de quatre Allemands…). Bref, pas question de briser le rêve, même si le cadre se fissure de tous côtés. Qu’on ne s’y trompe pas, l’Américain moyen ne ressemble pas du tout au branché de la côte Ouest qui conduit une voiture hybride, recycle ses déchets, a renoncé à la clim et aux sacs en plastique… Le péquin de base, qui forme l’immense majorité de la population sans la collaboration de laquelle rien ne pourra changer, consomme toujours comme une brute, n’a pas renoncé à son 4X4, et jongle avec les cartes de crédit pour continuer comme si de rien n’était. Obama parviendra-t-il à convaincre le péquin de base de changer de comportement ? En a-t-il seulement la volonté ?
En cette période noire, la surexploitation des ressources naturelles et le gaspillage énergétique dément qui caractérisent l’Amérique, sautent aux yeux avec plus de force que d’habitude. La semaine dernière à Miami, en me baladant dans un luxueux shopping mall sur-climatisé, alors que le givre se formait presque sur mes lunettes, l’Amérique m’a fait penser au Titanic fonçant droit sur l’iceberg. L’équipage a enfilé les gilets de sauvetage et mis les chaloupes à la mer. Pendant ce temps, les passagers continuent à danser en sirotant un Manhattan.