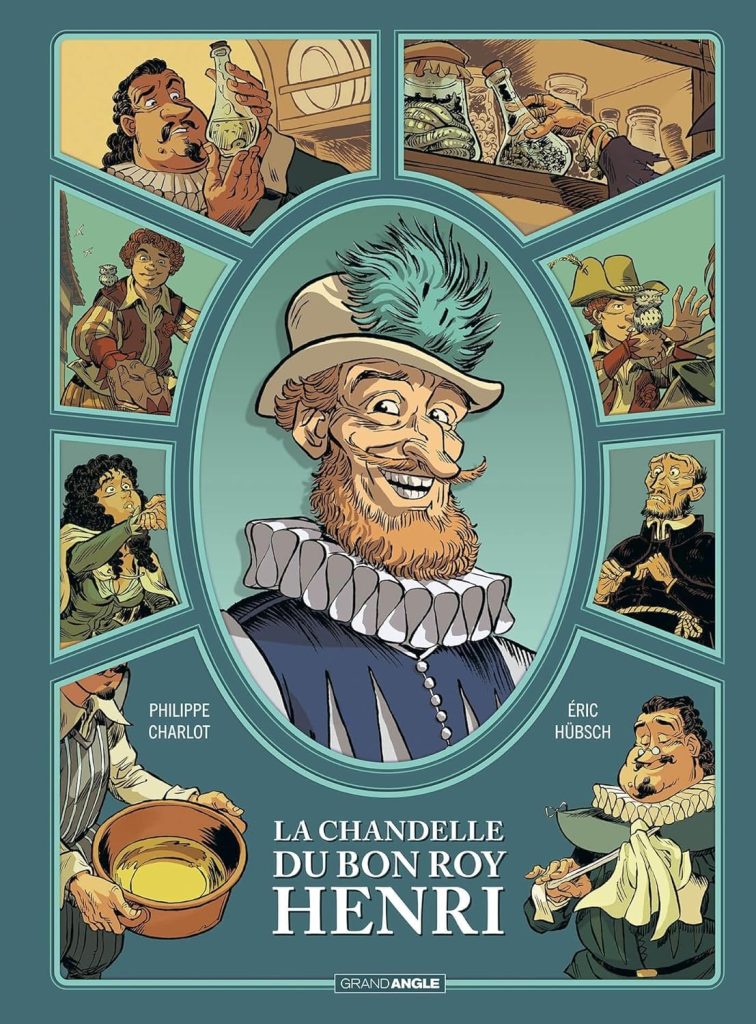Le ralliement à Trump d’Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos illustre le chamboulement qui s’opère dans les hautes sphères au rayon visionnaires. Il est devenu impossible de suivre la bêtise vaniteuse des anciennes élites, tant leurs procès rituels en « fascisme » ou en « complotisme » ont obscurci les clairvoyances.
Bonne nouvelle : la crise d’encéphalite dont souffre le monde intellectuel français depuis des décennies a trouvé son vaccin. Les penseurs embrumés qui voient de la niaiserie à appeler un chat un chat se montrent réceptifs à l’épreuve du nez dans le réel. Cette approche rudimentaire, expérimentée aux États-Unis, a déjà éteint quelques feux dans les cerveaux. Le remède contre la contagion utopiste s’annonce prometteur. Donald Trump en est le promoteur avec sa « révolution du réel ». Le nouveau président américain, qui a prêté serment le 20 janvier, n’est certes pas du sérail des clercs : les beaux esprits persistent majoritairement à ne voir en lui qu’un lourdaud. Néanmoins, sa force d’attraction révèle une excellence dans le passage à l’acte. Cette dextérité est moins sophistiquée que celle des vendeurs de nuages, mais elle est plus convaincante. Ce savoir-faire tient à un pragmatisme et à une indifférence aux morsures de la meute. L’affolement de l’intelligentsia rétive à la piqûre du terrain laisse voir la fragilité de sa gonflette cérébrale.
Le ralliement à Trump d’Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, pionniers géniaux de la Silicon Valley, illustre le chamboulement qui s’opère dans les hautes sphères des visionnaires. Il est vrai qu’il est devenu impossible de suivre la bêtise vaniteuse des anciennes « élites », tant leurs accusations rituelles en « fascisme » ou en « complotisme » ont obscurci les clairvoyances. Quand la ministre Aurore Bergé, qui sait prendre le vent, déclare : « Ce n’est pas être d’extrême droite que de dire les faits » (Europe1/CNews, 5 janvier), elle exprime une évidence qui, si elle n’a pas encore atteint son camp « progressiste », met déjà en péril la tyrannie des penseurs de travers, des marcheurs sur la tête, des déconstructeurs de ce qui fonctionne bien. L’offensive de la Macronie contre les empêcheurs de ratiociner entre soi achève de caricaturer le pouvoir actuel en club vétilleux et intolérant. L’oligarchie politique découvre, avec la reconnaissance post-mortem des alertes visionnaires de Jean-Marie Le Pen, disparu le 7 janvier, son impuissance à maintenir la chape de plomb du politiquement correct et de ses charabias.
À lire aussi du même auteur : La victoire culturelle de Trump sonne le glas du vieux monde
Entendre Emmanuel Macron, devant la conférence des ambassadeurs, accuser Musk d’être le fer de lance d’une « nouvelle internationale réactionnaire » dit son enfermement manichéen. Le Premier ministre François Bayrou revêt les mêmes « habits neufs du terrorisme intellectuel » (Jean Sévillia) lorsqu’il voit dans le patron de X (ex-Twitter) la figure du « nouveau désordre mondial ». De quoi ces camelots en pensées éclairantes ont-ils peur ? D’entendre les peuples gronder. La libéralisation des réseaux sociaux, qui subissaient les contrôles des États et le militantisme des vérificateurs de faits (« fact-checkeurs »), a été vue comme « une menace pour la démocratie » par Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale. La ministre du numérique, Clara Chappaz, a mis en garde contre les « fausses opinions ». Ces apparatchiks ont été rejoints par tout ce que la gauche compte de mal embouchés et de cagots. Les censeurs réclament, après CNews, le boycott ou l’interdiction de X. La presse de cour dresse ses listes de parias. Cette France-là a tourné le dos à Mirabeau. Il écrivit, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. »
La crise de l’intelligence, liée à la peur des faits, a fait des ravages chez les décideurs. Leur univers paranoïaque les a amenés à assimiler la contradiction à un « propos haineux » méritant la sanction. Dans cette dystopie, le confort intellectuel ne tolère que la pensée unique. Pour ne pas désigner des musulmans, les viols de fillettes anglaises commis par des gangs pakistanais en Grande-Bretagne durant des années ont été occultés par la police, la justice et la presse, avant que Musk s’en émeuve. Zuckerberg a avoué avoir cédé aux pressions du FBI et de la Maison-Blanche en imposant l’omerta de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) sur les magouilles du fils Biden en Ukraine, ou sur les effets secondaires du vaccin Covid. L’ex-commissaire européen Thierry Breton a menacé, de son bras long, de faire annuler les élections en Allemagne, à l’instar des élections roumaines, en cas de victoire de l’AfD jugée trop à droite. Le gouvernement français, incarnation du centrisme immobile, se montre incapable d’aborder les sujets existentiels pour leur préférer des marchandages entre partis afin d’assurer sa survie. Le petit monde pense petitement. Le lapsus de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, proposant le 3 janvier, à l’issue du premier Conseil des ministres, de rendre compte du « conseil municipal », était un aveu.
Comment s’étonner, dans ce contexte qui fait de l’impertinent esprit français une anomalie, de voir la santé mentale érigée en grande cause nationale ? Les alertes apocalyptiques sur les virus ou le climat ont démoralisé les plus vulnérables. Le pays prend des allures d’asile psychiatrique quand l’homme enceint est promu par le Planning familial ou quand les délires « transgenrés » deviennent accessibles aux adolescents. À Lyon, la majorité écologiste a subventionné une formation d’agents municipaux pour qu’ils prennent en compte « les intérêts des vivants non humains » afin de dialoguer avec le coquelicot ou le bouleau pleureur (Le Figaro, 19 décembre 2024). Sébastien Delogu (LFI) s’est comparé, sur Twitch, à un oiseau pour réclamer la fin des frontières. Dans Libération (16 janvier), Geoffroy de Lagasnerie a proposé d’« abolir la notion de crime ». D’autres réclament l’égalité entre l’homme et l’animal, etc.
Mais l’antidote est à portée de main. Justin Trudeau, figure du conformisme, a déjà démissionné. Avant Trump, George Orwell avait donné le mode d’emploi de la guérison : « L’évidence, le stupide bon sens et la vérité doivent être défendus. Les truismes sont vrais. Il faut s’appuyer là-dessus. Les pierres sont dures, l’eau est mouillée, les objets qui tombent sont soumis aux lois de la gravité. Cela une fois admis, tout le reste s’ensuit1. » À suivre, donc.
Découvrez notre nouveau magazine : Panique dans le camp du bien, la tech passe à droite
- Cité par Pierre Boncenne dans Le Parapluie de Simon Leys, Philippe Rey, 2015. ↩︎