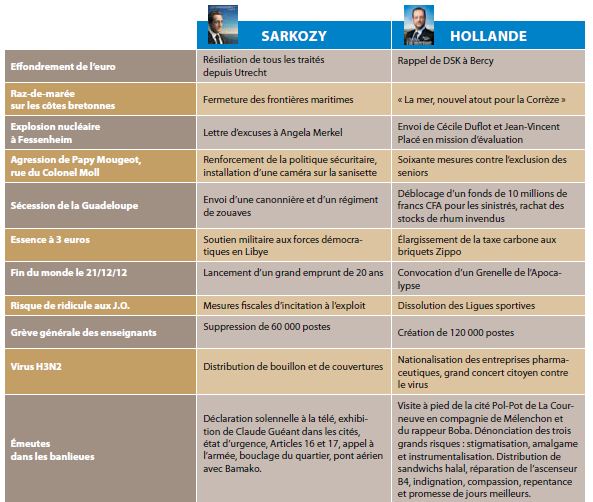Si l’Europe n’était pas exsangue, Alain de Benoist compterait certainement parmi ses intellectuels organiques. Depuis plus de quatre décennies, le cofondateur du GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne) chemine à travers les ronces du prêt-à-penser sans jamais avoir renoncé à sa passion pour le Vieux Continent. Ses autocritiques successives l’ont tour à tour fait récuser le nationalisme de ses jeunes années militantes, le suprématisme ethnique, enfin le libéralisme et l’occidentalisme. Homme aux « valeurs de droite » et aux « idées de gauche », cet aristocrate qui en appelle au pouvoir du peuple cultive le paradoxe sans jamais céder aux « idéologies à la mode ».
Sans Dieu ni maître, l’auteur de Comment peut-on être païen ? a toujours refusé d’apparaître comme le prophète de la « Nouvelle Droite ». L’expression l’avait d’ailleurs agacé dès son apparition en 1979, lorsque « l’été de la Nouvelle Droite » mit sur le devant de la scène ce trentenaire capable de discuter des théories physiques de Stéphane Lupasco, des racines païennes de l’Europe comme de la conception nietzschéenne du temps sphérique. Dix ans après la création du GRECE, ses jeunes animateurs investirent Le Figaro Magazine, sous l’œil admiratif de Louis Pauwels, jusqu’à ce que l’antilibéralisme et le tiers-mondisme d’Alain de Benoist apparaissent pour ce qu’ils étaient : de vigoureux antidotes aux faux totems de l’époque.
À l’orée des années 1990, son intérêt croissant pour les sciences sociales et la critique du capitalisme lui firent croiser la route du décroissant Serge Latouche, des penseurs communautariens[1. Contre la séparation libérale entre le juste et le bien, les communautariens estiment que la définition commune de la justice s’appuie sur une certaine conception de la vie bonne.] nord-américains ou des eurasistes russes, avant que l’affaire des « rouges-bruns » déclenchée contre L’Idiot International musèle le débat public pendant une bonne vingtaine d’années.
« Penser, c’est d’abord penser contre soi » aime rappeler cet érudit – toutes langues confondues, sa légendaire bibliothèque compte plus de 150 000 volumes ! – qui cite volontiers Jünger et Montherlant, les socialistes Proudhon et Sorel – auquel il a emprunté le titre de la revue Nouvelle École – mais aussi Bertrand de Jouvenel, Carl Schmitt et d’innombrables autres références qui mériteraient d’être lues plutôt que de comparaître devant le tribunal de l’Histoire.
Si nous vous livrons les « bonnes feuilles » de Mémoire vive[2. Mémoire vive, Alain de Benoist, Entretiens avec François Bousquet, Bernard de Fallois, 2012. En librairie à partir du 2 mai.], ses entretiens avec François Bousquet, c’est pour rendre sa juste place à cet intellectuel de 68 ans encore promis à un long avenir. Ni « sulfureux » ni réprouvé, Alain de Benoist appartient à l’engeance rebelle. Lisez plutôt !
I. Nouvelle Droite et musèlement du débat public
La plus grande partie de votre vie s’est confondue avec ce qu’on a appelé la « Nouvelle Droite ». Je suppose que, là aussi, il y a un bilan à faire. De votre point de vue, la ND a-t-elle été (est-elle) une réussite ou un échec ?
Un peu des deux, bien entendu. La ND a été une grande et belle aventure de l’esprit. Elle n’a pas réussi à infléchir le cours des choses, c’est le moins qu’on puisse dire, mais le corpus idéologique et intellectuel qu’elle a mis en place est considérable. Des milliers de pages et plus d’une centaine de livres ont été publiés, des centaines de conférences et de colloques ont été organisés. La ND a participé à quantité de débats, elle en a elle-même suscité plusieurs. Qu’il s’agisse des questions religieuses (paganisme et critique du monothéisme), de Georges Dumézil et des Indo-Européens, de la Révolution conservatrice, des traditions populaires, de Julien Freund et Carl Schmitt, de la critique de la Forme-Capital, de l’anti-utilitarisme, de l’écologisme, etc., il est clair que sans elle beaucoup de discussions auxquelles on a assisté n’auraient pas eu le même caractère[…]
Ce qui frappe le plus, c’est à la fois l’originalité des thèses de la ND – elles ont des antécédents, mais pas de prédécesseurs – et sa durée d’existence. Si l’on met de côté l’Action française, qui a été un phénomène tout différent, puisqu’il s’agissait aussi d’un mouvement politique, je ne vois en France aucun autre exemple d’une école de pensée ayant fonctionné de façon ininterrompue pendant près d’un demi-siècle. Nouvelle École a été créée en 1968, Éléments en 1972, Krisis en 1988. Ces trois revues paraissent toujours aujourd’hui, alors que tant d’autres publications n’ont eu qu’une existence éphémère. […] Ce qui est sûr, c’est que la ND a d’ores et déjà sa place dans l’histoire des idées, mais que cette place demande encore à être exactement cernée. Ceux qui sy emploieront verront que nous avons certes exploré des pistes qui se sont révélées stériles, abandonné certaines idées qui ne menaient pas à grand-chose, mais que dans l’ensemble, lorsqu’il s’est agi d’analyser la société actuelle, nous ne nous sommes guère trompés. Nous avons même souvent été en avance. J’avais personnellement annoncé l’« Europe réunifiée » dès juin 1979. Au début des années 1990, au moment où Francis Fukuyama proclamait la « fin de l’Histoire », nous avions organisé un colloque sur le thème du « Retour de l’Histoire », ce qui n’était pas si mal vu. J’ai aussi publié en octobre 1998 un article intitulé « Vers un krach mondial ? » C’était dix ans tout juste avant la grande crise financière qui s’est déclenchée aux États-Unis à l’automne 2008.
En ce début de XXIe siècle, que peut encore apporter la ND ?
Ce qu’elle a toujours cherché à apporter : une conception du monde, une intelligence des choses, des pistes de réflexion. La ND peut aider à comprendre l’époque où nous vivons, et plus encore celle qui vient. Elle peut aider à formuler des alternatives et à éviter les faux pas. Elle peut contribuer à « décoloniser l’imaginaire », comme le dit Serge Latouche. Elle peut laisser entrevoir un au-delà de la marchandise. Elle peut donner un fondement à la volonté des peuples et des cultures de maintenir leur identité en se donnant les moyens de la renouveler. C’est déjà beaucoup. […]
Vous parlez de tout cela avec beaucoup de détachement, alors qu’on vous a constamment présenté comme le « pape » ou le « gourou » de la ND…
Voilà bien deux termes ridicules. Je ne suis certainement pas Benoi(s)t XVII, et je suis le contraire même d’un gourou. Je n’aime pas plus commander qu’être commandé. Et surtout, je n’ai jamais été environné d’une cour d’admirateurs inconditionnels. Autour de Maurras il y avait des maurrassiens, autour d’Alain de Benoist il n’y a pas de « bénédictins ». Ce serait même plutôt le contraire. Durant toute ma vie, c’est toujours dans mon proche entourage que j’ai rencontré le plus de résistances, et il n’y a sans doute pas un tournant idéologique que j’ai pris pour lequel je n’ai pas eu d’abord à convaincre ceux qui m’entouraient […] Idéologiquement parlant, la Nouvelle Droite n’a jamais été totalement homogène et je pense que c’est une bonne chose, car cela a permis de nourrir le débat intérieur. Sur le plan religieux, par exemple, à côté d’une majorité de païens, il y a toujours eu chez elle des chrétiens, des athées, des traditionalistes, des spiritualistes, des positivistes scientistes. Cette diversité se retrouve dans son public, y compris sur le plan politique. Voici quelques années, une enquête réalisée auprès du lectorat d’Éléments avait révélé que 10 % des lecteurs se classaient à l’extrême droite, 12 % à l’extrême gauche, tandis que 78 % se positionnaient ailleurs.
Au cours de son histoire, la ND a fait l’objet de bien des commentaires flatteurs, mais aussi d’innombrables attaques, parfois même violentes, ou du moins sans aucun rapport avec ce que peuvent être des polémiques intellectuelles. Vous avez vous-même été complètement ostracisé dans certains milieux. Comment l’expliquez-vous ?
La ND a en fait été traitée d’à peu près tout. On l’a décrite comme giscardienne, gaulliste, favorable au Front national, hostile au Front national, fasciste, nazie, communiste, etc. D’une manière générale, je dirais que, pendant trente ans, la stratégie des adversaires de la ND a consisté à lui attribuer des idées qu’elle n’avait pas pour éviter d’avoir à discuter de celles qu’elle soutenait. […] Mieux encore : je n’ai pratiquement jamais lu un article dirigé contre moi qui argumentait à partir de quelque chose que j’aurais dit ou écrit. J’étais quelqu’un de sulfureux, mais on ne disait jamais pourquoi. […] L’une des raisons en était que les auteurs de ces textes avaient eux-mêmes en général une culture limitée dans les domaines en question, et étaient même très souvent pratiquement incultes. […]
Il y a bien sûr d’autres raisons. D’abord, comme vous le savez, n’est intellectuellement légitime en France que ce qui vient de la gauche. Un passé d’extrême droite, fût-il lointain, est une sorte de tunique de Nessus. Quand on dit d’un homme qu’il a appartenu dans sa jeunesse à l’extrême gauche, on décrit un épisode de son parcours ; quand on dit qu’il a appartenu à l’extrême droite, on veut suggérer qu’il y appartient toujours. Ernst Jünger, devenu centenaire, se voyait encore reprocher certains de ses articles de jeunesse ! Il faut par ailleurs tenir compte de la détérioration du climat intellectuel. À partir de la fin des années 1980, une véritable chape de plomb s’est abattue sur la pensée critique. Tandis que la montée du Front national engendrait un surmoi « antifasciste » relevant totalement du simulacre, on a vu à la fois se déchaîner les tenants de ce que Leo Strauss appelait la reductio ad hitlerum et s’instaurer un « cercle de raison » dominé par l’idéologie dominante. Cela a abouti à la « pensée unique », pour reprendre une expression que j’ai été le premier à employer. Par cercles concentriques, quantité d’auteurs se sont progressivement vu retirer l’accès aux haut-parleurs. On n’a pas cherché à réfuter leurs thèses, on leur a coupé le micro. L’important était que le grand public n’ait plus accès à leurs œuvres. Prenons mon exemple personnel. Jusque dans les années 1980, je faisais paraître assez régulièrement des tribunes libres dans Le Monde. Mes livres étaient publiés chez Robert Laffont, Albin Michel, Plon, La Table ronde, etc. De surcroît, ce n’est jamais moi qui les proposais à ces éditeurs, mais les éditeurs en question qui me les demandaient. Après 1990, il n’en a plus été question, et j’ai dû me rabattre sur des éditeurs plus marginaux. Comme il est très improbable que je me sois mis à écrire soudainement des choses insupportables, il faut bien en conclure que c’est le climat qui avait changé. Peut-être les choses sont-elles aujourd’hui en train de tourner dans le domaine des idées, il me semble que l’on assiste à un léger réchauffement climatique, mais pendant près de trente ans, cela a vraiment été les « années de plomb ». […]
Au fond, c’est le manichéisme qui vous gêne.
Je le déteste en effet. Non seulement parce que j’essaie toujours de viser à l’objectivité, mais aussi parce que j’ai un sens des nuances extrêmement aigu. C’est pour cela que j’aime les différences, et c’est pour cela que je me défie de l’absolu. Il y a des idées que je défends parce que je les crois justes, mais qui ne me plaisent pas du tout. J’aimerais qu’elles soient fausses, mais l’honnêteté m’oblige à les reconnaître pour vraies […] Il y a toujours une part de mauvais dans ce que nous estimons le meilleur, une part de bon dans ce que nous jugeons le pire. C’est une infirmité de ne pas s’en rendre compte. Elle révèle le croyant dogmatique ou l’esprit partisan dans ce qu’il a de plus pénible. […] Comprendre n’est pourtant pas approuver. Mais on ne s’embarrasse plus de ces nuances. Et le pire est que les adversaires du sectarisme ambiant n’ont bien souvent à lui opposer qu’un contre-sectarisme, c’est-à-dire un sectarisme en sens contraire. Voilà ce qui me désole. […] En février 1992, lors d’un déjeuner auquel Jean Daniel m’avait invité dans les locaux du Nouvel Observateur en compagnie d’Alain Caillé, Jacques Julliard avait affirmé que « la haine est plutôt de gauche, tandis que le mépris est plutôt de droite ». J’ai souvent réfléchi à ce propos, qui me paraît contenir une large part de vérité. Le mépris s’exerce du haut vers le bas, tandis que la haine exige une perspective plus égalitaire : si tous les hommes se valent, il n’y a que la haine pour justifier leur exclusion absolue. On rétorquera que bien des hommes de droite ont eux aussi fait preuve de comportements haineux et aussi de brutalité et de dureté, ce qui n’est certes pas faux. Cependant, il y a aussi à droite un thème que l’on ne trouve que très rarement à gauche : c’est l’estime pour l’adversaire, non pas bien qu’il soit mon adversaire, mais au contraire parce qu’il est mon adversaire, comme le dit Montherlant, et parce que je l’estime à ma mesure […] La gauche reste de ce point de vue plutôt robespierriste : l’ennemi est une figure du Mal, et le Mal est partout (c’est le principe même de la « loi des suspects » qui a inspiré tant de mises en accusation publiques à l’époque de la Terreur) […] Vous remarquerez aussi que lorsqu’un homme de gauche tient des propos « de droite », les gens de droite applaudissent, tandis que lorsqu’un homme de droite tient des propos de « gauche », les gens de gauche jugent aussitôt qu’il n’est « pas net », qu’il cherche à se « démarquer », à « récupérer », etc. Toujours le sectarisme.
II. Europe/États-Unis
Est-ce parce qu’ils incarnent géopolitiquement la puissance maritime que vous avez si constamment critiqué les États-Unis ?
Pas seulement. La critique des États-Unis a pris son essor, au sein de la Nouvelle Droite, après la parution fin 1975 du numéro de Nouvelle École sur l’Amérique (dont la matière a été reprise dans un livre publié en langue italienne, puis en allemand et en afrikaans). Elle est une sorte de conséquence logique de la distinction que nous avions faite alors entre l’Europe et l’Occident. Elle est depuis restée plus ou moins constante. On aurait tort cependant de l’interpréter comme relevant d’une quelconque phobie. Je suis allergique à toutes les phobies, à l’américanophobie comme aux autres. L’un des numéros d’Éléments publié voici quelques années avait d’ailleurs pour thème « L’Amérique qu’on aime » ! Je ne suis pas non plus de ceux qui critiquent l’Amérique sans la connaître. J’y suis allé maintes fois, j’y ai séjourné à plusieurs reprises, je l’ai sillonnée en tous sens […] J’ai toujours eu la plus vive admiration pour le grand cinéma américain quand il ne se ramenait pas encore à une accumulation de niaiseries stéréotypées et d’effets spéciaux et surtout pour la grande littérature américaine : Mark Twain, Herman Melville, Edgar Poe, William Faulkner, John Dos Passos, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Henry Miller, etc. […] Par la suite, je nai jamais dissimulé non plus ce que je dois, non seulement à mes amis de la revue Telos, mais à Christopher Lasch et aux communautariens américains. Mais bien entendu, j’ai aussi vu les revers de l’« american way of life » : l’obsession de l’intérêt calculable, la société de marché, la culture conçue comme marchandise ou comme « entertainment », la conception technomorphe de l’existence, les rapports hypocrites entre les sexes, la civilisation automobile et commerciale (il y a plus de véritable socialité sur le moindre marché africain que dans n’importe quel supermarché californien !), les enfants obèses élevés par la télévision, l’apologie des « winners » et la fuite en avant dans la consommation, l’absence si fréquente de vie intérieure, la restauration rapide, l’optimisme technicien (il faut être « positif », tout finira par s’arranger, puisqu’il y a une solution « technique » à tout), le mélange d’interdits puritains et de transgressions hystériques, d’hypocrisie et de corruption, etc. […] Loin de professer la moindre américanophobie, c’est plutôt l’europhobie des Américains et, au-delà, leur attitude vis-à-vis du « reste du monde » que je mettrai en cause. Les Pères fondateurs, lorsqu’ils sont venus s’installer en Amérique, ont d’abord voulu rompre avec une culture politique européenne qui leur était devenue étrangère et insupportable. Empreints de culture biblique tout autant que de philosophie des Lumières, souvent marqués par le puritanisme, ils voulurent créer outre-Atlantique une nouvelle Terre promise, une « cité sur la colline » (a city upon a hill), qui se tiendrait à distance de la vieille Europe, mais deviendrait en même temps le modèle d’une civilisation universelle d’un type jamais vu. Toute leur politique étrangère vient de là. Depuis les origines, elle n’a cessé d’osciller entre l’isolationnisme qui permet de se tenir à l’écart d’un monde corrompu et la mise en œuvre sans états d’âme d’une « destinée manifeste » (Manifest Destiny) assignant aux Américains la mission d’exporter dans le monde entier leur mode de vie et leurs principes. Américaniser le monde, pour beaucoup d’Américains, c’est du même coup le rendre compréhensible !
Et l’Europe, la tête de pont de la « puissance continentale » ? Dans quel état se trouve-t-elle aujourd’hui ?
Dans le pire état qui soit. Au célèbre Congrès de La Haye de 1948, deux conceptions différentes de la construction européenne s’étaient affrontées : celle des fédéralistes comme Denis de Rougemont, Alexandre Marc et Robert Aron – auxquels on peut ajouter Otto de Habsbourg –, et celle du couple Monnet-Schuman, d’inspiration purement économique. C’est malheureusement la seconde qui l’a emporté. Pour Jean Monnet et ses amis, il s’agissait de parvenir à une mutuelle indication des économies nationales d’un niveau tel que l’union politique deviendrait nécessaire, car elle s’avérerait moins coûteuse que la désunion. L’intégration économique, autrement dit, devait être le levier de l’union politique, ce qui ne s’est évidemment pas produit. La « déconstruction » de l’Europe a commencé au début des années 1990, avec les débats autour de la ratification du traité de Maastricht. Elle n’a cessé de s’accélérer depuis. Mais c’est dès le départ que la construction de l’Europe s’est faite en dépit du bon sens. Quatre erreurs principales ont été commises. La première a été de partir de l’économie et du commerce au lieu de partir de la politique et de la culture. Loin de préparer l’avènement d’une Europe politique, l’hypertrophie de l’économie a rapidement entraîné la dépolitisation, la consécration du pouvoir des experts, ainsi que la mise en œuvre de stratégies technocratiques obéissant à des impératifs de rationalité fonctionnelle. La seconde erreur est d’avoir voulu créer l’Europe à partir du haut, c’est-à-dire des institutions bruxelloises, au lieu de partir du bas, en allant de la région à la nation, puis de la nation à l’Europe, en appliquant à tous les niveaux un strict principe de subsidiarité. La dénonciation rituelle par les souverainistes de l’Europe de Bruxelles comme une « Europe fédérale » ne doit donc pas faire illusion : par sa tendance à s’attribuer autoritairement toutes les compétences, elle se construit au contraire sur un modèle très largement jacobin. Loin d’être « fédérale », c’est-à-dire de reposer sur le principe de compétence suffisance, elle est même jacobine à l’extrême, puisqu’elle conjugue autoritarisme punitif, centralisme et opacité. La troisième erreur est d’avoir préféré, après la chute du système soviétique, un élargissement hâtif à des pays mal préparés pour entrer dans l’Europe (et qui ne voulaient y entrer que pour se placer sous la protection de l’OTAN) à un approfondissement des structures politiques existantes. La quatrième erreur est de n’avoir jamais voulu statuer clairement sur les frontières géographiques de l’Europe – ainsi que l’a montré le débat à propos de la Turquie – ni sur les finalités de la construction européenne. Enfin, l’Europe n’a cessé de se construire en dehors des peuples, et parfois même contre eux. On est même allé jusqu’à formuler un projet de Constitution sans que jamais ne soit posé le problème du pouvoir constituant. Quoi d’étonnant que, lorsqu’on parle aujourd’hui de l’Europe, les termes qui reviennent le plus souvent sont ceux d’impuissance, de paralysie, de déficit démocratique, d’opacité, d’architecture institutionnelle incompréhensible ? Pendant des décennies, la construction européenne avait été présentée comme une solution ; elle est devenue un problème de plus, que personne ne sait plus résoudre.
Pourtant, la construction politique de l’Europe reste à mes yeux une nécessité absolue. […] On ne peut d’abord oublier qu’au-delà de ce qui les distingue, et qui doit évidemment être préservé, tous les peuples européens sont issus d’une même matrice culturelle et historique. Il est évident, d’autre part, à une époque où les logiques stato-nationales deviennent de plus en plus inopérantes, que c’est seulement à l’échelle continentale que l’on peut faire face aux défis qui se posent à nous actuellement. […] À mes yeux, la vocation naturelle de l’Europe est de constituer un creuset original de culture et de civilisation en même temps qu’un pôle indépendant capable de jouer, dans un monde multipolaire, un rôle de régulation vis-à-vis de la globalisation. […] Le projet européen manifeste une incertitude existentielle aussi bien stratégique qu’identitaire, que les souverainistes et les eurosceptiques ont beau jeu d’exploiter. Nietzsche disait : « L’Europe ne se fera qu’au bord du tombeau. »
*Photo: Hannah Assouline.