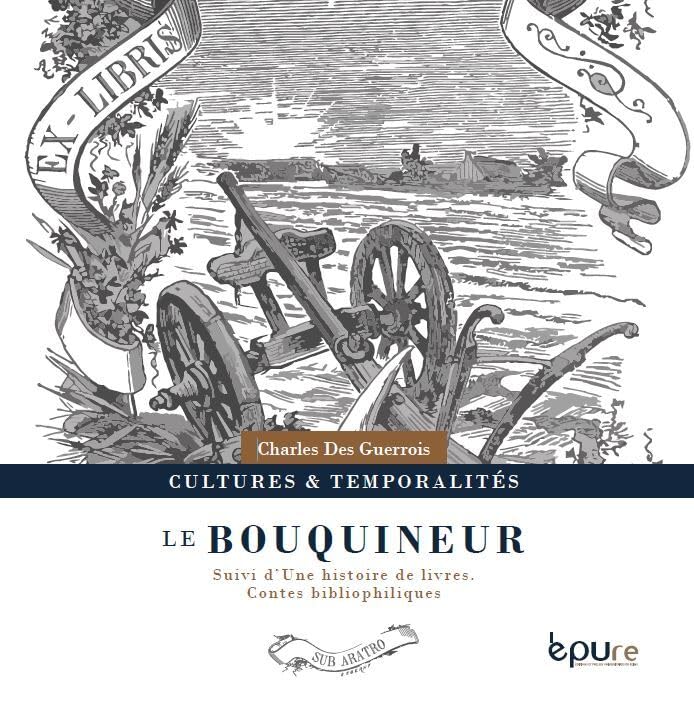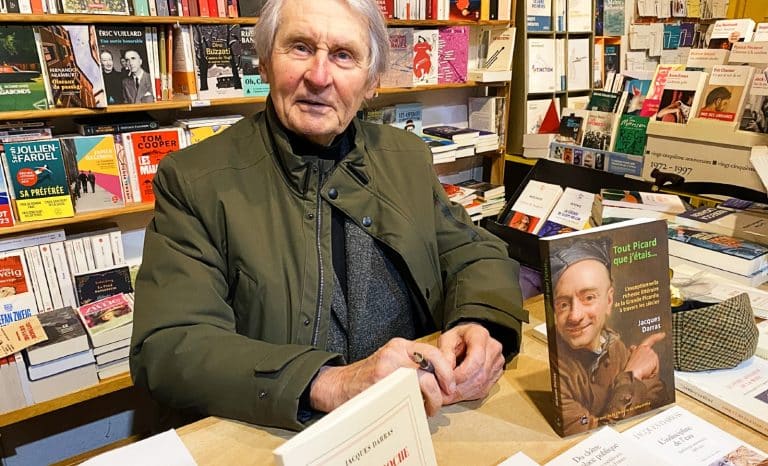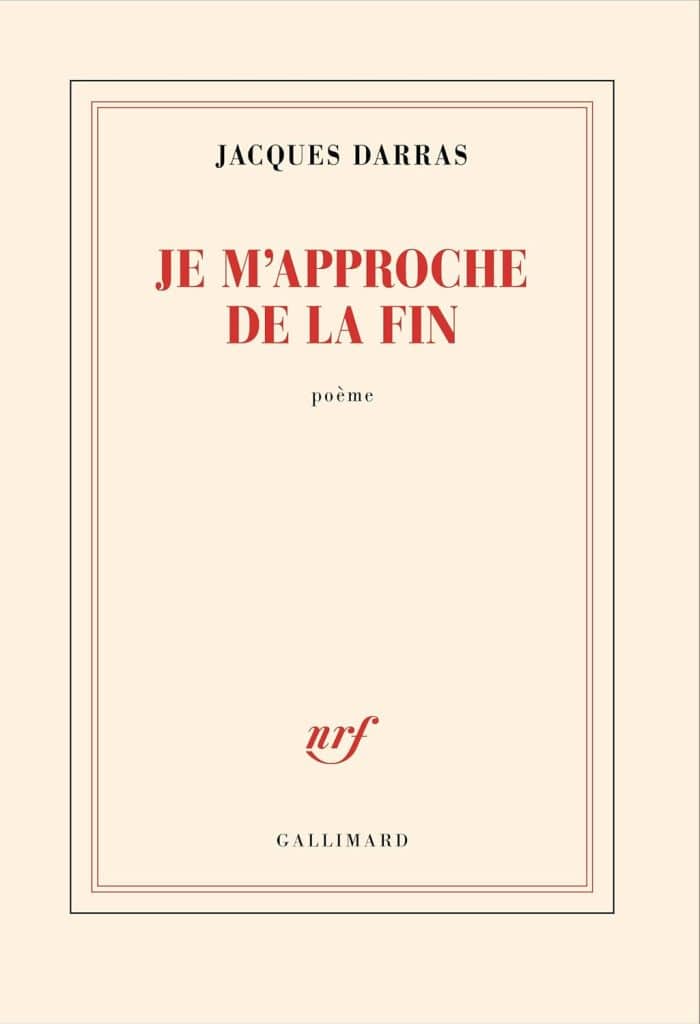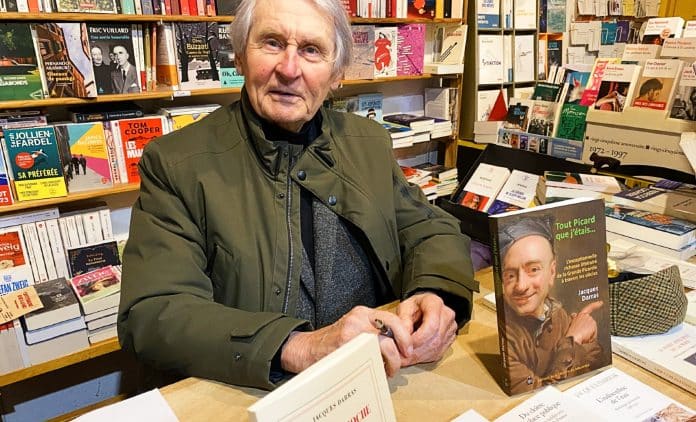À travers ce monologue intérieur fictif, l’auteur explore les réflexions, les ambitions et les obsessions d’un Donald Trump complexe et controversé dans un style à la fois drôle et incisif
(Bruits de fond: musique et brouhaha sous la rotonde du Capitole)
Mon cochon, je vais leur en donner pour leur argent! Et le petit vieux assis, là, sur ma gauche, je vais enfin me le farcir, et publiquement. Ǫuand je pense à toutes les avanies que j’ai dû subir, il m’en a fait avaler, des couleuvres. Oui, oui, vous ne voyez que les grands titres, vous les Européens faiblards. Vous n’avez jamais reçu une lettre d’avocat américain? Où l’on vous menace de rendre bagnoles, toutes vos clefs, votre meuf, et des foudres judiciaires à perpétuité? Alors vous n’avez pas vécu. Avec évidemment les frais d’avocats qui s’empilent sur votre bureau, les heures à soupeser chaque angle de votre défense, les myriades d’options qui se présentent à vous? A ce petit jeu, les échecs relèvent de la maternelle. Et je vous dis pas, j’en ai eu pas un, pas deux, pas trois, mais des dizaines de procès! N’importe qui d’autre que moi, Donald Trump, se serait déjà pendu dans son garage. Eh bien non! Je vais leur en donner, du fil à retordre, et leur offrir un bout de corde pour leur propre bon plaisir!
Bon, il faut que je me calme, dans quelques instants, ça va être l’inauguration. Ah, si papa voyait ça. Sûr qu’il m’encadrerait mon portrait sur sa table de chevet.
(voix du maître de cérémonie: …Donald J. Trump!”)
Dans deux minutes la fête, les gars!
Ehehehehe, (regard peu amène vers les “ex”), ils sont tous parqués sur ma gauche comme des sardines, toutes ces huiles. Ca doit les vexer, hein, d’être obligés de se frotter les uns contre les autres sur des chaises. Et tous ces capitaines d’industrie, ils ne viennent que pour moi! Pas pour vous! Même Bernard prend des vues de la coupole avec son portable, tiens si ça se trouve, il fait un clip pour la prochaine pub de Dior. Accroche-toi Elon, ça va être une fusée, mon speech. A plusieurs étages, et ca va se télescoper, comme tu aimes faire. OK OK, ça va être mon tour. Il est bien ce JD Vance, sa petite Mirabel apporte juste la touche qu’il fallait du haut de ses 2 ans. C’est quoi déjà le nom de sa nounou? Faudra lui demander à l’occasion. Barron, lui, il a pas besoin de talonnettes comme certains. Je lui ai juste demandé de pas trop bailler. Et Melania! Sombre à souhait, exactement ce que je lui avais demandé. Par contre, son bolero, on aurait dû répéter pas facile de lui faire un bisou. Je suis sûr qu’elle l’a fait exprès, histoire de m’emmerder un peu, mais quand même, c’est autre chose que Jill ou Brigitte. A mon goût seule Carla fait le poids, mais son tour est passé. Où en étais-je? Ah oui, ça va être à moi. Dans deux minutes la fête, les gars!
Ǫuand je pense que tous ces prétentieux de Bruxelles et des alentours sont devant leurs écrans. Et Emmanuel, hein? Ben non, je sais même pas qui le représente. De toutes façon il m’aurait fait la leçon sur le tableau à ma gauche, avec Washington, Lafayette, et le troisième je ne me souviens plus. Ah si, Rushonboy, on m’a dit que ça se prononçait comme ça. Avant, je savais pas que le drapeau blanc était pas celui des anglais, mais des français. Faut dire qu’ils ont la réputation de se rendre facilement. C’est quand même incroyable qu’on a été sauvé par des cheese eating surrendering monkeys. “Notre plus ancien allié”, j’ai appris ça par cœur sur les fiches qu’on me donne à chaque fois que je le rencontre. Si ça lui fait plaisir… C’est pas un mauvais bougre, et puis j’ai toujours aimé les ors de Versailles, d’ailleurs c’est ma signature en décoration. Tiens, il faudra que j’y pense, il faudrait peut-être redécorer le Lincoln bedroom, plus lugubre tu meurs.
Bon, OK, revenons à nos moutons. Ah oui, j’oubliais, il faut poser la main sur la Bible. Ca tombe bien, Melania en a apporté deux, l’une d’entre elle doit venir de sa mère, l’autre de la première inauguration. Je vais faire semblant, après tout, si je pose pas la main sur la couverture, personne ne va rien me dire, non? Vous vous rendez compte, les gars! Je suis le seul! Le seul depuis Grover à être élu deux fois de suite à 4 ans d’intervalle.
Faire ! Faire ! Faire !
“45-47”, qu’on m’appelle! C’est quand même autre chose que 46! “I solemnly swear “… c’est facile, il n’y a qu’à répéter ce que me dit Roberts en face. “that I will faithfully execute the Office of President of the United States,” c’est un peu long, mais ça va encore “and will to the best of my ability” ça s’est pas mal trouvé, on s’engage juste à faire de son mieux, mais ce n’est pas une obligation de résultat. J’aurais dû mettre cette clause dans mes contrats d’Université Trump, ça aurait évité pas mal d’ennuis, “preserve, protect and defend the Constitution of the United States”. Ca, c’est pas gagné, mais ils n’ont rien compris. L’important, c’est de faire, on va pas s’embarrasser d’arguties. Faire, ne pas parler pour ne rien dire, comme ils le font tous. D’ailleurs, c’est bien pour ça qu’ils sont des millions à m’élire. Faire! Faire! Faire! Je vais leur en donner, ils ont encore rien vu. Et voilà! Voilà le travail les gars, c’est fait!! C’est fait!! Bon, à mon tour de les épater.
(brouhaha et silence, le téléprompteur affiche la première phrase: Thank you very much everybody, well, thank you very very much…”)
Bon, il faut que je pose le ton. Pas d’emballement. OK, les remerciements aux uns et aux autres, je m’en fiche un peu, mais c’est le protocole. Allez, à présent, attaque, Jeannot! “L’âge d’or des Etats-Unis commence dès maintenant. A partir de ce jour notre pays va prospérer et être à nouveau respecté à travers le monde….”
Ce qu’il y a de bien , avec le téléprompteur, c’est que je n’ai qu’à lire, à poser, et pauser entre les applaudissements. Pas mal, non? Ils sont bien nourris, beaucoup plus enthousiastes que ceux du discours de Joe il y a 4 ans, quand il m’a volé l’élection. Et regardez comme ils se lèvent, OK, certains avec difficultés, de très rares, pas du tout, mais de toutes façons c’est des has been. Ce qu’il faut bien vous mettre dans la tête, les gars, c’est que je ne plaisante pas. Ah oui!! Vos cris d’orfraie m’amusent. De toutes façons, vous n’avez jamais rien compris à l’Amérique. Pour vous c’est les cowboys et les indiens, et en plus John Wayne était un affreux facho qui cassait du Viet. Vous pensez vraiment que la planète se casse la gueule. Vous rêvez, les mecs! Si jamais vous aviez une seule fois conduit trois jours d’affilée dans l’ouest, vous comprendriez qui nous sommes, nous les Américains. Pas des mauviettes qui tendent l’obole dès que vous avez un bobo. Nous, on bâtit, on explore, on innove, et je vais te les libérer, toutes ces énergies. Mes sans-dents à moi, je vais leur en donner de l’essence, et de la bonne, et pas chère. On va évidemment trouver comment rendre la planète meilleure, c’est nous qui avons inventé l’électricité!
Et puis, toutes ces normes qui polluent la vie, ça c’est de la vraie pollution. On a failli en crever, je vais remettre les choses à l’endroit. Rendre libre le citoyen. D’ailleurs, je vais virer sur le champ 80,000 fonctionnaires, s’ils veulent rester, qu’ils aillent bosser sur la frontière mexicaine! Ah! Ils pensent que c’est pas possible de renvoyer les gens à la case départ, et comment ça? Dès que je me reviens dans le bureau ovale, ça va valser, les décrets. 200 sont déja prêts. Pourquoi attendre 100 jours?
Plan de bataille…
Bon, OK, tout ça, s’est du convenu, de l’emballage. Dans quelques instants, je vais leur dire ce que j’ai vraiment dans la tête.
“C’est la Révolution du sens commun”. Pas mal, la formule, non? On m’a dit qu’il y a avait eu un parti en France, ou en Italie, je sais, qui avait déja trouvé la formule dans les années 50 je crois. Eh alors? Cest pas une marque déposée, non? Aucun sens des affaires, ces éphètes.
Bon, on va donner les têtes d’affiche, les têtes de gondoles, quoi. Je me marre!!
Primo: “urgence nationale à notre frontière sud!!” Eh, pas mal, non? Tout le monde se lève à cette annonce! Je continue… Arrêt immédiat de toutes les entrées illégales et politique d’expulsion « les immigrants illégaux doivent rester au Mexique » “Envoi de troupes à la frontière sud pour repousser l’invasion, les cartels seront désignés comme des organisations terroristes étrangères, avec la résurrection de Alien Enemy Act de 17S7 et permettre élimination des gangs étrangers. “En tant que commandant en chef, je défendrai notre pays”. Voilà, ça c’est envoyé. Ǫu’on ne vienne pas me dire que c’est pas faisable!
Secundo: “vaincre l’inflation record, faire baisser les prix. L’urgence nationale : nous allons forer, ma chérie, forer! “(Tiens au fait, qu’est-ce qu’elle est devenue la Sarah Palin, toujours avec son boyfriend en Alaska? Faudra que je demande, elle a peut-être besoin d’un poste d’ambassadrice des pôles. “Nous avons les plus grandes réserves de pétrole et de gaz sur terre, et nous les utiliserons. Nous redeviendrons une nation riche grâce à l’or liquide qui se trouve sous nos pieds…” Ca tombe tout de même sous le sens, non? “Nous taxerons les pays étrangers pour enrichir nos citoyens”. On m’a fait la réflexion, qu’un ambassadeur de France ici à Washington, dans les années 20, un Claude Paul, ou Paul Claude ou Claudel, je sais plus, avait déjà critiqué cette politique. Bon, ils vont et viennent, ces gens- là, de toute façon personne ne lit leurs dépêches. Je me marre!!
Tercio– “Création d’un Département de l’Efficacité Gouvernementale”. A toi de jouer, Elon! Tu vas me les faire maigrir, tous ces rapiats! Je peux pas les piffrer. Tous à vivre à nos crochets, et prétentieux, et imbus d’eux même, et sentencieux, et obséquieux, non mais, pour qui ils se prennent?? “Arrêt de la censure gouvernementale”, “retour de la liberté d’expression en Amérique”, “Rétablir une justice équitable, égale et impartiale dans le cadre de l’État de droit”, “Rétablir la loi et l’ordre dans nos villes”, “Mettre fin à la politique d’ingénierie sociale du gouvernement en matière de race et de sexe dans tous les aspects de la vie publique”, “affirmer l’absence de couleur de peau et le principe du mérite” (ça, ça devrait impressionner Macron, non??) “réaffirmation de l’existence des deux sexes : masculin et féminin”, et toc! un point c’est tout, toutes ces conneries, au placard! “reversement intégral des salaires à ceux qui ont été expulsés du service militaire en raison de leurs refus de vaccination anti-Covid”, là, je trouve qu’on fait très fort, et qu’on ne vienne pas me dire que je ne fais pas dans le social!
“Pour les forces armées, leur seule mission est de vaincre les ennemis de l’Amérique” “Une armée la plus forte nous permettra de gagner des batailles, ou mieux encore, des guerres dans lesquelles nous n’entrerons jamais”, “Je veux être un artisan de la paix et un rassembleur”, “inspirer la crainte et l’admiration du monde entier”. On aurait tort de me chatouiller, qu’on se le dise! Ils n’ont pas encore vu comment l’Oncle Sam pouvait donner des baffes à qui il veut.
“Le golfe du Mexique n’est plus, vive le Golfe d’Amérique, le mont McKinley reprendra son nom d’origine, le Panama sera récupéré, car le traité a été violé, les navires américains ont été surtaxés et n’ont pas été traités équitablement. De plus, nous ne l’avons pas donné à la Chine, nous l’avions donné au Panama et nous le reprenons.” Voilà, c’est dit, et ça va mieux en le disant, comme me le disait Macron l’autre jour à Notre-Dame. Je n’ai pas voulu le vexer, mais je crois que c’est bien nous les Yankees qui avons donné plus de 60 millions de dollars, mais un bon nombre d’entre eux pensaient donner à l’équipe de football de Notre Dame. Enfin, tant pis, c’est quand même pas mal cette rénovation. Melania a trouvé les chasubles pas mal, je me fie à elle. Par contre les gribouillis de maternelle sur les fanions des paroisses qui ont défilé alors là, j’ai rien compris, eux qui ont des fanions fleurs-de-lys depuis 1000 ans, même que chez nous c’est le summum du style, même dans l’Indiana des villes ont la fleur de lys sur leurs logos. Enfin, c’est leur affaire, si ça leur fait plaisir, il y a plus important quand même. J’espère qu’ils ont mis des sprinklers comme à la Trump Tower, mon poste incendie-sécurité que j’ai installé en 1988 est toujours au top.
Un phénix renait de ses cendres
OK, OK, je m’égare, où en étais-je? Ah oui, c’est pas mal, non? de ressusciter
La doctrine Monroe, vieille de 200 ans. J’ai pas re-cité le Danemark, mais franchement, il n’a rien à faire au Groenland. Et puis, soyons bon prince, je laisserai St Pierre et Miquelon à Macron.
Allez, c’est le moment “JFK”: “nous irons sur la planète Mars, et on y plantera la bannière étoilée!” Génial, je vois Elon sauter de joie. Eh oui chers amis du monde entier, “nous sommes un people d’explorateurs, de bâtisseurs, d’aventuriers”… le far ouest est “dans notre cœur, dans notre âme.” “La nature sauvage, les déserts, la fin de l’esclavage, la maîtrise de l’électricité, la séparation des atomes, c’est nous. Il n’y a rien que nous ne puissions faire, aucun rêve que nous ne puissions réaliser ». “Le peuple américain a parlé. En Amérique, l’impossible est ce que nous faisons de mieux. Nous allons gagner comme jamais auparavant”, “Rien ne se mettra en travers de notre chemin”, “L’âge d’or ne fait que commencer”.
“Thank you, thank you, thank you very much”. Ça a de la gueule, non?
Fin du discours, poignées de mains – DJT se retrouve quelques instants plus tard dans la salle Emancipation Hall du rez-de-chaussée, où l’attendent tous ses fidèles et proches.
Ǫuel plaisir d’être enfin entre amis! Tous ceux là, ce sont vraiment les miens. Je vais leur dire que j’en ai un peu gros sur la patate de ne pas avoir pu tout dire dans la salle du haut. Mais là, je vais me lâcher, et attendez un peu mon discours à l’Arena, j’ai prévu d’offrir huit stylos à la foule, et 200 autres décrets m’attendent au bureau ce soir. On va se régaler!
Faudra quand même que je lui dise, à Johnny qui m’a conseillé dans mon speech. Je n’ai pas eu le temps de le lire, mais il était quand même pas mal, ce Zarathoustra. J’ai bien noté, et je re-servirai sa formule à l’occasion: “Deviens celui que tu es”. À demain, si vous le voulez bien!