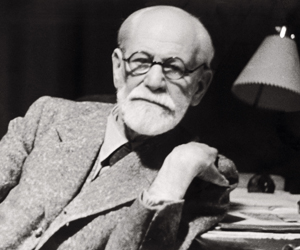Que faisiez-vous le 3 octobre 1980 ? Et d’abord, cette date vous dit-elle quelque chose ?
C’est peu probable : dans le présent perpétuel imposé par le temps médiatique, l’amnésie est programmée. Elle ressemblait à quoi, d’ailleurs, la France d’octobre 1980 ? Si proche, si lointaine… Une France avec des cabines téléphoniques à pièce, des R5 orange, trois chaines télé et Véronique Jeannot en assistante sociale qui faisait fantasmer les adolescents en pantalon de velours milleraies. Ah, on allait oublier : Giscard était président et il était certain de remporter une victoire facile au mois de mai de l’année suivante. Pensez-vous, en face, on n’avait à lui opposer qu’un François Mitterrand usé, vieilli, fatigué, à la tête d’une gauche désunie, d’un PS qui ne se remettait pas de l’insurrection ratée de Rocard et d’un PCF qui ne croyait plus trop à l’union de la gauche. L’Etat-UDF était là pour dix ans, au moins.
Il y avait bien cette montée du chômage consécutive au deuxième choc pétrolier, ce Chirac et ses archéo-gaullistes qui criaient à la trahison devant l’intégration européenne, cette inflation à 14% mais enfin on avait pour Premier ministre le meilleur économiste de France, un certain Raymond Barre, qui voyait tous les matins le bout du tunnel. On en avait fini avec les gauchistes de 68. Durant la décennie précédente Marcellin les avait traqués, fichés, embastillés. Les ex-maos commençaient leur reconversion dans la finance, la presse, les instances patronales.
De toute manière, ils n’avaient jamais représenté un vrai danger terroriste, ces couilles molles de la Gauche prolétarienne, en refusant la lutte armée contrairement à leurs camarades italiens ou allemands. Les Années de plomb, c’était bon pour Berlin ou pour Rome. Chez nous, les plus dangereux, ceux d’Action Directe n’étaient qu’une poignée et la plupart étaient en taule. Non, vraiment, on ne risquait rien. Finalement, c’était le rêve, la France de 1980 et, comme dans la chanson de Nino Ferrer, ça aurait pu durer au moins un million d’années.
Seulement voilà, le 3 octobre 1980, à 18 h 48, au 24 de la rue Copernic, dans le XVIe arrondissement, une bombe explose devant une synagogue. C’est soir de shabbat et aussi le lendemain de simhat torah, la fête de la joie. Raison pour laquelle près de trois cent personnes sont venues assister à la cérémonie. La plupart appartiennent à une obédience plutôt modérée, éclairée, celle de l’Union libérale israélite de France. La synagogue, à l’occasion est fréquentée par Simone Veil ou Robert Badinter.
À l’intérieur, c’est la panique. Du verre entaille les chairs, les faux plafonds s’effondrent. Il y a des blessés, beaucoup.
À l’extérieur, comme l’écrivent Jean Chichizole et Hervé Deguine, les auteurs de L’affaire Copernic, « c’est Beyrouth sur Seine , avec une colonne de fumée dépassant les immeubles environnants et des voitures projetées sur la chaussée comme des jouets d’enfants. » On relèvera quatre morts, un étudiant à moto, une journaliste israélienne, le chauffeur d’une famille présente dans la synagogue et le concierge de l’hôtel Victor Hugo. Il faut dire que les terroristes n’ont pas lésiné. 10 kilos de pentrite, un explosif militaire dans une Suzuki bleue. La bombe a évidemment explosé trop tôt : elle était prévue pour faire un véritable carnage au moment de la sortie de la synagogue.
L’affaire Copernic est un livre qui, au-delà de son aspect documentaire qui évoque e un roman d’espionnage, a le mérite de remettre cet événement en perspective et de demander si finalement, il ne s’agirait pas là d’une date tragiquement fondatrice, celle qui fait passer d’un monde à l’autre sans qu’on en prenne forcément conscience sur le coup. Il y a les dates évidentes, choc pétrolier, arrivée de la gauche au pouvoir, chute du Mur et puis il y a aussi ces dates apparemment moins importantes et dont les lignes de forces, pourtant, sont souterraines et se répercutent jusqu’à aujourd’hui.
Pour les deux auteurs, cet attentat marque une rupture. C’est lui qui fait entrer la France dans l’âge du terrorisme international, celui qui va toucher régulièrement le pays que ce soit avec l’attentat de la rue des Rosiers en 1982, ceux de l’automne 86 qui culminent avec l’explosion devant la Fnac de la rue de Rennes, celui de la station RER Saint Michel en août 95 ou de Port Royal en décembre 96.
Presqu’une habitude, en fait, au point que l’on trouve miraculeux de ne pas avoir (encore) été touché par les répliques européennes du 11 Septembre, Madrid 2004, Londres 2005…
Se pencher sur l’attentat de la rue Copernic, c’est donc se pencher sur l’origine du mal.
La première chose qui surprend, dans le récit de Chichizola et Deguine, c’est la maladresse politique du pouvoir de l’époque. Raymond Barre, par exemple, dont le premier commentaire sur l’événement est de l’ordre du monstrueux lapsus : « Je rentre de Lyon plein d’indignation pour cet attentat odieux qui voulait frapper les juifs se trouvant dans cette synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. » Des Français innocents… Ou encore le Président de la république qui ne fera part de son émotion que le 8 octobre, soit cinq jours plus tard.
Comme quoi on a oublié que la France de ces années-là avait à sa tête une droite, celle des républicains indépendants comme on disait alors, dont l’ADN politique puisait plutôt du côté de Vichy et d’Uriage que de Londres, et qui n’hésita pas de surcroît à recycler en jeunes loups modernistes les anciens d’Occident. L’antisémitisme, à l’époque, n’était donc pas franchement celui des banlieues des années 00 mais faisait partie du charme discret d’une certaine bourgeoisie libérale et technocratique. C’est Alain de Rotschild d’ailleurs, président du Crif à l’époque, qui s’indigne de « la passivité des pouvoirs publics devant le terrorisme international. » Et Simone Veil elle-même, ministre de la Santé, prise à partie par des manifestants, est obligée de reconnaître qu’elle regrette « la relative discrétion du gouvernement. »
Pourtant, à la base, loin des timidités des politiques, un flic va faire son boulot et va bien le faire. Il s’agit de Marcel Leclerc, le patron de la Crim. Il va d’abord explorer la piste la plus évidente, celle d’un attentat néo-nazi. Il y avait alors un grand revival de la croix gammée en Europe. On s’occupait tellement du terrorisme rouge qu’on en avait oublié le noir qui se révélait pourtant beaucoup plus aveugle, beaucoup plus meurtrier et ouvertement antisémite : le 2 août 1980, ce sont 80 morts en gare de Bologne et le 26 septembre de la même année, 13 morts et 200 blessés à la fête de Munich. Pour la presse française dans son ensemble et pour une bonne partie de la classe politique, Copernic s’inscrit dans cette liste. On a même un groupe sous la main, la Fane (fédération d’action nationaliste européenne) dirigé par Marc Fredriksen déjà poursuivi pour délit de presse, Fane devenue FNE (faisceaux nationalistes européens) après sa dissolution.
La piste est d’autant plus délicate que ce groupuscule est composé de pas mal de policiers dont on ne sait plus s’ils sont infiltrés et sympathisants. Et pour arranger le tout, le nouveau chef des FNE croit intelligent de revendiquer l’attentat alors qu’il apparaît assez vite qu’il en est logistiquement incapable. Leclerc, même si ça ne plaît pas montre que tout ça ne tient pas.
Reste donc la piste internationale, c’est-à-dire, parlons clair, arabe, c’est-à-dire palestinienne, via Chypre et le Liban. Problème : la diplomatie française est d’une prudence extrême dans la région et refuse que les enquêteurs français aillent sur le terrain, à Beyrouth. Et puis Ibrahim Souss, représentant de l’OLP à Paris et Arafat lui-même ont condamné sans ambiguïté l’attentat. Seulement voilà, une scission du FPLP de Habache, le FPLP-CS apparaît alors comme la piste la plus sérieuse. L’affaire est confiée à la DST.
On ne retracera pas ici toutes les péripéties d’une enquête de vingt huit ans qui semble s’être provisoirement terminée en octobre 2008 avec l’arrestation d’un très respectable professeur de sociologie d’Ottawa, d’origine libanaise, par la police montée canadienne. Il y aurait de quoi, en effet, dans ce livre, faire le bonheur terrifié d’un John Le Carré.
Il faut le lire, peut-être pour cela, et aussi pour comprendre ce qui se joue aujourd’hui à savoir notre capacité à vivre, en permanence, avec l’idée du terrorisme de masse comme une éventualité, voire une probabilité. Et que cela, dans l’inconscient français, ne remonte pas au 11 septembre 2001 mais bien à un certain 3 octobre 1980.
Ce soir-là, pourtant, il semblerait, d’après les archives de la météo nationale, que la température ait été exceptionnellement douce.