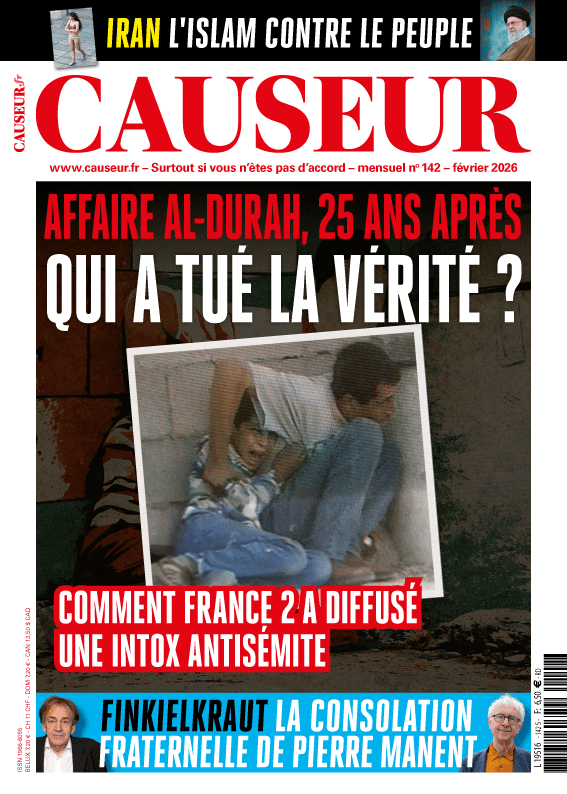Bruno Mégret réagit à la mort de Jean-Marie Le Pen. L’ancien numéro 2, qualifié de « félon » en 1998 par le « Menhir », s’était finalement réconcilié avec son ancien ennemi. Il partage avec nous quelques souvenirs.
Causeur. Au moment de rejoindre le Front National, vous dirigiez votre propre structure les CAR, parfois présentée comme concurrente. Comment s’est déroulée votre première rencontre ou prise de contact avec Jean-Marie Le Pen ? Qui en fut à l’initiative ?
Bruno Mégret. Au lendemain des élections de 1981 et de la victoire de Mitterrand, je fais l’analyse qu’il existe dorénavant une place pour un nouveau parti, un vrai parti de droite qui serait porteur d’un grand projet de renouveau national libéré de l’emprise idéologique de la gauche. C’est pour initier ce projet ambitieux qu’avec quelques proches, nous lançons les Comités d’action républicaine, les CAR. Lesquels rassemblent très vite de nombreux Français notamment parmi ceux qui accusent les partis de droite d’avoir laisser la gauche gagner en ne s’opposant pas clairement à elle. Forts de ce soutien, nous commençons à constituer une petite force politique : quinze mille adhérents, cent vingt comités. Aussi, dans la logique qui était la nôtre décidons-nous de présenter une liste aux élections européennes de 1984. Hélas, nous ne parvenons pas à rassembler les fonds nécessaires et Le Pen, qui lui a réussi à présenter une liste, réalise un score spectaculaire de près de 10 %. Dès lors les jeux sont faits. C’est Le Pen qui va créer le parti politique nouveau que je pensais possible de faire émerger à la droite du RPR. La dynamique est désormais de son côté.
C’est dans ce contexte que je réponds à l’invitation d’un ami chef d’entreprise qui organise un déjeuner chez lui avec Le Pen et d’autres personnalités. Je découvre alors un homme intelligent et cultivé qui développe une analyse fine de la situation politique du pays. Analyse que je partage. Je me reconnais aussi dans la plupart des idées et des convictions qu’il exprime. Bref, je découvre une personnalité beaucoup plus riche et intéressante que celle qu’en donnait le prisme déformant des médias. Lui aussi remarque les nombreux points qui nous rapprochent. Mais les choses en restent là.
Et rien ne se passe jusqu’à ce que Le Pen annonce qu’aux élections législatives de 1986, il ne présentera pas que des candidats FN mais qu’il fera appel à des personnalités d’ouverture non membres de son parti, les uns et les autres adoptant l’étiquette de « Rassemblement national ». Je me dis alors qu’il faut saisir cette opportunité et je prends contact avec Le Pen, ou plutôt c’est Patrick Buisson, partisan de ce rapprochement, qui nous met en relation. La rencontre a lieu à Montretout et nous nous mettons facilement d’accord sur le dispositif par lequel les CAR se joindront au FN dans le cadre du Rassemblement national pour les élections législatives et régionales. Deux circonscriptions éligibles sont prévues pour Jean-Claude Bardet et moi-même ainsi qu’un quota de conseillers régionaux. Une relation de confiance s’établit d’emblée car lorsque nous nous quittons, aucun papier n’est signé et nous ne nous reverrons pas avant la campagne électorale. Pourtant les accords seront respectés : je suis élu député de l’Isère et Jean-Claude Bardet est hélas battu de justesse à Nancy.
Les journalistes et les historiens vous accordent une place importante dans le développement et la professionnalisation du Front National à partir de la fin des années 1980. Le contrôle ou l’influence sur l’appareil ont souvent été décrits comme une lutte constante entre courants idéologiques ou lieutenants de Jean-Marie Le Pen (Bruno Gollnsich, Carl Lang, Jean-Pierre Stirbois et vous-même). Qu’en était-il ? Y avait-il un tel climat de méfiance ?
En 1988, lorsque j’ai commencé à me déplacer en province à l’invitation des fédérations, je me suis rendu compte que le parti était en effet très fragmenté. Telle fédération par exemple était principalement composée de militants défenseurs des artisans commerçants et PME style poujadistes, d’autres étaient monopolisées par d’anciens partisans de l’Algérie française comme d’autres l’étaient par des adeptes de la Nouvelle droite. Et bien sûr, ces courants étaient tous représentés à l’échelon national, une situation qui pouvait être source de tensions.
Lorsque j’ai été nommé délégué général, j’ai cherché alors à homogénéiser le mouvement en développant une doctrine propre au FN, dans laquelle chacun puisse se retrouver sans pour autant, d’ailleurs, abandonner sa spécificité. Ce processus a été mis en œuvre par l’adoption d’un programme de gouvernement (les « 300 mesures » du FN), mais aussi par la publication mensuelle d’une revue doctrinale, la Revue Identité fondée par Jean-Claude Bardet, laquelle avait vocation à expliciter ce corpus doctrinal commun du FN. On y retrouvait des signatures comme celles de Jean-Yves Le Gallou ou Didier Lefranc, anciens du Club de l’horloge, mais aussi celles de Bernard Antony ou de Georges-Paul Wagner, attachés à la tradition religieuse et politique et bien d’autres encore.
A lire aussi, Lucien Rabouille: Jean-Marie Le Pen et ses anciens lieutenants: scissions en fanfare, réconciliations en sourdine
Je considère que dans ce processus de construction politique, la formation des cadres a joué un rôle majeur. Celle-ci se pratiquait lors de séminaires durant un week-end entier et portait surtout sur l’aspect idéologique, réalisant peu à peu l’unité du parti autour d’un corpus commun. L’idée centrale était que la scène politique n’était plus en réalité marquée par un antagonisme droite / gauche classique mais que le FN représentait à lui seul la défense de l’identité et de la souveraineté de la France face à une classe politico-médiatique qui militait, quant à elle, pour le mondialisme migratoire et libre-échangiste. C’est aussi dans ces séminaires qu’on s’attardait sur la question du vocabulaire. J’y participais souvent car c’était aussi l’occasion de juger de la valeur des personnes et de repérer celles qui pouvaient être promues ou investies.
Quant à la professionnalisation du parti, elle s’est faite progressivement. On a mis en place un Conseil scientifique qui réunissait des personnalités de haut niveau du monde universitaire ou du monde économique, et un centre argumentaire composé d’experts pour rédiger les textes des nombreux documents que nous éditions pour notre communication. Je pense aussi à la cellule qualifiée de propagande qui jouait un rôle important en concevant et fabriquant les affiches et documents que les militants utilisaient sur le terrain. Il y a eu également la professionnalisation des grandes manifestations du mouvement. Nous avions lancé aussi une publication mensuelle pour l’information des adhérents ainsi qu’une maison d’édition pour publier les ouvrages d’auteurs issus de notre famille politique que les maisons d’édition refusaient de prendre comme le rapport Milloz sur le coût de l’immigration.
Quelle a été votre réaction et la réaction des cadres et des membres du Bureau politique aux différents scandales ou « dérapages » verbaux de Jean-Marie Le Pen ?
Ma réaction a été négative, bien sûr. Mais lorsque les premiers dérapages sont intervenus, les cadres comme les militants ont été solidaires non pas des propos tenus mais du président de leur mouvement qu’ils aimaient pour son talent, son courage et ses convictions. On a constaté ainsi que les attaques lancées contre Le Pen, même après une provocation verbale de sa part, avaient eu pour effet de renforcer la cohésion du mouvement.
Au début des années quatre-vingt-dix, lorsqu’il est apparu que ces dérapages se multipliaient et devenaient pour Le Pen un véritable mode de communication, les militants, les cadres et les élus ont éprouvé un agacement croissant, considérant que Le Pen ruinait ainsi le travail qu’ils menaient sur le terrain.
La scission de 1998 était-elle évitable ? A quoi (ou à qui) l’attribuez-vous, avec le recul ?
Il y avait depuis le début entre lui et moi une différence fondamentale d’approche. Lui vivait cette aventure politique comme un parcours personnel, qui lui permettait d’exprimer ses convictions tout en lui apportant la célébrité et une forme de reconnaissance sociale. Le parti n’était à ses yeux qu’un accessoire dont il avait besoin pour les élections mais qui par ailleurs ne l’intéressait pas vraiment. De mon côté, en revanche, je m’étais lancé dans l’édification d’une force politique solide et durable qui devait croître et mûrir jusqu’à être en mesure de conquérir le pouvoir. Une formation structurée par des cadres formés et motivés, enracinés dans les régions et les communes de notre pays et porteuse d’une nouvelle idéologie, en phase avec les Français et décidée à mettre en œuvre son projet pour la France. L’écrasante majorité des cadres et des militants partageaient ce projet. Aussi étaient-ils de plus en plus mécontents d’un président qui, par ses dérapages répétés, donnait des arguments à leurs adversaires pour justifier la diabolisation qu’ils subissaient. Ils s’en plaignaient souvent à moi, menaçant de tout laisser tomber si cette situation perdurait.
La scission n’est donc pas venue, comme beaucoup de mauvaises langues ont tenté de le faire croire, d’une volonté de ma part de prendre la place de Le Pen. Très extraverti, il avait les qualités pour être sur la scène et j’étais très heureux de pouvoir faire pour le parti ce travail de construction politique qui me passionnait. Et, cette complémentarité du numéro un et du numéro deux aurait pu perdurer si Le Pen ne s’était pas engagé dans une logique de provocations régulières qui ruinait mon travail comme celui de tous les cadres du mouvement. En fait, la scission s’est produite pour les mêmes raisons que celles qui ont conduit vingt cinq ans plus tard Marine Le Pen à exclure son père du Front national.
Pourquoi la scission a-t-elle échoué ?
Peu de temps après la scission ont eu lieu les élections européennes de mai 1999. Le Pen présente sa liste et moi la mienne. Il est clair que c’est le résultat de cette élection qui allait décider du sort de cette scission. Celui qui l’emporterait aurait des députés européens, des subsides ainsi que la légitimité offerte par le scrutin. La liste Le Pen fait 5,5% et la mienne 3,5 % ! L’écart est très faible mais c’est Le Pen qui l’emporte et ceci pour une raison simple : le système a choisi Le Pen. Il considère en effet que je suis « plus dangereux » que lui en ce sens que le Pen par ses outrances restera sous contrôle et n’arrivera jamais aux portes du pouvoir. En revanche, les ténors de la classe politico-médiatique savent que je suis partisan à la fois d’une dédiabolisation et d’un enracinement du FN tout en maintenant une ligne politique sans concession. Le Système décide donc qu’il vaut mieux Le Pen que Mégret et, Serge July lance le mot d’ordre dans un éditorial de Libération où il explique clairement pourquoi il vaut mieux la victoire de Le Pen.
Il en résulte aussitôt deux événements majeurs. La procédure intentée par Le Pen pour faire reconnaître que le logo et le nom du Front national lui appartiennent, et qui aurait du donner lieu à un jugement bien après les élections, a été menée au pas de charge juste avant le scrutin. C’est cette décision de justice qui a donné la victoire à Le Pen car beaucoup d’électeurs du FN étaient hésitants et nombre d’entre eux s’en sont remis à la décision de justice : ils ont pris le bulletin de vote qui portait la flamme.
A lire aussi, Paul Rafin: Les médailles de Jean-Marie Le Pen
Ajoutons à cela que, dès la décision de justice rendue, le Premier ministre socialiste de l’époque a aussitôt débloqué en faveur de Le Pen les fonds publics du FN qui étaient jusqu’alors gelés.
On peut aussi rappeler que lors de ces élections européennes, Pasqua et Villiers se sont unis autour d’un Rassemblement pour la France, réalisant un score sans lendemain mais tout à fait spectaculaire de près de 15 %, ne nous laissant aucune marge de manœuvre pour récupérer des voix sur notre gauche.
Ainsi le destin en a-t-il décidé.
La scission fut un évènement assez spectaculaire. Aussi, la (ou les, si l’on songe déjà à celle de 2006) réconciliation (s) pourraient étonner. Qui en fut notamment à l’initiative ? A titre personnel, en avez-vous été heureux ? Cette réconciliation a-t-elle entraîné une réconciliation générale entre Jean-Marie le Pen et les anciens membres du Front National ?
En 2007, le temps a passé depuis la scission et le MNR n’est plus en mesure de collecter les 500 signatures qui auraient été nécessaires pour que je puisse me présenter à l’élection présidentielle. Or, Le Pen propose à cette occasion un rassemblement des Patriotes pour soutenir sa candidature. Je pense qu’il s’agit d’une main tendue dans ma direction et je décide d’y répondre. Nous nous retrouvons dans son bureau à son domicile de Rueil-Malmaison, là où il vit. Le premier contact est un peu froid. Il me demande si j’ai déclenché la scission de peur de ne pas être reconduit sur la liste européenne. Je le regarde, un peu ahuri qu’il ait imaginé une motivation aussi dérisoire, et j’en conclus qu’il avait bien l’intention de m’expulser de toutes mes positions et mandats au FN de l’époque. Mais nous passons vite à autre chose et nous tombons d’accord, comme souvent autrefois, sur l’analyse de la situation politique. Puis, je lui parle de son Union patriotique qui manifestement n’était pas très structurée. Nous en discutons et nous convenons finalement de faire une conférence de presse commune au cours de laquelle j’annonce mon soutien à Le Pen pour l’élection présidentielle qui vient. C’est une réconciliation mais chacun restera sur ses positions concernant la scission dont nous n’avons en réalité jamais reparlé.
A l’époque, beaucoup de militants et de cadres du MNR ont déjà rejoint le FN, parfois même pour y occuper des responsabilités importantes. D’autres, très nombreux, ne l’ont jamais fait. En revanche, beaucoup d’anciens du MNR ont soutenu Éric Zemmour et ont milité pour lui à la dernière présidentielle, pour le quitter ensuite, déçus.
Que retiendrez-vous de Jean Marie Le Pen ? Quelle fut votre réaction à l’annonce de sa mort ?
Jean-Marie Le Pen aura été avant tout un grand lanceur d’alerte qui a dénoncé il y a près de cinquante ans les graves dangers qui accablent actuellement la France et dont chacun semble enfin prendre conscience.
Si nous avions été écoutés à l’époque, aucun de ces fléaux majeurs qu’est le mondialisme migratoire et libre-échangiste ne serait aujourd’hui en mesure de menacer la France dans son existence même. Jean-Marie Le Pen aura joué ce rôle envers et contre tout, malgré les attaques ignobles qu’il subissait, montrant ainsi le courage et les convictions qui l’animaient.