Lire Rodenbach et désespérer doucement avec son auteur…
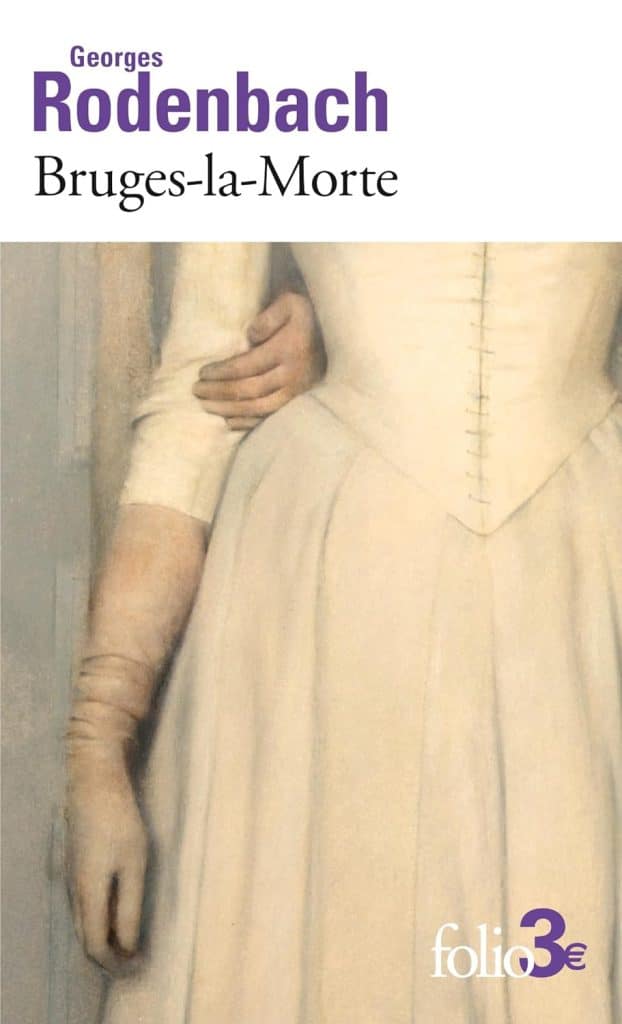
Une théorie (la mienne) veut que les livres rencontrent un destin à l’image de leur contenu. Par exemple, Rostand, avec son Cyrano, dont le héros brille par son courage et son idéalisme, eut l’audace de présenter un drame historique, aussi long que le fameux nez, dans un théâtre alors dominé par le vaudeville et le naturalisme. Malgré sa crainte d’un échec, son audace fut récompensée : succès triomphal et Légion d’honneur décernée seulement quelques jours après la première.
Notre théorie est également corroborée par le Bel-Ami de Maupassant, qui, comme Georges Duroy, sut habilement naviguer les codes de son siècle pour se hisser aux sommets, sociaux pour l’un, littéraires pour l’autre ; ainsi que par les Intranquillités de Pessoa, longtemps confinées au silence d’une malle, et dont les initiés ne parlent qu’en murmures et à demi-mot…
Joyau rare
Et enfin, un livre recouvert d’un épais brouillard, situé loin, bien loin du tumulte parisien et du radar des lettres. Mais en se tournant vers le Nord, quelques-uns percèrent le brouillard, et se surent en possession d’un joyau rare. Oui, ami lecteur, tendez l’oreille, et vous entendrez des clochers en pleurs, des messes votives ; avec un œil alerte, vous verrez se dresser les tours d’une ville blême, des mains se joindre, et une dévotion pleuvoir comme les averses de Bruges-la-Morte.
Pour la plupart, le nom de Georges Rodenbach (1855-1898) n’évoque pas grand-chose, si ce n’est l’odeur des livres anciens. Qui sait, d’ailleurs, si cet homme réputé discret ne préfèrerait pas, aujourd’hui, qu’on se retienne de remuer son duvet d’ombre ? Si tel est le cas, je lui demande pardon d’avance…
Issu de l’aristocratie allemande, Rodenbach évolua dans un environnement peu propice à l’art, dans une ville de Gand en pleine industrialisation, sous le signe d’un père inspecteur des poids et mesures. Le hasard voulut qu’il se liât d’amitié avec le futur poète Émile Verhaeren au collège Sainte-Barbe – où passera aussi, plus tard, Maurice Maeterlinck – mais il se lança dans des études de droit à l’Université de Gand, avant de s’installer à Paris dans l’optique d’y acquérir une expérience de jeune avocat. Or, cette expatriation occasionnera deux développements majeurs.
A lire aussi: Félix Vallotton et l’art du vivre-ensemble
D’abord, la découverte d’une vocation littéraire et journalistique. À l’insu de ses collègues juristes, Rodenbach fréquentera assidûment les cercles littéraires parisiens, côtoyant les génies de ce fécond fin-de siècle, notamment Huysmans, Barrès, Mallarmé, et les frères Goncourt. Bien que discret et travailleur, il rejoignit le club des Hydropathes, où s’unissaient poésie et art oratoire, dans la compagnie d’Alphonse Allais, Sarah Bernhardt, Léon Bloy et autres. Dreyfusard dans les colonnes du Figaro, collaborateur chez La jeune Belgique et La Flandre libérale, il publia également romans et poèmes, bâtissant peu à peu sa renommée, et jouant le rôle de pont culturel entre la France et la Belgique.
Deuxièmement, cette prise de distance avec sa Flandre natale, auparavant si terne à ses yeux, éveilla en lui la nostalgie de ses dimanches de province, sa grisaille, son catholicisme omniprésent. Dans la lignée du courant symboliste de Huysmans et de Baudelaire, cette mélancolie flamande et une spiritualité romantique imprégnèrent la plume de Rodenbach, atteignant leur paroxysme dans son chef-d’œuvre publié en 1892.
Une tristesse devenue religion
Aux premières pages de Bruges-la-Morte, le lecteur s’immisce dans le fervent deuil de Hugues Viane, qui, suivant le décès de sa femme cinq ans plus tôt, avait décidé de fuir sa grande ville et de se réfugier à Bruges, ville à la mesure de son chagrin. Son salon est parsemé d’objets de la morte : photos, vêtements, lettres, ainsi qu’une tresse de ses cheveux précieusement conservée dans une cloche en verre – autant de reliques sur lesquelles Hugues, chaque matin, vient se recueillir et se morfondre. Puis, il erre par les rues, trouvant écho à son état dans le noir des clochers, le silence de la province, le froid de la drache.
Cinq ans d’une routine inébranlable, d’une tristesse devenue religion. Rien, absolument rien, ne pouvait l’ébranler – jusqu’à ce qu’un jour, au cours de sa promenade quotidienne, Hugues tombe sur une femme ressemblant en tout point, de la tête aux pieds, de la couleur des cheveux au timbre de la voix, à sa défunte épouse…
Foudroyé, perdant contact avec la réalité, Hugues se décidera à tricher la mort et à faire comme s’il retrouvait bel et bien son épouse morte et son ancienne vie. Il parviendra à la séduire, à entretenir une liaison ; ressusciter ses vieilles habitudes, habiller son amante des vêtements de la morte, en se gardant bien de ne rien lui faire savoir. Cette lubie fonctionnera un certain temps, jusqu’à ce que les différences de plus en plus prononcées entre les deux femmes, le regard de la société, et l’amour lugubre de Hugues provoquent une revanche impitoyable du destin.
La première habileté de Rodenbach, en plus de l’originalité de l’intrigue, consiste à combiner lourdeur thématique et légèreté poétique, de façon à sublimer ce chagrin par la tendresse, la nostalgie et la spiritualité. Le résultat final n’en est que plus touchant, et il faut lire le roman pour vivre soi-même cette descente dans la folie parsemée d’or et d’encens. Stylistiquement, l’auteur n’a rien à envier aux grands symbolistes de son époque, et l’on regrette que Rodenbach ne figure dans aucune conversation sur Bloy, Barbey et Huysmans. Enfin, la profondeur psychologique, l’omniprésence du divin et les descriptions évocatrices donnent envie de savourer ce livre ne dépassant guère cent pages.
A lire aussi: L’homme qui dort
L’autre singularité de Bruges-la-Morte, comme le suggère le titre, c’est de faire de cette ville un personnage à part entière. Ainsi, Bruges et Hugues (le choix du prénom est-il un hasard ?) s’influencent réciproquement. D’une part, le deuil du narrateur lui fait voir son épouse dans chaque silhouette de femme, et ressentir le poids de la mort dans le surplomb des clochers. De jour en jour, l’esprit torturé de Hugues transforme la ville en cimetière géant, à l’instar de Van Gogh dont l’angoisse transforma les mouvements des blés en flammes de l’Enfer.
D’autre part, Bruges, qui à l’époque n’avait pas encore connu l’industrialisation, repliée dans son catholicisme de province, vient exacerber son désarroi : grise, monotone, muette comme une tombe, vivant dans un passé idéalisé. Le décor oriente les pensées, les actes, jusqu’aux péripéties même du roman. En somme, Bruges est, pour Hugues, ce que fut Paris pour Cioran : « Point le plus éloigné du Paradis, et le seul endroit où il fasse bon désespérer. » Par ailleurs, l’éditeur de Rodenbach avait choisi d’inclure des images de Bruges tout au long du texte, soulignant le rôle de la ville comme personnage central – procédé que reprendra plus tard André Breton dans sa Nadja.
Bien évidemment, le style du roman n’est pas au goût du jour. C’est pourquoi, malgré sa concision, certains lecteurs moins sensibles aux passages descriptifs parcourront certaines pages plus vite que d’autres. Idem pour ceux que la religion refroidit plus qu’elle ne raffermit. Mais son originalité, ses explorations psychologiques et son intrigue sauront convaincre les plus réticents. J’ai dit, plus haut, que les livres rencontrent un destin à l’image de leur contenu. Or, s’il en a été le cas jusqu’ici de Bruges-la-Morte, je ferai tout pour que ma propre théorie soit contredite. Soulever son linceul flamand, et montrer qu’en plongeant dans les abîmes du deuil, le poète peut nous insuffler beauté, lumière et, étonnamment, la vie.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !




