Antonio Muñoz Molina est considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue espagnole. Son œuvre romanesque a reçu de nombreux prix et, chez nous, il a obtenu le prix Médicis étranger en 2020 pour Un promeneur solitaire dans la foule. Cette année, est publié dans une splendide traduction Je ne te verrai pas mourir ; titre emprunté à un vers de Idéa Vilarino : « Plus jamais je ne te toucherai. Je ne te verrai pas mourir. »
Le départ pour le nouveau monde
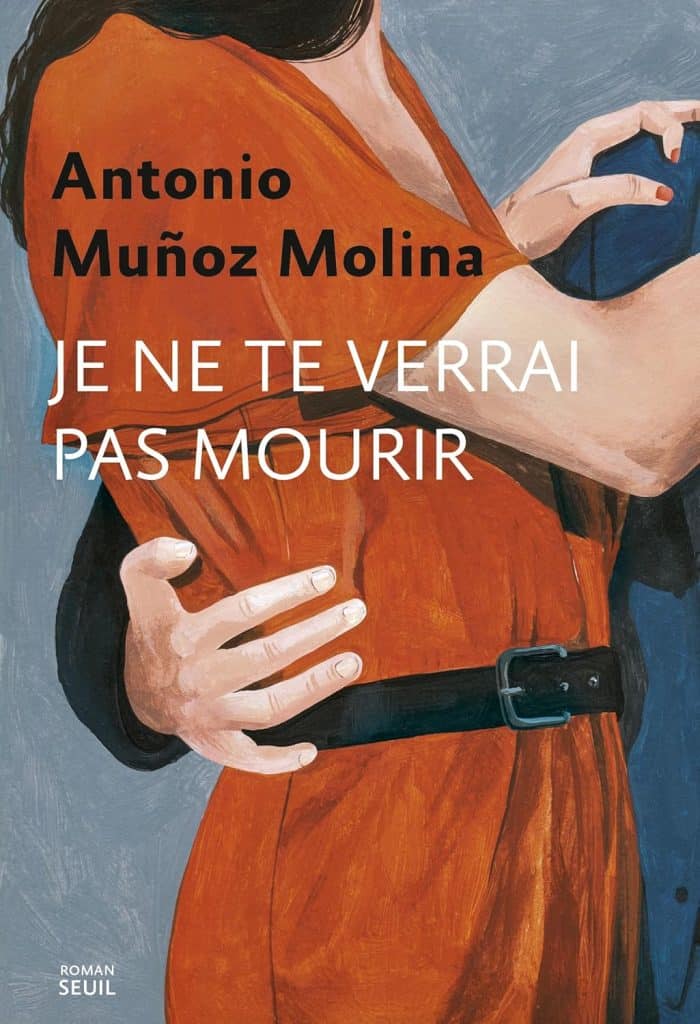
« Je suis une invention docile de mon père » dit Gabriel Aristu, personnage principal du roman. Et c’est donc docilement qu’il obéira à l’injonction de s’exiler aux États-Unis où il gravira les échelons et déambulera dans les étages élevés des banques internationales et des avocats d’affaires. La souffrance d’un père durant la guerre civile et les sacrifices endurés après celle-ci se conjugueront pour faire quitter l’Espagne à un jeune homme qui aurait préféré demeurer auprès d’Adriana Zuber et jouer du violoncelle. On saura très peu de choses de sa vie américaine ; sa femme possède une voix aiguë et enjouée qui semble résumer à elle toute seule la cordialité toujours un peu exagérée des autochtones; sa voix dit l’Amérique et cela suffit. Quant à ses deux enfants, on sait qu’ils sont deux… Le seul moment vraiment décrit sera celui de l’arrivée et du dépaysement pour qui change radicalement de dimension. Ce sera du reste également l’expérience du troisième personnage ; un jeune étudiant, exilé tout comme lui dans le nouveau monde, mais d’au moins une génération plus tard. « Les espaces intérieurs que me fit traverser le professeur Bersett avant d’atteindre le parking me parurent magnifiques. Sa voiture était un 4×4 aux proportions excessives. Je vis pour la première fois, dans un sursaut, une ceinture de sécurité qui s’ajustait automatiquement. Les rétroviseurs extérieurs étaient plus grands qu’en Espagne. L’autoroute sur laquelle nous débouchâmes avait une amplitude amazonienne. Des deux côtés s’élevaient des forêts de hauts arbres hivernaux que le coucher du soleil plongeait dans une ombre grisâtre, plus épaisse sur la ligne d’horizon composée de collines. Quand la nuit tomba, les voies s’éclairèrent et l’obscurité des bois devint impénétrable. Tel était l’impact du changement d’échelle pour un Européen du Sud, le côté démesuré, expansif, exorbitant de l’Amérique. »
J’ai tant rêvé de toi
Et c’est ce troisième personnage qui, en prononçant un nom, fera retraverser l’Atlantique à un monsieur de cinquante ans plus vieux désormais, pour revoir celle qu’il a portée en lui durant tout ce temps ; celle qui fut l’évidence dans sa vie, au point de passer celle-ci à rêver d’elle, au point de faire appel intérieurement à elle pour élucider ses pensées et ses choix. Plus que muse, elle aura été, à distance et sans le savoir, son éclaireuse, car « en s’éloignant d’Adriana Zuber, il s’était éloigné de lui-même et de ce qu’il avait de meilleur en lui. (…) Il avait aboli la vie qu’il aurait dû mener, son identité qui ne se cristallisait qu’à son contact, grâce à son influence passionnée et lucide. » Le roman raconte de manière prodigieuse la vie onirique de Gabriel Aristu ; vie qui devient sa vie véritable et qu’il voudra à toute force lui faire savoir lorsqu’il la retrouvera, et qui lui fera dire d’abord : « Si je suis ici, si je te vois, si je te parle, c’est que je dois rêver. » Effectivement, comment faire la différence quand la substance onirique rencontre soudain le réel ? Mais la femme qui aujourd’hui se trouve face à lui et dont les cheveux ne sont plus roux mais blancs, incarne un principe de réalité qui tombe un peu comme un couperet et qui interroge quant à l’amour qu’on croit éprouver pour autrui :« Tu ne m’aimais pas comme tu le pensais, ou tu n’étais pas amoureux de la femme que j’étais, non. Tu étais amoureux de ton amour pour moi. » Adriana lui rappelle également qu’ils n’ont pas passé une nuit ensemble comme lui ne cesse de le croire, mais tout juste cinq heures entre le début de l’après-midi et le coucher du soleil, car il avait peur de décevoir ses parents en ne rentrant pas dîner avec eux avant son départ…
A lire aussi: Quand le théâtre se fait ballet et le ballet comédie
Mais au-delà de cette différence d’appréciation, il y eut pour elle comme pour lui un miracle madrilène qui fut l’accomplissement de mois et peut-être d’années où leurs personnes auront accordé leurs goûts, leurs émois, leurs pensées au point que leurs corps auront trouvé immédiatement une harmonie et un bonheur tel qu’il s’inscrira pour toujours dans la mémoire d’un jeune homme indécis. Ces quelques heures puissamment érotiques sont décrites dans une prose d’une subtilité bouleversante, et ces quelques heures qu’il appellera pour toujours « la nuit » feront que rien, de son cœur, de sa chair et de sa mémoire ne semblera avoir été affecté par un demi-siècle d’existence hors d’Espagne même s’il ne se sent pas pour autant chez lui à Madrid lorsqu’il y remet les pieds. Il aura tangué quelque part sur l’océan et n’aura amarré qu’à la nuit venue.
Le dernier geste
Si le point de vue de cet homme et son parcours sont ici privilégiés, Adriana, à la fois inexistante dans sa vie réelle et omniprésente dans le roman, n’est pas pour autant invisible. Nous ne cessons de voir avec Gabriel ses yeux perçants, sa chevelure rousse, sa bouche ironique. En revanche, sa « réalité rugueuse à étreindre[1] » ; celle de toute une vie, échappe à celui qui la retrouve au soir de sa vie. Adriana, elle, ne rêve pas, et n’a pas eu le dépaysement de celui qui part pour subvenir à la perte. Et c’est avec un réalisme poignant qu’elle fera une demande très concrète à l’homme autrefois tant aimé. C’est avec détermination qu’elle attendra de lui un geste qui appartient au domaine tangible de la vie. La question, bien sûr, sera de savoir si l’homme qui se sera nourri de rêves pour ne pas seulement errer en s’adaptant au monde ambiant, y consentira…
L’écriture d’Antonio Munos Molina est impressionnante, notamment dans les presque soixante premières pages qui sont une longue, très longue phrase telle une mélopée, que l’écrivain renouvelle à chaque chapitre, le précédent se concluant par une virgule, à l’image des amants qui, pendant cinq heures selon Adriana, une nuit selon Gabriel, n’auront cessé de remonter à la surface pour mieux replonger dans l’unisson de leur corps à corps, et à l’image du retour sporadique et pourtant sans fin de la femme aimée dans la nuit d’un homme.
Je ne te verrai pas mourir d’Antonio Munos Molina, Éditions du seuil, 2025 240 pages
[1] Rimbaud, Une saison en enfer




