Dans son dernier livre, Jakuta Alikavazovic, prix Medicis essai 2021 (Comme un ciel en nous, Stock), nous propose un portrait subjectif et sensible de sa mère, d’origine bosniaque, qui fut poète. Page après page, elle est sur la corde raide. Mais la grande sincérité de sa plume en fait une réussite.
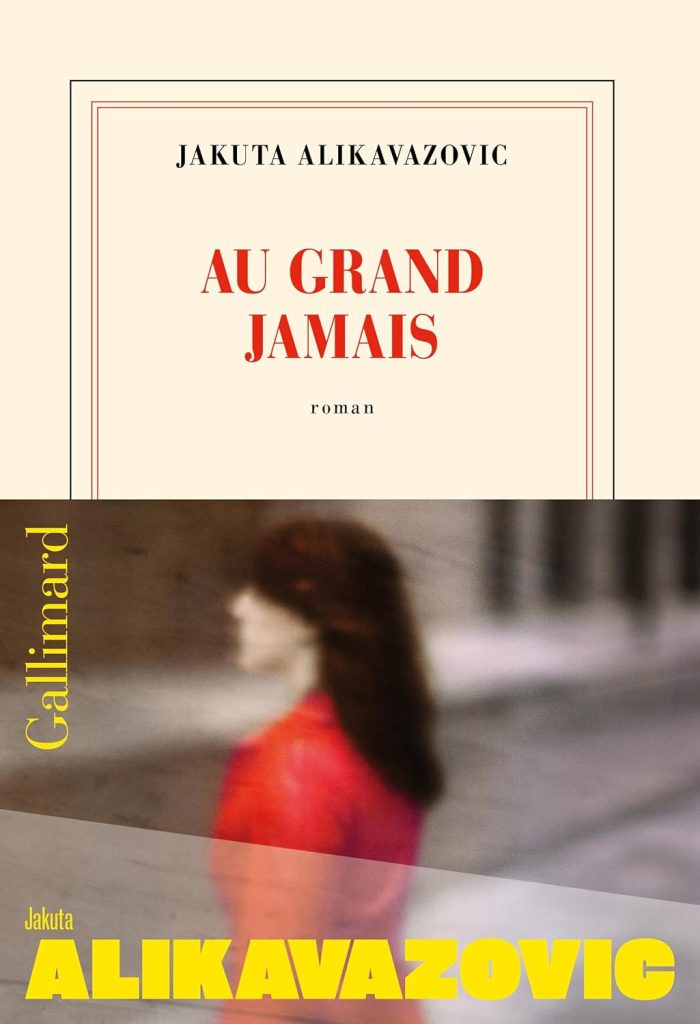
Cette année, à la rentrée littéraire de septembre, il y avait pléthore de romans sur la famille. Quelques sagas, dans le style des Buddenbrook de Thomas Mann, rivalisaient avec des témoignages plus centrés sur l’auteur lui-même à la recherche de ses origines. Car notre littérature est devenue très autoréférentielle, depuis le succès de romans qui prennent pour sujet le moi de celui qui écrit et tout ce qui lui arrive, y compris les choses les plus banales. Ce qu’on appelle autofiction règne désormais dans le roman, pour le meilleur et, souvent, pour le pire. Faut-il s’en plaindre ? Après tout, la signification du mot littérature comporte incontestablement une dimension de subjectivité : on écrit pour rendre témoignage, pour mettre du sien, comme disait Montaigne. Mais cela doit être accompli avec doigté. Et c’est de plus en plus rare, me semble-t-il.
Toucher le lecteur
Le dernier roman de Jakuta Alikavazovic, intitulé Au grand jamais et publié chez Gallimard, est une exception heureuse à cette règle. Ce livre n’a raflé, comme on dit, aucun prix littéraire, cette année, et c’est probablement injuste. Cela aurait mis en lumière une romancière exigeante, qui publie peu, mais toujours à bon escient. J’avais déjà lu, il y a longtemps, un livre d’elle, et j’ai pu constater qu’avec celui-ci elle avait fait beaucoup de progrès. Au grand jamais est une entreprise littéraire au culot, qui raconte quelque chose de très personnel (la mort d’une mère), et qui surtout le fait avec un art consommé. Cependant, ce n’est pas du tout un livre réservé à une petite minorité, car y est décrite, tout du long, et presque à cru, une crise morale que traverse la protagoniste principale, qui parle en son propre nom, qui dit je, mais de manière à toucher tout lecteur de bonne foi.
Une littérature brute
Au départ, il y a donc ce que Jakuta Alikavazovic nous confie d’elle-même : « moi qui ai si souvent eu l’impression de n’appartenir à rien ». Elle trouve les mots justes pour décrire simplement sa détresse, en recourant à une prose à la fois très imagée et très spontanée, bref à la littérature dans ce qu’elle peut avoir de plus brute. On pense parfois à la langue de l’écrivain Pierre Guyotat, dans ses récits autobiographiques comme Coma (en 2006). On sent qu’Alikavazovic a lu les bons auteurs, mais qu’elle ne veut pas écrire de jolies phrases seulement ; elle désire d’abord exprimer le vrai. Et le vrai, c’est qu’elle perd pied gravement, peut-être jusqu’à une sorte de folie : « Il est étrange, écrit-elle, ce territoire voisin de la folie, qu’on ne sait plus comment nommer, car la folie elle-même a disparu : mais qui est un lieu d’écart par rapport à la norme — c’est un monde à part et d’autres lois y ont cours. » C’est ce qu’on pourrait appelerpeut-être une « expérience littéraire », chose si rare de nos jours.
A lire aussi: Sollers, l’hymne à la vie
La mère comme refuge
À partir de là, la narratrice d’Au grand jamais fait retour auprès de sa mère (« je me suis réfugiée chez ma mère », dit-elle). Elle va alors décliner tout ce que sa mère lui aura apporté, car le livre est écrit après la mort de celle-ci, et c’est l’occasion pour Jakuta Alikavazovic d’interroger la vie de sa génitrice. Cette double analyse conduit la romancière à faire l’inventaire de ses propres secrets : « voici que ma mère affichait, incarnait, ce que je ne voulais pas savoir de moi ». Et cela va très loin (c’est ce qui est merveilleux) : « Il est possible que ma vie, ma vie à moi, soit sa dernière œuvre. » J’ai oublié d’indiquer que la mère de Jakuta avait publié deux recueils de poèmes, qui eurent un relatif succès. Héritage lourd à porter pour la romancière, mais qui l’amène à réfléchir sur son propre travail littéraire. Au grand jamais est aussi et surtout un livre sur l’écriture : pourquoi écrit-on ? Comment écrit-on ? Pour qui ? Autant de questions qui hantent la romancière.
La poésie pour s’évader
Il y a nécessairement beaucoup de poésie dans ce livre de Jakuta Alikavazovic, qui marche à tout instant sur la corde raide. Beaucoup de sincérité, également. Si cette sincérité n’était pas en jeu, le livre ne fonctionnerait pas. Il est plus qu’une autofiction, car il est le contraire d’une mise en majesté stérile du moi. Le style suit, clair et précis, sobre jusqu’à l’absence — comme dans l’apologue taoïste de Tchouang-tseu sur le boucher Ding qui, avec l’expérience, ne voyait plus le bœuf qu’il découpait : « Maintenant, dit le boucher Ding au prince Wen-houei, c’est mon esprit qui opère plus que mes yeux. » (Tchouang-tseu, chapitre 17)
Chez Jakuta Alikavazovic, je retrouve cette approche spirituelle qui permet une petite épiphanie morale.
J’en perçois la trace dans ce passage, vers la fin, je crois qu’il est important : « je ne sais pas encore, écrit Alikavazovic, que ce flottement, ce décollement, cette incapacité à devenir un personnage entièrement factice ne sont pas un échec, mais une bénédiction ». Au grand jamais exprime ce cheminement qui n’aboutira jamais à une victoire définitive.
Après le discours du boucher, le prince Wen-houei déclara sobrement : « Je saisis l’art de me conserver. » Je ne sais si cette morale antique s’adapterait mot pour mot à notre sensibilité moderne, à moins peut-être d’entendre, à la place du terme « se conserver », le verbe « survivre »,qui est plus précis; et là, je crois que nous serions pleinement dans le vif du sujet.
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais. Éd. Gallimard. 250 pages.
Tchouang-tseu, L’Œuvre complète, in Philosophes taoïstes. Éd. Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !




