Le philosophe Philippe Nemo et l’enseignant Joachim Le Floch-Imad sont d’accord : l’École française est dans un état catastrophique. Mais leurs remèdes divergent radicalement. L’un plaide pour une potion libérale à la Milton Friedman, l’autre pour un traitement de choc inspiré du docteur Chevènement. Un débat très instructif.
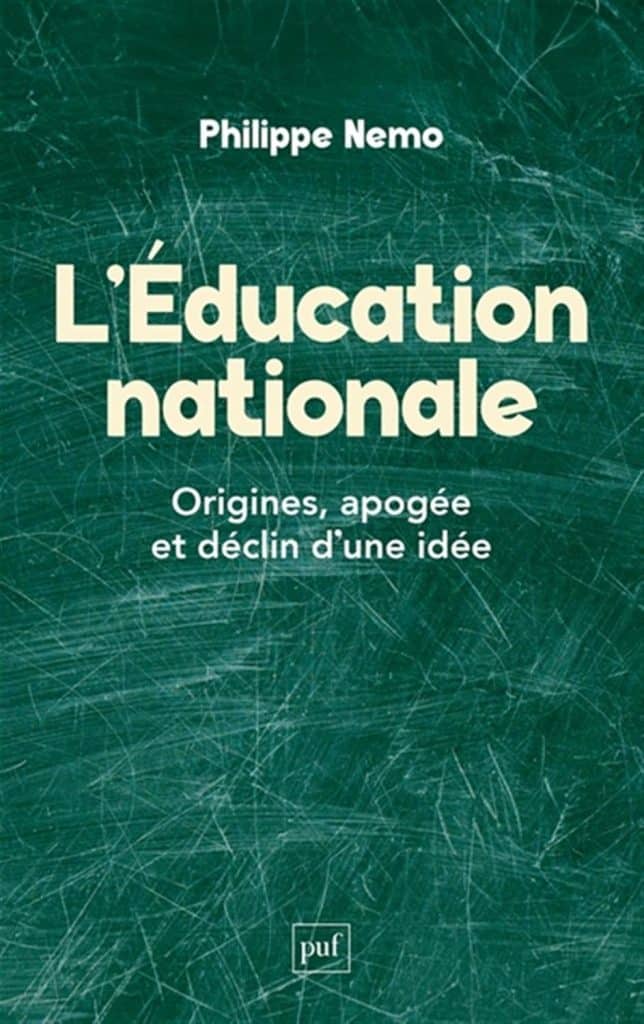

Causeur. D’après une récente enquête internationale, seuls 4 % des enseignants français estiment que leur métier est valorisé au sein de la société, soit la pire statistique de l’OCDE. Que vous inspire ce chiffre ?
Philippe Nemo. Si nos professeurs se sentent méprisés, ce n’est pas tant parce qu’ils sont mal payés que parce que l’Éducation nationale a cessé de les considérer comme des hommes voués au savoir. Enseigner ne serait qu’un « métier », une occupation besogneuse, un travail social comme un autre, alors que c’est en réalité une vocation spirituelle. En 2016, j’ai cofondé l’École professorale de Paris, dans laquelle nous préparons des étudiants aux concours de l’Éducation nationale. Dernièrement, un de nos jeunes diplômés a donné son cours devant un inspecteur en vue de sa titularisation. Une leçon excellente que la classe a écoutée avec passion et en silence. À la fin, l’inspecteur a lancé à l’enseignant sur un ton d’amer reproche : « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ? On aurait entendu voler une mouche. Or on aurait dû entendre un brouhaha, ce qui aurait montré que les élèves étaient actifs. » Et il a ajouté cette phrase typique de l’idéologie qui règne désormais au ministère : « Mettez-vous bien dans la tête que vous n’avez pas à transmettre. »
Joachim Le Floch-Imad. L’Éducation nationale considère en effet, au moins depuis la loi Jospin de 1989, qu’un bon professeur est moins un maître de sa discipline qu’un animateur. Dans les Inspé (ex-IUFM), on apprend ainsi aux enseignants à ne rien apprendre à leurs élèves, avec des formations toujours plus idéologiques comme « Guérir de “l’hégémonie hétérosexuelle” », « La nature a-t-elle un genre ? », « Queeriser le curriculum ». À cette désintellectualisation s’ajoute la désanctuarisation de l’École, devenue caisse de résonance de la violence de la société et la destruction de l’autorité : des relations conflictuelles avec les familles, des professeurs, face à des classes hétérogènes, qui font cours la peur au ventre, voire s’autocensurent pour 56 % d’entre eux. Les 100 000 enseignants menacés ou agressés chaque année ne semblent pas gêner l’administration qui, en pratique, perpétue le « pas de vagues » qu’elle prétend avoir aboli. Il y a aussi le problème de la rémunération, avec une perte de pouvoir d’achat de 25 % en vingt-cinq ans. Il est vrai que les « hussards noirs de la République », sur lesquels Charles Péguy a écrit de si belles pages, servaient l’École bien plus qu’ils n’en vivaient. Seulement leur prestige s’imposait dans une France où les valeurs de la connaissance demeuraient respectées et où l’on savait éduquer au sens étymologique du terme : « educare », c’est-à-dire instruire, et « educere », conduire hors de soi, proposer un détour par les œuvres du passé pour revenir au présent mieux armé.
P. N. Cette élévation passait essentiellement par l’instruction. Mais le ministère « de l’Instruction publique » est devenu en 1932 ministère « de l’Éducation nationale ». Depuis lors, l’école a été dirigée de fait par un personnel de gauche qui a eu pour dessein d’y forger un homme nouveau. Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale sous François Hollande, explique en effet que les enseignants forment un « clergé » dont la mission est de « transsubstantier » (il emploie ce terme) les Français. Cette ambition véritablement néo-religieuse, déjà dénoncée par Condorcet et les autres hommes des Lumières à l’époque révolutionnaire, et encore par Clemenceau au temps du petit père Combes, se traduit aujourd’hui dans de nouvelles matières comme l’Evars (éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle). Quelles compétences l’Éducation nationale peut-elle donc prétendre posséder au sujet de la vie « affective », « relationnelle » et « sexuelle » ? De quoi se mêle-t-elle ? C’est un domaine où seules doivent être impliquées les familles. Que des enseignants proposent ce type de formation à leurs propres enfants, et aux enfants que certains voudront bien leur confier, libre à eux. Mais le scandale est qu’ils soient en position juridique de l’imposer à tous les enfants et à toutes les familles de France dans toutes les écoles publiques et privées. Concernant la sexualité, ces cours vont diffuser le dogme LGBT, qui n’est qu’une idéologie et en aucun sens une science. Mais surtout, quant à la forme, de quel droit une administration d’État peut-elle décider de s’immiscer dans l’intimité des enfants au nez et à la barbe de leurs parents ? Les familles n’auront pas le droit de dispenser leurs enfants de suivre ces cours. Elles ne connaîtront ni le contenu exact de ceux-ci, ni l’identité des « intervenants » (ce seront des « associations », mandatées par qui et selon quels critères ?), ni même la date des séances, tant on craint l’irruption de parents révoltés. La réalité est donc qu’une minorité idéologisée qui tient les bonnes manettes dans l’Éducation nationale est parvenue à utiliser la force coercitive de l’État pour entreprendre de transformer en profondeur les mentalités sociales, pour « créer un nouveau peuple », comme le voulait Robespierre.
J. L. F.-I. Le taux de syndicalisation est en chute libre et les syndicats ont perdu leur influence sur les avancées de carrière. Leur pouvoir ne subsiste, sur le terrain idéologique, que parce que les gouvernants demeurent complaisants à son égard. J’attends toujours des sanctions contre les enseignants qui ont bloqué leur lycée pour s’opposer à l’interdiction de l’abaya ! Mais il y a surtout au sein de l’Éducation nationale de plus en plus de cadres issus du privé, adeptes du « New Public Management », qui considèrent moins l’École comme une institution que comme un prestataire de services. J’en veux pour preuve la novlangue entrepreneuriale au sein du ministère. On ne parle plus de savoirs, mais de « compétences », de programmes mais de « curricula », d’inspections mais de « rendez-vous de carrière ». Le nouveau ministre, Édouard Geffray, décrit les professeurs en termes de « stocks » et de « flux ». On est loin du socialisme… Enfin, permettez-moi de ne pas voir de continuité entre le Front populaire et le Nouveau Front populaire, d’être nostalgique des discours à la jeunesse de Jaurès, du républicanisme intransigeant de Jean Zay ou encore du bel objectif que Paul Langevin assignait à l’école : « La sélection des meilleurs et la promotion de tous. » Le désastre a débuté bien après, dans les années 1970, lorsque l’École a renoncé à l’exigence intellectuelle et que les politiciens ont imposé le collège unique.
Et aujourd’hui, l’École peine à apprendre à lire mais elle prétend apprendre à aimer…
J. L. F.-I. Émiettée dans ses missions, notre École n’instruit plus mais coconstruit. Elle n’éduque plus mais rééduque. On le voit à travers l’Evars, mais aussi les cours d’écocitoyenneté ou la lutte contre les « fake news » au cœur de l’enseignement moral et civique. Depuis des décennies, des ministres sans vision, sans courage et sans expertise se succèdent et, entre des effets d’annonce et des slogans, laissent l’École naviguer à vue, au gré de débats périphériques. Il est temps de lui redonner un cap politique !
P. N. Cette situation est due à l’idéologie mais aussi, et peut-être d’abord, au gigantisme et à la centralisation du système, qui le rendent ingouvernable et l’exposent donc aux pires errements. Il n’est pas possible de gérer centralement une collectivité de 1,2 million de salariés et 15 millions d’élèves et d’étudiants, pour des raisons épistémologiques. Toutes les économies gérées par un Gosplan à la soviétique ont échoué, et, toutes proportions gardées, c’est un problème similaire qui se pose à l’Éducation nationale. Et de même que les Russes ont survécu grâce à l’économie souterraine, de même l’enseignement privé joue un rôle de soupape de survie dans le paysage scolaire français d’aujourd’hui.
En concluez-vous qu’il faudrait privatiser l’Éducation nationale ?
P. N. Non. Car il y a d’excellentes raisons, même pour un libéral, de ne pas souhaiter une complète privatisation de l’école. Ce qu’il faut, c’est un système où le financement soit largement public et l’éducation de base gratuite pour tous, mais où la prestation soit plurielle. Ainsi le « pouvoir spirituel » que se sont arrogés les syndicats de gauche sera-t-il rendu à la société civile. C’est le modèle des écoles à « charte » qui existent dans de nombreux pays (Suède, Portugal, États-Unis, Grande-Bretagne…). Elles respectent un « cahier des charges » national, mais sont autonomes dans leur fonctionnement et le choix de leurs méthodes.

Cela ne risque-t-il pas d’engendrer une école à deux vitesses ?
P. N. Nullement, puisque je répète que dans un tel système, l’école est gratuite. Seulement, la liberté permet une différenciation qui, d’ailleurs, contrairement à ce qu’on croit, joue autant dans le sens de la convergence que de la divergence, comme c’est le cas dans la plupart des activités économiques et sociales où existe une concurrence. Mais l’intérêt essentiel de ce système est de permettre qu’il y ait dans chaque école un « pilote dans l’avion », c’est-à-dire un chef d’établissement qui recrute les professeurs, gère les équipes et résout les problèmes en temps réel parce qu’il a tous les pouvoirs administratifs lui permettant de le faire. Nos chefs d’établissement n’ont pas ces pouvoirs, moyennant quoi tout se dégrade.
J. L. F.-I. Sur le crime que constitue le dévoiement de l’égalité en égalitarisme, nous sommes d’accord. Les classes populaires qui n’ont que l’École pour s’élever en sont les premières victimes. Mais contrairement à vous, je ne crois pas que le libéralisme scolaire constitue le remède miracle à nos maux. Lorsque le Titanic se dirige vers l’iceberg, mieux vaut en changer le cap plutôt que d’inviter chacun à affréter son canot de sauvetage. Il faut rebâtir une École de l’excellence pour tous, y compris dans le public, pas seulement sauver quelques espaces de refuge. Dans mon ouvrage, je propose, dans le cadre d’une alternance politique, un programme de reprise en main de la technostructure de l’Éducation nationale : nominations stratégiques à tous les postes clés ; démantèlement d’une large partie des comités Théodule et de la bureaucratie du ministère (20 % de la dépense totale va à des personnels non enseignants !) ; rappel à l’ordre des fonctionnaires et syndicalistes qui violent leur devoir de neutralité et de loyauté ; et retrait d’agrément aux associations militantes. On ne brisera pas la spirale de l’impuissance tant que le ministre ne sera qu’un contre-pouvoir parmi d’autres.
P. N. Vous ne parviendrez pas à dévier le Titanic. Êtes-vous prêt, oui ou non, à abroger le statut de la fonction publique ? À supprimer la cogestion du ministère par les syndicats ? Ce ministère, tel qu’il est, est décidément irréformable. Il faut rebâtir quelque chose à côté de lui.
J. L. F.-I. Vu l’immigration hors de contrôle que nous connaissons, nombre de vos écoles indépendantes seraient aux mains des Frères musulmans. Le libéralisme scolaire effréné, c’est le dernier clou sur le cercueil de notre nation. Mais aussi de l’enseignement des Humanités. Javier Milei, disciple de Hayek comme vous, n’a-t-il pas nommé un ministre du « Capital humain » en lieu et place de l’Éducation ? Vous idéalisez le modèle suédois, engagé sur la même pente que nous : – 45 points au dernier classement Pisa. On trouve certes en Suède des chefs d’établissement de conviction, porteurs de beaux projets pédagogiques. Mais aussi des écoles appartenant à de grands groupes cotés en Bourse qui n’ont d’autre horizon que le profit.
P. N. Être coté en Bourse est-il un crime ? La vérité est que les écoles ainsi gérées réussissent mieux les tests PISA que les écoles publiques.
J. L. F.-I. Parce qu’elles accueillent des élèves issus de familles plus favorisées. Aux tests PISA, les pays qui rayonnent sont Singapour, la Chine, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, où les systèmes éducatifs sont centralisés. En France, nous avons un État qui se mêle de tout, un « État-Église » comme vous dites, sauf de l’essentiel, à savoir du rétablissement de l’autorité et de l’exigence intellectuelle dans notre École.
P. N. En tout cas, le temps presse. Chaque génération nouvelle est moins instruite que la précédente. C’est, selon moi, la vraie cause des grands problèmes actuels du pays.
J. L. F.-I. Pour vous, le pays est malade à cause de son École. Pour moi, c’est l’inverse. L’École est malade à cause des idéologies qui la défont, mais aussi de la décivilisation du corps social et de la haine de soi qui ronge notre nation à la dérive.
Main basse sur l'Éducation nationale: Enquête sur un suicide assisté
Price: ---
0 used & new available from







