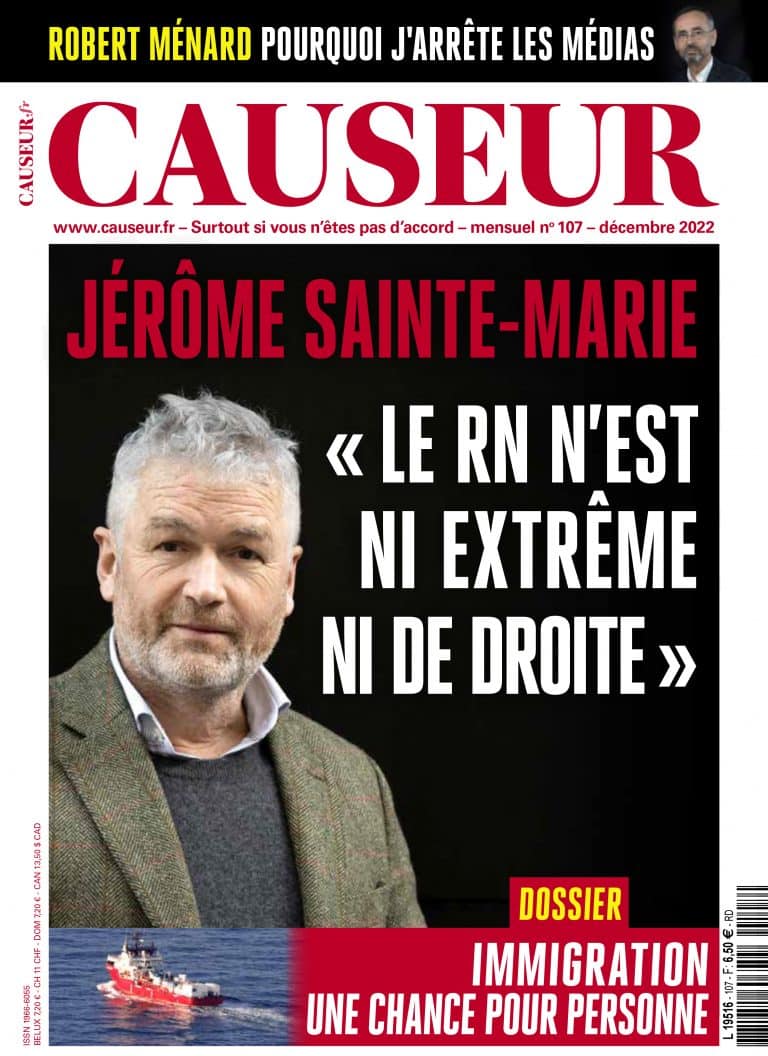En cette fin d’année, les films français affichent le pire comme le meilleur. Dans cette seconde catégorie, Le Parfum vert de Nicolas Pariser fait la course en tête avec grâce et fantaisie.
Ça sent bon !

Le Parfum vert, de Nicolas Pariser.
Sortie le 21 décembre
Nicolas Pariser n’est jamais là où on l’attend. En trois longs métrages seulement, il a su se renouveler et surprendre les spectateurs souvent blasés que nous sommes. Tout a commencé en 2015 avec Le Grand Jeu, un film foncièrement politique à un moment où le cinéma français semble avoir bêtement déserté ce genre pourtant si fécond jadis et même naguère. Pour son premier film, dont il a écrit seul le scénario, il brode avec intelligence sur l’affaire de Tarnac, en confiant à l’excellent Melvil Poupaud le rôle d’un écrivain en panne d’inspiration. Ce dernier est un jour contacté par l’étrange Joseph Paskin à qui André Dussollier prête sa roublardise et ses sourires en forme de coups de poignard. (Joseph, comme le Père ? Paskin comme Pasqua ? Chacun se fera son idée, mais le personnage est assurément une barbouze de haut vol habituée des palais officiels et des coups tordus). En confiant à l’écrivain le soin de rédiger anonymement un brûlot gauchiste appelant à l’insurrection, il allume une mèche qui ne fera pas long feu… Le flamboyant Mocky des années 1970 n’aurait pas renié un tel scénario. Mais Pariser lui confère une élégance hitchcockienne impeccable. On le sent déjà parfaitement à l’aise avec les ressorts et les tiroirs à double et triple fond des ténébreuses affaires. Coup d’essai, coup de maître donc. On loue alors l’exigence, la maîtrise et l’efficacité. Ces qualités, on les retrouve quatre ans plus tard dans Alice et le Maire, dans un tout autre contexte, en apparence plus léger, mais pas moins politique. Pariser a le culot de faire de Fabrice Luchini le maire socialiste de Lyon qui affiche des ambitions nationales à l’intérieur de son parti. Comme l’écrivain du premier film, il doute cependant et s’adjoint les services d’une tête pensante, petite Attali en jupons, qu’Anaïs Demoustier joue à la perfection. Délaissant les souterrains, Pariser s’attaque en plein jour à la politique locale. Et c’est un réjouissant jeu de massacre dans lequel Luchini fait des étincelles.
Avec Le Parfum vert, son cru 2022, le cinéaste surdoué semble avoir trouvé ce que l’on pourrait appeler une troisième voie. Ne renonçant à rien de ses univers précédents (les manigances et complots politiques d’un côté, la comédie de l’autre), il concocte ici une histoire de meurtre parfaitement emberlificotée. De nouveau, les mânes d’Hitchcock ne sont pas loin et c’est Vincent Lacoste (meilleur de film en film) qui campe l’inévitable personnage du faux coupable grâce auquel l’action ne peut que partir sur les chapeaux de roue. L’acteur y incarne Martin, un comédien de la Comédie-Française qui recueille les derniers mots, très mystérieux, d’un de ses confrères, lequel vient d’être assassiné en pleine représentation : « Assassinat… Parfum vert… » Tout spectateur de Lubitsch, Broca et Rappeneau, entre autres, tout lecteur de Tintin vous dira qu’il n’en faut pas plus pour que s’enclenche l’effrayante mécanique de la course-poursuite. Mais pas question que le pauvre Martin soit seul, Pariser, en scénariste avisé, lui adjoint Claire, une créatrice de bandes dessinées, merveilleusement jouée par Sandrine Kiberlain qui, dans le registre de la comédie, est la digne héritière de la Deneuve de La Vie de château et autre Sauvage de la grande époque. Ensemble, ils vont découvrir une redoutable organisation criminelle des pays de l’Est prête à tout pour remporter la partie en cours.
Alors ce pourrait être vieillot, dépassé, essoufflé. Et c’est tout le contraire : vibrant, rythmé, trépidant. De Bruxelles à Budapest, Pariser s’amuse avec des thèmes qu’il traitait sérieusement jusque-là, preuve de son intelligence et de la richesse de son inspiration. Il joue tout autant avec les codes habituels du suspense sans jamais tomber dans le ricanement. Il se fait manifestement plaisir avec cette histoire rocambolesque, en état de grâce. Depuis son entrée dans la carrière, Pariser garde en tête son spectateur : il le cajole, le respecte, le nourrit d’un cinéma plaisant et intelligent. Ce devrait être la norme et pourtant Pariser fait bel et bien figure d’exception. Raison de plus pour ne pas bouder notre plaisir et humer ce parfum-là sans retenue.
A lire aussi: Netflix, l’endoctrinement par le divertissement
Ça sent le sapin !

Maestro(s), de Bruno Chiche
Sortie le 7 décembre
On se disait bien naïvement qu’un film qui a pour héros deux chefs d’orchestre de musique classique ne pouvait pas être foncièrement mauvais. Erreur fatale… Le nouveau film de Bruno Chiche accumule les clichés et les invraisemblances en voulant donner à réfléchir sur les rapports père-fils. C’est ainsi que Pierre Arditi (qui en fait des tonnes) et Yvan Attal (qui ne fait rien) se déchirent sous nos yeux en rivalisant de la baguette et on s’en fiche éperdument. Seule Pascale Arbillot tire son épingle du jeu, mais on savait déjà combien cette actrice, hélas trop souvent cantonnée dans les seconds rôles de femme de… excelle à rendre immédiatement crédible son personnage, fût-il, comme c’est le cas ici, dessiné à la hâte. Restent deux ou trois moments de grâce quand la musique reprend ses droits : c’est beau un orchestre qui joue du Mozart à la perfection. C’est triste un film qui n’est ni correctement dirigé, ni bien écrit et encore moins bien composé…
Ça sent la manip !

Nos frangins, de Rachid Bouchareb
Sortie le 7 décembre
On ne saurait reprocher à Rachid Bouchareb de choisir résolument le camp et le genre du film historique à caractère politique, voire militant. Au moins affiche-t-il la couleur sans complexe. En revenant en parallèle sur la mort de Malik Oussekine et sur une autre bavure policière commise la même nuit sur un Français d’origine algérienne, Bouchareb montre plus de maladresse que d’efficacité. À force d’amalgames, le propos perd de sa force, cédant même à quelques facilités narratives et visuelles qui auraient dû être évitées. Le titre du film est celui d’une chanson de Renaud inspirée de ces deux drames. On l’entend in extenso à la fin, comme un long clip de conclusion. Et le film de se résumer à cette ritournelle « engagée ». C’est dire si le propos manque d’ambition, d’ampleur et plus encore de complexité.