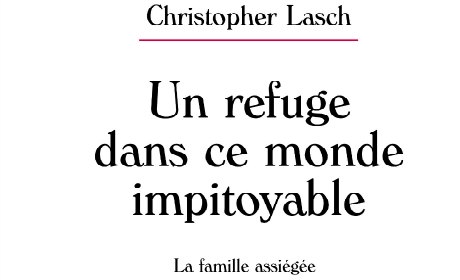
Alors que le monde des affaires, la politique et les relations internationales gagnent toujours plus en sauvagerie et en violence, les hommes cherchent un refuge dans la vie privée, dans les relations personnelles et, par-dessus tout, dans la famille, dernier havre où l’amour et la décence trouvent encore une place. La vie familiale, cependant, semble chaque jour un peu moins capable d’offrir de telles consolations. D’où le sentiment persistant d’angoisse qui, de manière sous-jacente, parcourt le vaste corpus, sans cesse croissant, des commentaires consacrés à la situation de la famille.
Une grande partie de cette littérature tente de montrer que la famille répond à des besoins importants et qu’elle a, par conséquent, une longue vie devant elle, en dépit des changements qui affectent sa forme et sa structure. Pourtant, le taux de divorce continue de grimper, le conflit générationnel s’aggrave, et l’opinion éclairée condamne la famille comme un anachronisme répressif. Ces évolutions traduisent-elles simplement la « tension » née de l’« adaptation » de la famille à des conditions sociales en cours de mutation, ou présagent-elles d’un affaiblissement du tissu social et d’une désorganisation dramatique de l’ensemble de nos institutions ? La famille offre-t-elle encore un refuge dans le monde impitoyable qui est le nôtre ? À moins que les tempêtes dont nous voulons nous protéger menacent d’engloutir dans le même temps le refuge familial ?[access capability= »lire_inedits »]
[…] La première chose à comprendre au sujet de la présente crise de la famille est qu’elle ne s’est pas matérialisée du jour au lendemain. Les néo-féministes, les porte-parole de la contre-culture, les sociologues de la gauche radicale, les adeptes de la « nouvelle histoire sociale » et les journalistes qui popularisent les idées de ces commentateurs appréhendent tous la situation désespérée de la famille comme s’il s’agissait d’une découverte toute récente à leur attribuer en propre. Dans leurs écrits, ils tiennent pour acquis que la « révolution sexuelle », le mouvement féministe et le déclin de l’autorité parentale sont le produit des quinze dernières années. Leurs souvenirs ne remontent même pas aux années 1950, période qui, dans le folklore actuel, représente l’âge d’or de la famille « traditionnelle ».
En réalité, voilà cent ans que la famille se désintègre petit à petit. La crise du divorce, le féminisme et la révolte des jeunes générations trouvent leur origine dans le XIXe siècle, et ont toujours été des sujets de controverse depuis lors. Ces débats au sein de la population ont à leur tour donné naissance à une tradition de recherche sociologique qui détermine, aujourd’hui encore, la grande majorité des questions nourrissant la littérature actuelle sur la famille. Le présent ouvrage expose cette tradition et lui oppose une lecture critique. Il montre comment elle est venue à la fois refléter et influer les politiques sociales, et analyse l’impact accablant de ces politiques sur la famille – sous l’influence, notamment, des professions dites d’assistanat. Mon sujet se situe à l’intersection de la théorie, de l’idéologie et de la pratique sociale. En voulant étudier leurs relations réciproques, souligner l’importance des idées tout en les replaçant dans leur contexte historique, et rejeter l’idée selon laquelle l’Histoire se dévoile ou « évolue » automatiquement, j’espère convaincre le lecteur que la famille contemporaine est le produit de l’action humaine et non pas de « forces » sociales abstraites. L’histoire de la société moderne est, d’un certain point de vue, celle de l’affirmation d’un contrôle social sur des activités jadis dévolues aux individus ou à leurs familles. Dans la phase initiale de la révolution industrielle, les capitalistes arrachèrent la production du foyer pour la collectiviser à l’intérieur de l’usine, sous leur surveillance. Ils se mirent ensuite à s’approprier les savoir-faire et le savoir technique des travailleurs grâce à l’« organisation scientifique du travail », et à les rassembler sous le contrôle d’une direction managériale. Ils étendirent enfin leur contrôle sur la vie privée des travailleurs ; médecins, psychiatres, enseignants, psychopédagogues, agents au service de tribunaux pour mineurs et autres spécialistes commencèrent à surveiller l’éducation des enfants, qui jusqu’alors relevait de la famille. La socialisation de la production, suivie de la socialisation de la reproduction, a généré deux effets contradictoires. D’un côté, ces évolutions ont jeté les bases matérielles d’un nouveau type de société où la forme et le contenu de la production sont déterminés par les besoins collectifs plutôt que par le profit privé. De l’autre, ces mêmes évolutions ont placé les populations dans une dépendance accrue vis-à-vis des managers et des experts – les grands consortiums et l’État –, érodant par-là même la capacité d’autonomie et d’innovation sociale. Au moment où le capitalisme perdait non seulement toute raison d’être mais créait lui-même les conditions de son propre dépassement, toute volonté et toute capacité visant à son remplacement se sont trouvées atrophiées. Cette aporie vient rappeler une nouvelle fois qu’aucune innovation sociale n’intervient de façon automatique, mais exige toujours une intervention active de la part de l’homme. Les hommes sont auteurs de leur propre histoire, bien qu’ils l’écrivent, c’est certain, dans des conditions qu’ils ne choisissent pas et avec des résultats parfois opposés à ceux recherchés.
Quiconque met l’accent sur l’importance historique des actions humaines, et voit l’histoire non comme un « processus » social abstrait mais comme le produit de luttes concrètes pour le pouvoir, se retrouve en contradiction avec la principale tradition des sciences sociales, qui lui oppose un principe contraire : celui d’une société organisée autour de ses propres lois. C’est la prétention même à pouvoir découvrir ces lois qui constitue la mystification principale des sciences sociales, consubstantielles aux dernières phases de la révolution industrielle comme l’économie politique l’était aux premières.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, les économistes classiques déchiffrèrent le fonctionnement du capitalisme industriel. Ils le soutinrent par une apologie raffinée qui camouflait, sous le masque des principes universels de la science économique, les relations sociales propres au capitalisme. Celles-ci représentaient le produit final d’une évolution historique spécifique à l’Europe occidentale, mais l’économie politique les considéra à tort comme des lois naturelles, faisant passer l’exploitation pour l’ordre naturel des choses et offrant par-là même une aura d’inéluctabilité à la domination de classe. Dans la pratique capitaliste, comme dans la théorie qui paraissait être son reflet, les rapports entre les hommes adoptaient désormais « la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles », comme l’affirma Marx.
À la fin du XIXe et au XXe siècle, le développement de la fonction managériale, de même que la prolifération de la bureaucratie, entraînèrent l’apparition d’une nouvelle branche du savoir, les sciences sociales, qui tentaient d’offrir une explication au réseau de plus en plus dense, opaque, des relations interpersonnelles si caractéristiques des sociétés avancées. L’offensive des sciences sociales contre l’illusion commune de l’autonomie individuelle représentait un progrès intellectuel, mais elle était viciée du fait de l’acharnement de ces mêmes sciences sociales à démontrer que l’homme est entièrement le produit de la société. Cette démarche conduisait à de nouvelles formes de confusion. Pour les sciences sociales, le principe d’« interdépendance » régit l’ensemble de la société moderne. Chaque partie de la société est reliée à toutes les autres et doit être comprise en relation avec elles ; les rapports entre les hommes forment un réseau intégré qui défie les explications « monocausales » et parfois même toute forme d’explication. De même que l’économie politique s’est montrée incapable d’envisager les relations de marché modernes comme le résultat d’un processus historique spécifique (au terme duquel les paysans et les artisans perdirent le contrôle des moyens de production pour devenir des salariés), les sciences sociales ne parviennent pas à voir que l’« interdépendance» ne fait que refléter les modes changeants de la domination de classe : l’extension et la consolidation du contrôle capitaliste à travers l’action du management, de la bureaucratie, et l’essor de l’expertise. Elles présentent ainsi à tort la socialisation de la reproduction – l’accaparement de l’éducation de l’enfant par l’État et les professionnels de la santé et de l’assistanat – comme un processus social abstrait, impersonnel, diversement décrit comme « déclin de la famille élargie », « transfert de fonctions », « différenciation» structurelle et fonctionnelle. La tyrannie exercée par ces concepts sur les recherches historiques et sociologiques consacrées à la famille rend toute cette littérature terne et ennuyeuse. La grande majorité des études sur la famille nous disent tout, sauf ce qu’on a le plus envie de savoir. Pourquoi la vie familiale est-elle devenue si pénible, le mariage si fragile, les relations entre parents et enfants si hostiles et acrimonieuses ?[…]
La majeure partie des écrits consacrés à la famille moderne tient pour acquis l’« isolement » de la famille nucléaire, par rapport non seulement au système de parenté [kinship system], mais également au monde du travail. Ils font l’hypothèse que cet isolement rend la famille imperméable aux influences extérieures. En réalité, le monde moderne s’immisce partout et anéantit l’intimité familiale. L’inviolabilité du foyer est une imposture dans un monde dominé par des consortiums géants et par les procédés de la publicité de masse. La société bourgeoise a toujours offert la promesse de satisfactions d’ordre privé censées compenser un travail réduit à une simple routine, mais elle sape dans le même temps ce compromis en faisant du loisir lui-même une industrie. Les mêmes forces qui ont appauvri le travail et la vie civique envahissent de manière grandissante le domaine privé et son dernier bastion, la famille. La tension entre la famille et l’ordre économique et politique, qui, dans la toute première phase de la société bourgeoise, protégeait les enfants et les adolescents de l’ensemble des effets du marché, s’atténue progressivement. La famille, vidée de l’intensité affective qui caractérisait jadis les relations domestiques, socialise les jeunes générations par le biais de relations accommodantes, adoucies, qui prédominent de la même façon dans le monde extérieur.
Auparavant, la famille transmettait les valeurs dominantes, mais offrait inévitablement à l’enfant l’aperçu d’un monde qui transcendait ces mêmes valeurs, cristallisé dans la riche imagerie de l’amour maternel ; or, le capitalisme, dans les dernières phases de son développement, est venu éliminer ou du moins atténuer cette contradiction. Il a minimisé le conflit entre la société et la famille.
Dans le même temps, il a exacerbé presque toutes les autres formes de conflit. Alors que le monde est de plus en plus menaçant et dangereux et que la famille n’est plus en mesure d’assurer une protection contre les dangers extérieurs, toutes les formes de loyauté s’affaiblissent progressivement. L’éthique du travail, transmise par la famille nucléaire, laisse la place à une éthique de la survie et de la satisfaction immédiate. Dans un monde où la compétition est centrée sur la survie plutôt que sur la réussite personnelle, Narcisse vient prendre la place de l’individu en quête de succès et de statut – le type de personnalité en voie de disparition que la grande majorité des chercheurs en sciences sociales considèrent, à tort, comme encore dominant. La satire du retrait dans la sphère privée, qui joue un rôle si important dans la nouvelle critique sociale, ne parvient pas à comprendre cela.
Les mêmes évolutions historiques qui avaient rendu nécessaire de faire de la vie privée – et notamment de la famille – un refuge contre le monde cruel de la politique et du travail, un sanctuaire émotionnel, ont envahi ce sanctuaire et l’ont soumis à un contrôle extérieur. Le retrait dans la sphère privée ne permet plus de préserver des valeurs partout menacées d’extinction. La préservation de ce qui a de la valeur dans notre culture ne pourra passer que par la transformation de notre vie publique elle-même. Reste à savoir si nous disposons encore de l’énergie et de l’imagination nécessaires pour l’entreprendre.[/access]
Un refuge dans ce monde impitoyable. La famille assiégée, C. Lasch (traduction de F. Joly), François Bourin Éditeur, 2012.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !






