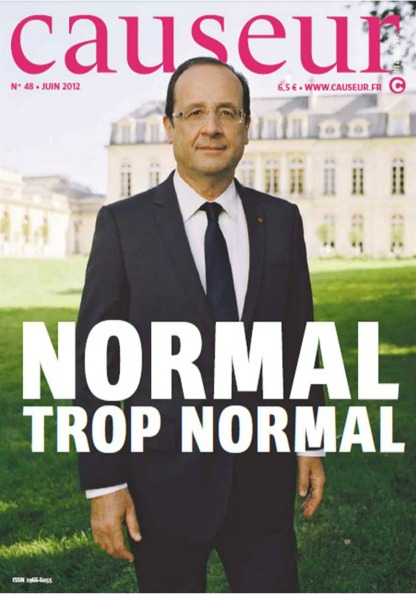Le jury du 65e Festival de Cannes a décerné la Palme d’or à Amour, de Michael Haneke, qui réussit la gageure d’allier l’absence de style au conformisme moral le plus affligeant. Ce cinéaste nous donne, année après année, des films de facture lisse et morne, dépourvus de tout enjeu esthétique, au service de récits aigres qui tentent de manipuler le spectateur afin de lui donner une bonne leçon. Rien de très nouveau sous le soleil cannois : si l’on excepte la parenthèse enchantée 1976-1980, au cours de laquelle furent récompensées des œuvres majeure (Taxi Driver, Padre padrone, L’Arbre aux sabots, Apocalypse Now, Kagemusha), Cannes s’est pratiquement toujours trompé, honorant avec constance des œuvrettes à la mode qui furent promptement oubliées, et passant à côté des plus grands films.[access capability= »lire_inedits »]
En 1946, le premier Festival accorda la plus haute distinction, qu’on n’appelait pas encore « Palme d’or », à la besogneuse Bataille du rail de René Clément, et snoba trois films qui figurent parmi les plus beaux de l’immédiat après-guerre : le mythique Gilda, de Charles Vidor, l’enchanteur La Belle et la bête, de Jean Cocteau, ainsi que le plus troublant film d’amour d’Alfred Hitchcock, Les Enchaînés ! Le ton était donné. Le Festival devait, à quelques exceptions près, privilégier l’académique professoral ou le clinquant sans profondeur, se méfiant comme de la peste des insurrections poétiques.
En 1955, la Palme d’or (première du nom) est attribuée à Marty, de Delbert Mann, banale comédie romantique qui éclipse le romantisme noir du chef-d’œuvre de Mizoguchi, Les Amants crucifiés. En 1959, l’opérette filmée Orpheu Negro occulte l’un des premiers films emblématiques de la Nouvelle Vague, Les 400 coups de Truffaut.
En 1962, les poncifs de La Parole donnée, d’Anselmon Duarte, éclipsent le mystère de L’Éclipse d’Antonioni et la grâce du Procès de Jeanne d’Arc, de Bresson, tandis qu’en 1966, l’égrillard Ces Messieurs dames, de Pietro Germi, l’emporte sur le lyrisme du Docteur Jivago, de Lean, et sur l’épique Falstaff de Welles.
En 1973, La Méprise, d’Allan Bridges, pourtant très conventionnel, est préféré à l’iconoclaste Grande Bouffe, de Marco Ferreri, ce qui laisse penser qu’en ces années si fières de leur subversion, il valait mieux traiter de la lutte des classes à fleurets mouchetés qu’à coups de hachoir. Et durant les années 1980, qui voient l’exotisme érigé en valeur et l’histrionisme en mode d’expression, la précision et l’intensité de Nostalghia, de Tarkovski, et de Thérèse, d’Alain Cavalier, sont négligés au profit des mélodrames boursouflés de Shohei Imamura, La Ballade de Nayarama (1983), et de Roland Joffé, Mission (1986).
Le reste est à l’avenant : en 2004, Michael Moore, qui signe Fahrenheit 9/11, film de propagande relooké en documentaire citoyen, est préféré à des cinéastes de la trempe des frères Coen, de Wong Kar-wai, de Kusturica ; en 2008, le naturalisme médiocre d’Entre les murs, de Laurent Cantet, adapté de Bégaudeau, gagne contre Two Lovers, le chef-d’œuvre de James Gray, adapté de Dostoïevski ; en 2009, l’exécrable Ruban blanc, pensum sans risque d’Haneke, est préféré à des films aussi jouissifs et audacieux que Les Herbes folles, de Resnais, Inglourious Basterds, de Tarantino, ou Enter the Void, de Gaspar Noé…
Emmanuel Mounier disait que « le bourgeois est l’homme qui a perdu le sens de l’Être, qui ne se meut que parmi des choses, et des choses utilisables, destituées de leur mystère ». Cannes est un festival bourgeois qui commence par apprivoiser un Guépard (1963) pour finir par n’attraper qu’une Anguille (1997), un festival qui nous a, des décennies durant, prouvé qu’il se méprenait avec constance, ou plutôt qu’il restait fidèle à sa nature bourgeoise, c’est-à-dire craignant ce qui n’est pas confortable, homologué et prévisible. La cuvée 2012 ne fait que confirmer ce diagnostic, avec Carax et Cronenberg, grands créateurs de formes, oubliés par ce palmarès de l’entre-soi (la plupart des lauréats avaient déjà été fêtés les années précédentes), comme ils l’avaient d’ailleurs déjà été pour Pola X (1998) et History of Violence (2005).
Une telle constance dans l’erreur, la facilité, le mépris de l’art ne laisse pas d’inquiéter. Mais à ce stade d’incompétence, être oublié par le jury cannois est la plus belle consécration qui soit ![/access]
*Photo : buzzbuzz
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !