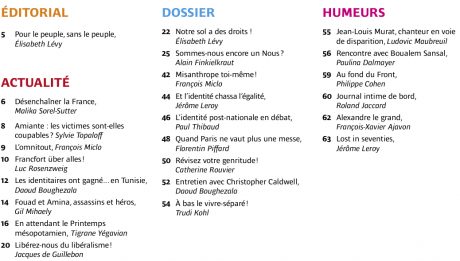Que signifie l’interdiction du voile dans un monde qui prétend se délivrer des interdits ? Voici la réponse que donne Claude Habib dans Galanterie française (Gallimard) :
« Cette interdiction ne s’explique certainement pas par l’égalité des hommes et des femmes qui fut le critère constamment invoqué dans le débat public. Si l’égalité était en cause, les autres sociétés démocratiques, qui ne sont pas moins égalitaires que la nôtre, n’auraient pas manqué de prendre une mesure analogue. L’égalité des sexes ne préoccupe pas moins la classe politique au Canada, en Hollande ou en Suède. Les islamistes ont eu beau jeu de multiplier les images de femmes voilées insérées dans la vie active, attentives devant des écrans, penchées sur des livres ou l’œil rivé sur un microscope. Ils n’ont pas manqué de seriner que le voile n’empêche pas la participation au monde du travail et que ce qui l’empêche à coup sûr, c’est l’exclusion des jeunes filles voilées hors du système scolaire. »
Mais pour Claude Habib, ce n’est pas non plus comme symbole religieux, et donc pas au nom de la laïcité, que le voile est visé. « L’interdiction devient compréhensible si on la rapporte à cet arrière-plan de la tradition galante qui présuppose une visibilité du féminin, et plus précisément une visibilité heureuse, une joie d’être visible, celle-là même que certaines jeunes filles musulmanes ne veulent plus arborer. Le port du voile est un affichage de chasteté qui signifie l’interruption du jeu galant et même son impossibilité définitive. Une femme voilée affirme tacitement que tout homme est un danger dont il faut se garder. Le voile interrompt la circulation de la coquetterie et de l’hommage, en rappelant qu’il existe un autre règlement possible à la coexistence des sexes : la stricte séparation. »
La laïcité libérale peut bien, ici comme ailleurs, prendre le pas sur la laïcité républicaine, ce qui résiste au voile islamique, c’est la mise en forme galante de la coexistence des sexes. Qu’est-ce que la galanterie ? Dans la langue classique, galanterie signifie distinction, élégance dans les manières. Balthazar Gracian explique, dans L’Homme de cour qu’« un brave homme doit se piquer d’être tel que si la galanterie, la générosité et la fidélité se perdaient dans le monde, elles se retrouveraient dans son cœur. » On aura compris qu’un brave homme n’est pas un brave type, mais un homme valeureux.[access capability= »lire_inedits »]
Dès la fin du XVIIe siècle, le mot commence à désigner précisément la courtoisie témoignée aux femmes, courtoisie dont le fondement est l’inégalité entre les êtres. Et l’inégalité oblige : tel est le paradoxe fondateur de notre civilisation que David Hume, le grand philosophe écossais des Lumières, a mieux que quiconque saisi et formulé.
« Les vieilles gens ayant conscience de leurs infirmités redoutent naturellement le mépris des jeunes. C’est pourquoi une jeunesse bien éduquée multiplie les marques de respect et de déférence envers ses aînés. Les étrangers et les inconnus sont sans protection, c’est pourquoi dans toutes les nations polies, ils reçoivent les marques de la plus grande civilité et se voient offrir la place d’honneur dans chaque compagnie. […] La galanterie n’est qu’un autre exemple de la même intention généreuse. Comme la nature a donné à l’homme la supériorité sur la femme en lui confiant une plus grande force de corps et d’esprit, il lui revient de compenser autant que possible cet avantage par la générosité de son comportement et par une complaisance et une déférence marquées envers toutes les inclinations et toutes les opinions du beau sexe. Les nations barbares affichent cette supériorité en réduisant les femmes à l’esclavage le plus abject. Elles sont enfermées, battues, vendues ou tuées. Tandis que dans une nation polie, le sexe masculin manifeste son autorité de manière plus généreuse mais non moins marquée par la civilité, le respect et la complaisance, en un mot par la galanterie. » Ce texte nous fait sursauter parce qu’il heurte notre sensibilité démocratique. La croyance dans une supériorité d’esprit des hommes sur les femmes s’est effondrée et l’égalité ou, comme le dit Tocqueville, « l’idée du semblable », a triomphé. Ce n’est plus la hiérarchie du masculin et du féminin qui va de soi, mais bien la similitude, la communauté d’appartenance des hommes et des femmes au genre humain. Le naturel d’hier est l’arbitraire d’aujourd’hui.
Mais Hume ne se contente pas d’aménager la domination masculine. Constatant que l’humanité pensante est divisée en deux mondes, le monde de l’érudition et le monde de la conversation, il se conçoit comme une sorte d’ambassadeur entre les deux. Il ajoute : « De même que ce serait une négligence impardonnable pour un ambassadeur que d’omettre de présenter ses hommages au souverain de l’État où il est chargé de résider, de même serait-il absolument inexcusable que je ne m’adresse point avec un respect particulier au beau sexe qui règle en souverain sur l’empire de la conversation. » Où Hume a-t-il trouvé l’inspiration ou la confirmation de sa pensée ? « Dans une nation voisine, également réputée pour le bon goût et la galanterie qui y règnent, les dames sont, d’une certaine manière, les souveraines du monde de l’érudition comme de celui de la conversation. Et aucun écrivain poli n’a l’outrecuidance d’affronter le public sans l’approbation de certains juges réputés qui appartiennent au beau sexe. » Cette nation voisine, c’est la France, la France des salons, la France de Julie de Lespinasse et de Madame du Deffand.
Ne caricaturons pas Hume, donc. Et n’oublions pas non plus ce que les rituels, les procédés ou les automatismes, comme tenir la porte, régler les consommations, céder le pas, doivent au besoin de compenser l’avantage de la force par la délicatesse du comportement.
Mais la galanterie n’est pas seulement égard pour la fragilité. Elle est aussi et surtout tribut à la féminité. Elle est issue d’une connivence sur le fait que les femmes plaisent et qu’il est licite et même recommandé de leur rendre hommage et de leur faire la cour. Le galant homme ne se jette pas sur les femmes, il s’oblige à les séduire à leur mode. Ce sont elles qui fixent les règles. D’ailleurs, il ne s’agit pas toujours de séduire. La galanterie ne se réduit pas à ce qu’on appelle aujourd’hui la « drague ». Elle est une atmosphère avant d’être une entreprise, une convention avant d’être une conquête, un protocole avant d’être une stratégie, un jeu gratuit avant d’être un comportement intéressé. Elle est un rôle que l’on tient, une représentation que l’on donne, un badinage sans conséquence, un petit cérémonial auquel on se plie sans projet défini, pour le plaisir et pour la forme.
Cette connivence sur le fait que les femmes plaisent peut aussi conduire à leur enfermement. C’est la solution choisie par la plupart des sociétés patriarcales. Comme les femmes sont désirables et désirantes, il faut les cacher, les surveiller, les séquestrer, les séparer, les soustraire par tous les moyens à la tentation sous peine d’être déshonoré et de finir cocu. Le mot est d’ailleurs terrible. Aussi évolués que nous soyons, ces deux syllabes continuent à susciter l’hilarité. Le cocu demeure le personnage comique par excellence.
Mais un autre rire résonne en nous : celui de Molière. L’immense mérite de Molière a été de s’attaquer au rire majoritaire, au rire de la tradition. Il ne s’est pas interdit de solliciter ce rire farcesque, notamment dans George Dandin. Mais dans L’École des femmes se produit une véritable transmutation des valeurs : le comique change de camp. Par l’entremise du raisonnable Chrysalde, Molière tourne en dérision non le cocuage mais la hantise du cocuage. Chrysalde rive son clou à Arnolphe en ces termes :
« Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche,
N’est rien, à votre avis, auprès de cette tache,
Et que de quelque façon qu’on puisse avoir vécu,
On est homme d’honneur quand on n’est point cocu. »
L’École des femmes révolutionne le concept d’honneur. Ce n’est plus le cocu qui est ridicule et déshonoré aux yeux du public, c’est Arnolphe, l’homme qui a une peur panique de l’être.
Et c’est au pays de Molière qu’à partir de l’âge classique qui s’est défini lui-même comme l’âge galant, on a exalté (sinon toujours pratiqué) un art de vivre ensemble et de mêler les hommes et les femmes sans que le déshonneur en résulte. Dans les pays du Sud de l’Europe, au même moment, les hommes gardent les femmes derrière les grilles et les verrous ; au Nord, dans la froide Angleterre, les sexes vivent séparés non par opposition mais par indifférence. « En Angleterre, dit le proverbe, rien n’est fait pour les femmes, pas même les hommes. » Voilà pourquoi Hume proclame la France pays des femmes.
Égalité des conditions oblige, nous sommes sortis de l’âge galant. Aucune revue n’aurait l’idée de s’appeler Commentaire galant, ou Le débat galant, alors que le Mercure galant faisait le délice des lecteurs du Grand Siècle.
Mais ce que révèle l’affaire du voile, c’est que la galanterie respire encore en France. Et à l’occasion de l’affaire Strauss-Kahn, cette singularité obstinée a été mise sur la sellette aux États-Unis, l’un des pays qui s’était le plus bruyamment élevé contre l’interdiction des signes religieux à l’école. Quelques jours après l’inculpation du directeur du FMI pour agression sexuelle, tentative de viol et séquestration, le site du New York Times lançait un forum de discussion avec l’accroche suivante : « Are french women more tolerant ? Room for debate. The Dominique Strauss-Kahn scandal stirs a larger debate on French society’s attitudes toward social misconduct by powerful men. »
Le 20 mai 2011, Joan Scott, auteur de La Politique du voile et professeur à l’Institute for Advanced Studies de Princeton, est la première personne à intervenir : « La culture politique française a longtemps toléré des conduites comme celle de Dominique Strauss-Kahn, en les expliquant comme un trait de caractère national, une part de ce que l’historienne Mona Ozouf appelle » l’art de la séduction » ». Autrement dit, alors que d’autres cultures démocratiques rejettent et sanctionnent les frasques des hommes de pouvoir, cette culture les accepte et même s’y reconnaît. Elle ne les tolère pas seulement, elle s’en fait gloire. « Depuis le bicentenaire de la Révolution française, ajoute Joan Scott, nombre de livres ont paru qui ont présenté l’érotisation galante de la différence comme une alternative à l’égalité entre les sexes. » À sa façon, Joan Scott établit elle aussi un lien entre cette bizarrerie française et la crise du vivre-ensemble : « Les tenants de cette idéologie ont justifié leurs arguments sur l’incapacité des musulmans à assimiler la culture en affirmant qu’un jeu érotique ouvert est une composante de la frenchness (de la francité, de l’identité nationale). Quelle ironie, conclut-elle, que la victime de l’agression sexuelle présumée de DSK soit une musulmane ! »
Elle reconnaît, pour en dénoncer le caractère pernicieux, l’existence de cette singularité française héritée de l’Ancien Régime. On commence par complimenter la femme sur son charme, sa ligne, sa beauté, son parfum et, comme on est bien accueilli, on finit par se croire tout permis. Ainsi prospèrent les prédateurs sexuels. En jouant le jeu de la galanterie, en se laissant assigner à résidence dans la féminité, les femmes françaises encouragent l’inconduite de certains hommes au lieu de la combattre. Les plus coupables sont les intellectuelles qui choisissent d’exalter ce comportement quand elles devraient, si elles étaient fidèles à leur mandat, le déconstruire. La soumission le dispute en elles au chauvinisme. Elles présentent le galant homme comme celui qui exclut d’utiliser la force ou l’intimidation dans le commerce avec l’autre sexe alors que, sous ses dehors affables, la galanterie fait des femmes un gibier.
Après quelques jours de sidération et d’incrédulité, les grands journaux français reprennent à leur compte cet acte d’accusation pour nous exhorter au repentir et à la réforme morale. Assez de complaisance ! L’affaire DSK jette sur nos gauloiseries un éclairage lugubre et révèle la séduction française pour ce qu’elle est. Le temps est venu d’en finir avec l’Ancien Régime du vivre-ensemble et d’instaurer une égalité effective. Depuis, les poursuites contre Dominique Strauss-Kahn ont été abandonnées à cause des divers mensonges de la plaignante et de ses versions contradictoires sur ce qui s’est passé dans la désormais célèbre suite 2806 de l’hôtel Sofitel de Manhattan. Mais ce qu’on croit savoir du comportement sexuel compulsif de l’ex-futur candidat à l’élection présidentielle continue de susciter le malaise.
Faut-il incriminer pour autant l’assignation galante des femmes à la féminité ? Est-ce la civilisation française qui est en cause dans un tel comportement et qui devrait être impérativement corrigée, démocratisée, modernisée ?
Je ne le crois pas. Je crois au contraire que la crise du vivre-ensemble remet en question cette vision naïvement progressiste de l’Histoire. Je pense au film de Jean-Paul Lilienfeld, La Journée de la jupe, diffusé sur Arte le 20 mars 2009. Sonia Bergerac est professeur de français dans un collège de banlieue. Poussée à bout par la violence et par le sexisme de certains de ses élèves, elle prend sa classe en otage. Interrogée sur ses revendications, elle exige entres autres l’instauration au collège d’une « journée de la jupe » par laquelle l’État affirmerait qu’on peut porter une jupe sans être une pute. Vêtue d’un tailleur-pantalon − qui évoque les tenues de Michèle Alliot-Marie −, la ministre de l’Intérieur se récrie : « Et pourquoi pas une nuit du string ! On a mis des siècles pour avoir le droit au pantalon ! »
L’histoire vestimentaire n’étant pas vraiment mon domaine de compétence, je m’appuierai sur l’ouvrage de l’historienne Christine Bard, Une Histoire politique du pantalon (Seuil).
Le pantalon est fils de la Révolution et, plus précisément, des sans-culottes. Pour la première fois dans l’histoire de la mode, ce ne sont plus les classes inférieures qui imitent les classes supérieures, c’est le vêtement du vaincu, du paysan, du marin, de l’artisan qui se diffuse vers le haut de l’échelle sociale. En même temps, les hommes renoncent à utiliser des parures brillantes et raffinées au profit des femmes. Comme le remarque John Carl Flügel, un psychanalyste anglais cité par Christine Bard, « l’homme cède ses prétentions à la beauté et prend l’utilitaire comme seule et unique fin ».
Cette renonciation est aussi une libération. Le pantalon est un vêtement commode alors que toute la mode féminine conspire contre la liberté. Seul l’homme peut être un flâneur quand robes, chapeaux, chaussures vouent les femmes à la sédentarité. Au XIXe siècle, des femmes se révoltent contre cette immobilisation. George Sand choisit de transgresser une ordonnance de 1800 interdisant aux femmes le port des habits de l’autre sexe. « N’entreprenez pas de vous faire homme vous-même car, en perdant le caractère de votre sexe sans pouvoir revêtir celui de l’autre, vous périrez entre les deux », lui dit un journaliste. « Soyez rassuré, lui répond-elle, je n’ambitionne pas la dignité de l’homme. Elle me paraît trop risible pour être préférée à la stabilité de la femme, mais je prétends posséder aujourd’hui et à jamais la superbe et entière indépendance dont vous seul croyez avoir le droit de jouir. »
À son époque, George Sand est une solitaire et une intrépide. Mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, toutes les femmes suivent sa voie et déclarent leur indépendance. Et cette indépendance va tellement de soi qu’on imagine difficilement qu’en 1976, le Premier ministre, Jacques Chirac, ait pu être scandalisé de voir Alice Saunier-Seité, ministre de l’Éducation, arriver en pantalon au Conseil des ministres. D’où la stupeur, dans le film de Lilienfeld, de la ministre de l’Intérieur devant la revendication de Sonia Bergerac, d’ailleurs contraire aux propres convictions de l’enseignante. C’est qu’un changement imprévu s’est produit : il existe des quartiers où la jupe, signe d’une féminité à l’ancienne, jette l’opprobre sur celles qui la portent. Autrement dit, des jeunes filles portent le pantalon pour ne pas subir la violence des garçons.
À la différence de Sonia Bergerac, Yannis Robert, professeur d’histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, est bien réel. Dans son livre, Tableau noir, on apprend que « celle qui a le tort de vouloir être une jeune fille de son temps est une » tepu « , une » taspé » qui mérite de se » faire tourner « »[1. Iannis Roder, Tableau noir, la défaite de l’école, Denoël] . Ce jugement est intériorisé par les jeunes filles. C’est précisément pour dénoncer cette situation que l’association « Ni putes ni soumises » a été créée. Loubna Meliane, l’une des fondatrices de cette association, écrit dans son autobiographie : « Les filles, dans les quartiers, se résignent au lieu de se révolter. Elles acceptent de vivre en silence, de porter un survêtement et des baskets, de se camoufler sous un déguisement de plus en plus masculin sous peine de subir des insultes de petits caïds, de se faire traiter de putes et, au final, de se retrouver bannies. »
Ainsi se rapprochent deux vêtements que tout sépare à première vue, le pantalon, d’origine masculine, symbole de la modernité, et le voile, réservé aux femmes, symbole de la tradition. Dans certaines cités, les jeunes filles qui ne portent pas le voile doivent compenser cette insolence en portant le pantalon pour dissimuler leur féminité. Mais pas n’importe quel pantalon. Comme le dit une jeune femme interrogée par Christine Bard, « même mon jean-baskets, c’est pareil pour eux, c’est féminin ; mais en jogging et casquette, tu n’as aucun problème. »
La violence dans les quartiers dits sensibles est souvent imputée à l’exclusion sociale. Ce phénomène ne doit surtout pas être négligé, mais la violence ne serait-elle pas aussi liée à l’exclusion de la féminité et au désert affectif qui en résulte ? N’est-elle pas une conséquence du déni de sensibilité et de l’interdiction d’être galant qui sévissent dans ces quartiers ? Ce qui rend dur et brutal, c’est la mauvaise réputation de la douceur. Dans La Cité du mâle, film tourné à Vitry, sur les lieux où une adolescente, Sohane, a été brûlée vive par son petit ami, un jeune homme se moque des « bouffons qui tiennent la main de leur meuf ». Là où ce rire dicte sa loi, là où les filles qui, d’une manière ou d’une autre, ne voilent pas leur féminité sont considérées comme des « putes » ou des « chiennes », la violence règne.
L’idée de La Journée de la jupe est venue à Lilienfeld alors qu’il regardait les images des émeutes urbaines de novembre 2005 et s’étonnait de ne voir que des garçons dans cette révolte considérée comme le Mai 68 des banlieues françaises. Certes, son film est terrible, mais il ne ferme pas toutes les issues. On y voit s’esquisser une solidarité féminine, confortée par des ralliements masculins, autour du refus de la violence et du sexisme. Si la mort de l’enseignante donne à cette histoire une fin tragique, dans les dernières images, celles de son enterrement, la jupe revient comme une lueur d’espoir. La présence d’un garçon, à côté de trois jeunes femmes qui ont, pour la première fois, troqué le jogging contre la jupe, est un signe de mixité fragile mais possible.
Considérée comme une aliénation des femmes, la féminité a été combattue au nom de l’égalité et de la similitude. Et voilà qu’ironiquement, cette féminité fait retour à cause de la crise du vivre-ensemble.
Le problème, en effet, n’est pas l’assignation des femmes à la féminité mais le déni de la féminité et ses conséquences dans certaines banlieues. Aussi l’interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques a-t-elle été prolongée par une loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public − qui visait la burqa − et du voile intégral, dont le nombre ne cessait d’augmenter. Écoutons le témoignage d’Élisabeth Badinter devant une mission d’information parlementaire : « Le port du voile intégral est contraire au principe de fraternité et, au-delà, au principe de civilité de rapport à l’autre. Porter le voile intégral, c’est refuser de rentrer au contact avec autrui ou, plus exactement, refuser la réciprocité. La femme ainsi vêtue s’arroge le droit de me voir et me refuse le droit de la voir. »
Si fraternité et civilité sont des valeurs universelles, certains pays, non moins démocratiques et tout aussi civilisés que la France, en jugent autrement. Une fois encore, la loi a été très vivement critiquée aux États-Unis, au nom des droits de l’homme. Dans un éditorial intitulé « The talibans would applaud », le New York Times invite le reste du monde à manifester sa révulsion devant cette violation des libertés individuelles qui serait motivée par la recherche d’un bouc émissaire au problème du chômage en France. Une question surgit alors : nos principes ne vaudraient-ils que pour nous ? Nous avons du mal à le croire. Pourtant, ce n’est pas la même chose de voir des femmes revêtues du voile et, a fortiori, du voile intégral déambuler dans les rues de Kaboul, du Caire ou de Téhéran, et de les croiser dans les rues de nos villes françaises.
Dans un cas, on ne se sent pas chez soi − et on n’est effectivement pas chez soi. Nous savons qu’il existe plusieurs civilisations et nous n’identifions pas la civilisation française à la civilisation tout court. Nous avons pris acte de l’irréductible diversité des manières d’être et nous avons acquis la sagesse de la limite qui nous dit qu’à l’étranger, notre sentiment d’étrangeté est la norme.
Dans le deuxième cas, on ne se sent plus chez soi. Cette même sagesse nous dit que la burqa et le niqab en France représentent un défi à ce que nous sommes et proclament que nos mœurs sont des options facultatives.
En les frappant d’interdit, l’État républicain ne s’est pas conduit comme un arbitre impartial chargé de veiller à la coexistence pacifique des différentes familles spirituelles, rôle qui conviendrait à la mission multiculturelle que lui assigne le libéralisme. Cet État n’a pas défendu seulement ses principes d’égalité, de liberté, de fraternité et de laïcité, que d’ailleurs les adversaires de l’interdiction ont retournés contre lui : il a défendu un mode d’être, un style d’existence, bref, risquons le mot, une identité commune. Oui, ce mot est risqué parce qu’il est possible d’en faire le pire des usages. D’où des interrogations qu’il est impossible d’éluder : le pire ne nous menace-t-il pas à nouveau ? Jusqu’où a-t-on le droit de revendiquer une identité commune pour penser le vivre-ensemble ?
La suite demain…[/access]
Cet article est issu de Causeur magazine n ° 41.
Pour acheter ce numéro, cliquez ici.
Pour s’abonner à Causeur, cliquez ici.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !