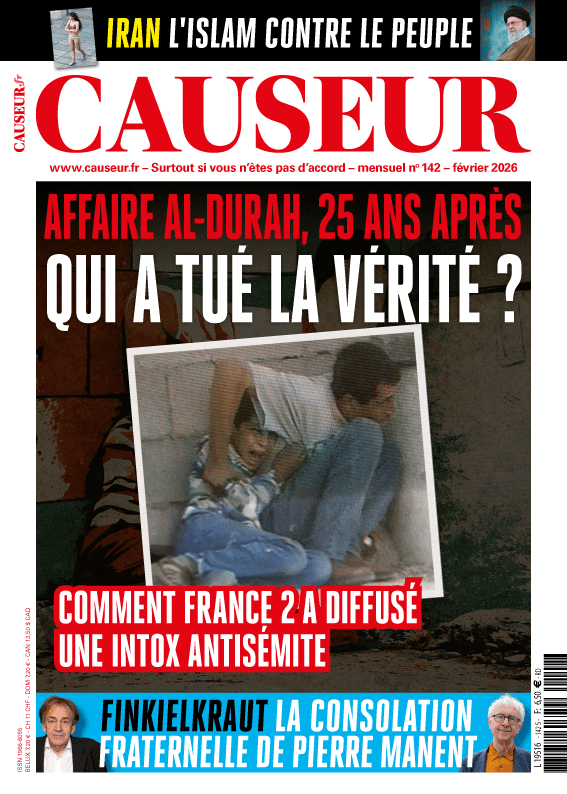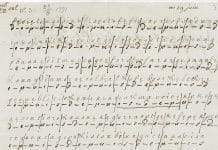Selon le grand historien du XVIIIe siècle, la Révolution française est encore bien vivante. Il suffit de voir comment ses « mythes noirs » sont instrumentalisés, de LFI aux JO de Paris. Son nouvel ouvrage remet les pendules à l’heure et démontre que la Terreur de 1793 est contenue dans les discours et les principes posés dès 1789.

C’est sous l’effet de la peur que l’on prêta serment au Jeu de paume. La Bastille ne fut pas prise, mais s’est rendue aux insurgés. La « machine philosophique » sanctifiée que fut la guillotine ne tarda pas à montrer toute son horreur. Valmy, longtemps célébrée, fut à peine une bataille. Les mythes ont la vie dure. Emmanuel de Waresquiel les dynamite dans un ouvrage captivant. « Que nous dit la Révolution d’elle et de nous-mêmes, dans l’épaisseur de ses mémoires ? » et comment l’instrumentalise-t-on aujourd’hui ? L’historien nous répond.
Causeur. Comment le grand historien de la Révolution que vous êtes a-t-il interprété le « tableau » consacré à Marie-Antoinette lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris ?
Emmanuel de Waresquiel. Nous sommes dans les mythes noirs de la Révolution, les mythes révolutionnaires. Le personnage de Marie-Antoinette est probablement l’un des plus clivants de cette période. Avec Marie-Antoinette, on vit encore la Révolution de l’intérieur, et la Contre-Révolution aussi. D’un côté, elle est la perversité absolue faite femme, elle est traîtresse et complotiste et étrangère et reine – ce qui fait beaucoup ! De l’autre, c’est la sainte et martyre du chemin de croix des Tuileries, de la tour du Temple et de la Conciergerie. Si l’on compare les deux procès, celui de Marie-Antoinette et celui de son mari, elle est beaucoup plus absolutiste que le roi. Elle défend l’absolutisme royal, les droits de son fils et l’Ancien Régime tel qu’il était constitué à l’époque – alors même qu’il ne l’est plus en 1793. Elle est beaucoup plus « claire », et dans un certain sens, beaucoup plus courageuse que son mari. Louis XVI se présente à la Convention en dansant d’un pied sur l’autre, entre le roi constitutionnel qu’il fut jusqu’en 1792 et le roi de droit divin. On ne sait plus très bien quel roi il est, et les constitutionnels hésitent avant de le faire comparaître devant la Convention pour le juger. Marie-Antoinette est infiniment plus tranchée.
Et elle a fait son apparition au milieu de la cérémonie d’ouverture des JO dans le tableau que l’on sait… Par rapport aux intentions du Comité olympique qui sont de mettre en avant les femmes, la concorde, la fraternité universelle, montrer l’épisode le plus tragique et le plus clivant de la Révolution, c’est aller à l’encontre même du message olympique.
Qu’est-ce que cela prouve, selon vous ?
Que la Révolution est encore vivante, que nous sommes encore nourris de ses imaginaires, qu’elle divise toujours la société, pas tant les murs dans lesquels nous habitons, c’est-à-dire les droits de l’homme, mais aussi l’esprit dans la maison : une culture politique très particulière, des affrontements de légitimité permanents dont on ne parvient pas à se débarrasser. De ce point de vue, la prégnance psychologique de la Révolution est patente, vécue de façon plus ou moins consciente par les Français. Et cette passion de l’égalitarisme ! L’obsession égalitaire est un héritage de la Révolution.
Vous écrivez, en substance, que l’un des risques, actuellement, est de faire une lecture téléologique de la Révolution, c’est-à-dire de tenter d’en comprendre le but à partir des résultats. LFI ne se prive pas de cette lecture. Comment l’analysez-vous ?
Ce qui me frappe, me trouble, c’est que cette gauche dont vous parlez se réclame de l’universalisme et, surtout, de l’indivisibilité de la nation, de l’unanimité nationale et en même temps, si j’en crois la note de Terra Nova de 2011, ses membres sont des adeptes forcenés du progressisme identitaire, lequel a une vision du monde tellement tranchée entre les dominés et les dominants, les colonisés et les colonisateurs, les Blancs et les Noirs que le simple fait de parler avec les dominants est un acte de compromission. Dans un certain sens, c’est assez intéressant du point de vue des contradictions de la Révolution elle-même qui prône l’universalisme, l’indivisibilité mais qui, en prônant l’indivisibilité, ne peut pas penser l’opposant autrement qu’en traître ou en étranger. Et en ennemi. Et la guillotine est au bout de ce chemin-là ! La culture de l’affrontement est une culture très française, en lieu et place du compromis « anglo-saxon ».
Autrement dit, les Insoumis réactivent une contradiction fondamentale entre l’indivisibilité d’un côté et, de l’autre, l’opposition entre l’humanité et ses ennemis ?
En effet. Ils se réclament de l’indivisibilité de la nation révolutionnaire et en même temps, leur progressisme identitaire et communautariste, articulé autour du schéma opprimé/oppresseur leur interdit le dialogue. Jean-Luc Mélenchon est totalement habité par la marche du peuple, comme l’a montré son grand discours à la Bastille du 18 mars 2012. Comme d’ailleurs le Comité olympique qui, inspiré par Patrick Boucheron, a calqué le parcours du marathon sur celui de la marche des femmes sur Versailles le 5 octobre 1789 ! Les membres du Comité ont oublié ce qui s’est passé au retour… Les têtes des gardes du corps sont sur les piques des sans-culottes. Bref, voilà une sorte de double contradiction en miroir : celle du principe d’indivisibilité posé en 1789 qui, d’une certaine manière conduit à la Terreur, et celle des rapports de La France insoumise avec les grands principes révolutionnaires dont ils se réclament et qu’ils contredisent à longueur de temps dans leur discours identitaire.
Vous lancez une hypothèse dans votre livre : peut-être ne souhaitons-nous plus nous entretenir des cauchemars du passé – comme s’ils ressemblaient trop à ceux du présent. Talleyrand écrivait : « L’âge des illusions est pour les peuples comme pour les individus l’âge du bonheur. » Les mythes de la Révolution ont la vie dure. Pourquoi ressurgissent-ils aujourd’hui et avec une telle force ?
Raymond Aron a très bien expliqué cela. La question de l’unité nationale, donc celle des grands mythes fondateurs, ressurgit à chaque sortie de crise ou à chaque entrée de crise. C’est très prégnant après la Seconde Guerre mondiale quand on tente de retisser le tissu national – on oublie des choses, on en met d’autres en avant, on pardonne. Ce fut la même histoire au début de la Restauration, sous Louis XVIII : le slogan monarchique de l’époque était « Pardon et Oubli ». Le seul problème, et nous sommes d’accord avec la dialectique de Paul Ricoeur, c’est que pour pardonner, il faut ne pas avoir oublié.
La Révolution française est singulière, écrivez-vous, car elle fut « à la fois politique et sociale, unilatérale, égalitaire, amnésique, ombrageuse et totalisante ». Arrêtons-nous sur chacun de ces termes. D’abord politique et sociale ?
1789 est une guerre civile larvée. Il ne faut pas oublier Furet qui parle du « tournant égalitaire ». C’est une guerre sociale entre les ordres (clergé, noblesse, tiers état) qui fait naître la notion d’ordre privilégié. Et puis la notion de complot aristocratique. Elle est déterminante pour expliquer ce qui s’est passé à Versailles en juin et à Paris en juillet 1789.
Unilatérale ?
Les 17 et 20 juin 1789, le tiers état se constitue en Assemblée nationale, puis en Assemblée constituante sans demander son avis ni au roi, ni aux deux autres ordres du royaume qui, par définition, sont exclus de la représentation de la nation ; ce n’est que par la suite qu’ils vont s’y rallier. La Révolution est aussi totalisante, bien que je préfère le terme absolutiste, car la vision que les révolutionnaires ont de la monarchie (vision traversée de beaucoup de fantasmes) est celle d’une monarchie encore absolue, comme si le roi était tout-puissant, à la tête de son armée et de son administration, alors qu’elles ne le suivent plus depuis belle lurette !
Égalitaire ?
Il s’agit d’égalité civile. Ni politique ni sociale. L’égalité est le terme trouvé par les députés du tiers état pour définir, sur fond de table rase, une société qui ne soit plus organique mais fondée, justement, sur l’individu. C’est le principe du droit naturel.
Amnésique ?
Oui. La Révolution, c’est l’homme régénéré, l’homme nouveau. On veut défaire l’homme de ses anciennes croyances, ce qui conduit aux autodafés des signes de la monarchie, de la féodalité… La Révolution introduit un nouveau rapport au temps : rupture avec le passé. Discours de Rabaut Saint-Étienne à l’Assemblée nationale : « L’Histoire n’est pas notre code ».
Enfin, pourquoi écrivez-vous que la Révolution fut ombrageuse ?
Elle n’est pas si printanière que cela. Elle est faite de rancœurs, de rancunes, de jalousies, de haines. Ma théorie, même si je n’en tire pas les mêmes conclusions que Clemenceau, c’est que « la Révolution est un bloc ». Autrement dit, la Terreur de 1793 est contenue dans les discours et les principes posés en 1789.
À lire
Il nous fallait des mythes : la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours, d’Emmanuel de Waresquiel, Tallandier, 2024.
Il nous fallait des mythes: La Révolution et ses imaginaires. De 1789 à nos jours
Price: ---
0 used & new available from