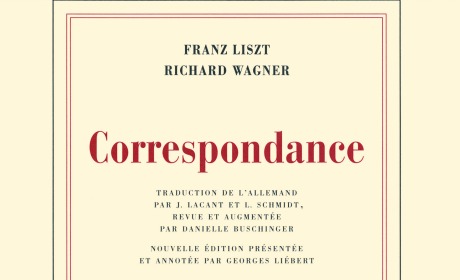Élisabeth Lévy. Au sujet de notre « Manifeste des 343 salauds », vous avez déclaré au Monde : « La forme était contestable. Mais je n’ai pas de critiques sur le fond. » Je comprends, sans la partager, votre réticence sur la forme, et vous remercie de votre soutien sur le fond. Comment expliquez-vous que ce sujet suscite un tel déluge d’insultes et de réactions outrées ?
Élisabeth Badinter. Aujourd’hui, tout sujet qui touche aux femmes se conclut en termes de « bien » et de « mal ». C’est comme ça. Pour couronner le tout, en osant vous emparer du manifeste des « salopes » sur l’avortement, vous avez commis une grosse erreur psychologique. On ne touche pas impunément à une cause sacrée ! Beaucoup de femmes ont mené un combat très dur pour obtenir le droit à l’avortement, le droit de disposer de leur corps. Dans ce contexte, notre ministre des Droits des femmes a eu beau jeu de dire : « Les 343 salopes réclamaient en leur temps de pouvoir disposer librement de leur corps. Les 343 salauds réclament le droit de disposer du corps des autres. » Et sa formule a fait mouche !
Certes, mais elle est fausse puisque le texte souligne l’impératif du consentement. Mais ne revenons pas là-dessus. Je pense que c’est surtout le titre : « Touche pas à ma pute ! » qui a scandalisé.
Le slogan « Touche pas à ma pute » a été taxé de « vulgaire », d’épouvantable. Ce souci de la vulgarité me fait un peu ricaner, mais en même temps, si on veut convaincre, il faut essayer de ne pas braquer ceux que l’on veut convaincre…
De toute façon, pour certaines néo-féministes, tous les prétextes sont bons pour crier haro sur le mâle !
Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. À leurs yeux, la prostituée incarne la victime absolue tandis que l’homme utilisateur de plaisir tarifé devient un « salaud » absolu, dominateur, exploiteur et violent, qui doit donc être puni. Cette image de l’homme m’est absolument insupportable, parce qu’elle l’essentialise sous les couleurs les plus sombres.[access capability= »lire_inedits »]
N’existait-elle pas déjà chez une partie de ce qu’on appelle aujourd’hui les « féministes historiques » ?
D’abord, je n’ai jamais appartenu au MLF, mais j’en ai beaucoup parlé avec mon amie Liliane Kandel, qui en a été une des fondatrices. Il est certain qu’il existait un esprit combatif contre le « sexe oppresseur », mais un esprit libéral sur le sexe. Il n’était pas question de punir la sexualité masculine, mais de permettre aux femmes d’accéder à une sexualité libre. Des figures historiques du MLF comme Gail Pheterson et Colette Guillaumin ont carrément publié des livres pour défendre la prostitution et les prostituées ! Pour la première, il valait mieux se prostituer qu’être une femme au foyer qui s’occupe de son mari, des enfants et de la maison, ce qui était alors le destin naturel des femmes. Vous voyez qu’on savait manier l’humour…
Si je ne m’abuse, vous n’avez pas été élevée dans cette perspective ?
C’est exact, mon père voulait que je fasse des études et que je travaille, mais il y avait des reliquats. Il fallait se marier et, surtout, avoir des enfants. L’obligation de se conformer à ce moule me semblait insupportable.
Comment les féministes sont-elles passées de l’éloge de la prostitution à la tentation abolitionniste ?
Il y a eu un renversement complet. Pour ma génération, marquée par Simone de Beauvoir, la femme était une héroïne parce qu’elle était une conquérante. Aujourd’hui, l’héroïne n’est plus celle qui prend des risques mais la victime. Cela me rappelle la réhabilitation des malheureux fusillés de 1917 par Jospin : on ne célèbre plus les auteurs d’actions extraordinaires, mais les victimes d’une injustice.
Or, s’il y a évidemment des femmes victimes de violences, les femmes ne sont pas toutes des victimes ! Cette manipulation s’avère extrêmement difficile à combattre, parce que ne pas entériner la situation de femme-victime vous place dans la position d’adversaire.
Dans le fond, le féminisme a, très logiquement, revêtu les habits du progressisme qui se confond avec la défense des damnés de la terre. De même que certains sortent leur revolver anti-islamophobe dès qu’on ose critiquer l’islam, certaines trépignent quand on refuse de communier dans leur vision victimaire.
Ce parallèle ne semble pas tout à fait exagéré. Dès lors que l’on définit les musulmans comme les victimes absolues de la domination et de l’exploitation du monde occidental, la critique devient, il est vrai, inacceptable. Si vous avez le malheur de remettre en question cette vision simpliste, par exemple pour critiquer le port du voile, vous vous trouvez du mauvais côté ! De la même manière, tous les 8 mars, la télévision et les journaux nous abreuvent d’images d’horreurs commises sur les femmes, pour nous prouver que la condition féminine est encore épouvantable. Je me mets à la place d’une petite gamine de 10 ans qui, entendant tout cela, doit se dire : « Quel horrible destin m’attend ! »
Tout de même, il est étrange que cette version « américanisée » du féminisme se soit imposée avec une telle force…
Étrange et consternant. Et savez-vous comment le féminisme français s’est aligné sur le féminisme américain ? Par la voie des pays anglo-saxons et, notamment, par les universités des pays scandinaves, où l’on publie en anglais. À partir de là, ces idées se sont diffusées à Bruxelles où les plus actives militent efficacement. C’est ainsi que ce féminisme victimaire et punitif s’est propagé à toute l’Europe.
Vous ressentez cette volonté de pénaliser les clients comme une « déclaration de haine à la sexualité masculine » que l’on voudrait « aligner sur la sexualité féminine ». Ne seriez-vous pas, horresco referens, en train de céder aux stéréotypes différentialistes que vous dénonciez hier ?
Pas du tout ! Je n’ai jamais dit, écrit ni pensé qu’il y avait « identité des sexes ». J’aimerais bien savoir quel est le malin qui peut dire qu’être homme ou femme, c’est la même chose. L’ultime différence, indicible, se joue peut-être au lit. Entre l’homme et la femme, hormones et fantasmes ont leur mot à dire. Certes, l’évolution des moeurs, et la multiplication des lieux de rencontre sur Internet, comme Meetic, font que les femmes peuvent très bien adopter la sexualité occasionnelle qui a longtemps été l’apanage des hommes. Pour autant, l’expression du désir, la recherche du plaisir, sont-elles semblables chez les hommes et les femmes ? Je ne crois pas, mais cela reste un mystère.
Autrement dit, il y a des différences entre les sexes mais on peut jouer avec. Si une femme a envie de se comporter selon le stéréotype d’un homme, ou l’inverse, elle est tout à fait libre de le faire !
Absolument. J’ai toujours dit, à la rigolade générale, que nous étions tous psychiquement et physiquement bisexuels. Chacun de nous est un petit mélange particulier de virilité et de féminité. Je ne sais pas si le désir masculin se féminise, mais l’expression de la sexualité féminine s’est en tout cas virilisée. Il y a encore trente ans, le stéréotype obligé de la sexualité féminine exigeait d’être follement amoureuse avant de s’offrir. C’est une époque révolue : les femmes peuvent désormais rechercher le plaisir pour le plaisir, et c’est très bien comme ça !
Plus de quarante ans après la libération sexuelle, on assiste à un retour inattendu de l’ordre moral. Vos héritières putatives ont réussi à prendre leur revanche sur les hommes et semblent leur dire : «Maintenant, c’est à votre tour d’en baver!»
On est passé du libertaire au punitif. Pour certaines féministes, toute avancée ne peut résulter que de la contrainte. Je ne suis pas sûre que tout cela facilitera les relations entre hommes et femmes.[/access]
*Photo : CHAMUSSY/SIPA. 00586921_000001.