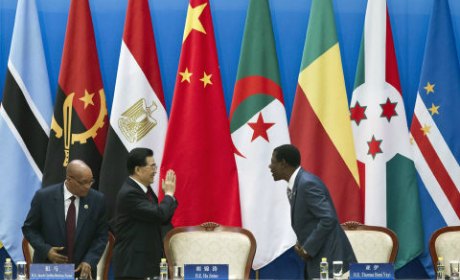Trouvé cet objet bizarre sur le site materialistes.com en consultant le Web, par une curiosité en voie d’épuisement, au sujet de la pénalisation des clients de prostituées : une critique au lance-flammes des 343 signataires de ce « manifeste fasciste » et, plus globalement, de la « revue de droite ultra-conservatrice et décadente Causeurs » (sic).
Pour être précis, il s’agit du « document 45 » paru sur le site officiel du PCMLM, Parti communiste marxiste-léniniste maoïste. Pourquoi évoquer ce document rédigé par un groupuscule réduit à l’état de microscopique fossile ? Parce qu’il vient d’un temps lointain, justement, où la lutte des classes conjoignait le puritanisme le plus implacable aux libertés sexuelles les plus innocentes. On y relève ainsi cette phrase optimiste : « Après-demain, lorsque la révolution socialiste aura triomphé et que les fascistes auront été exécutés, la bourgeoisie expropriée, effectivement la prostitution et la pornographie seront écrasés, au profit de la romance et de l’érotisme, car l’épanouissement ne peut aller qu’avec la dignité et le caractère authentique des sentiments. » Programme exaltant…
S’étonnera-t-on que le romantisme révolutionnaire mette ses pelotons d’exécution et ses camps d’internement au service de la cause des femmes ? Aujourd’hui il y a de quoi s’éberluer, mais en 1968 et les années suivantes, ce genre de cauchemar sentimental enchantait des franges ardentes et généreuses de la jeunesse. Ceci pour signaler que le mouvement libertaire, loin d’être uni, comprenait dans ses replis les plus farouchement gauchistes un versant puritain déjà opérant dans la Chine de Mao, puis parfaitement réalisé dans le Cambodge de Pol Pot avec le triomphe d’un collectivisme intégral, l’abolition de l’argent, de l’intime et de toute liberté. Qu’une poignée d’irréductibles se réclame aujourd’hui encore de régimes génocidaires pour chanter la « romance », l’« érotisme » et la « dignité des sentiments » souligne la permanence d’une volonté répressive de nature purificatrice au coeur même des idéaux d’émancipation.
Évidemment il ne s’agit plus, pour les éthérés cloîtrés dans leur bonne conscience, de régler à la mitrailleuse les questions morales. Certains continuent sûrement d’en rêver, mais l’époque a perdu l’espérance des « grands soirs ». Sur elle souffle désormais une brise presque démocratique qui se limite, contre les « néo-réacs », à des bordées d’injures et à des torrents de boue. À défaut de débattre, on n’abat plus : on se contente de haïr. On peut s’étonner, là aussi, d’une telle inaptitude à penser contre soi, et d’un tel manque de respect à l’endroit de ses contradicteurs.[access capability= »lire_inedits »]
Reste que, dans son ensemble, le puritanisme contemporain a déserté le champ proprement politique pour se polariser sur les questions liées à la libération des femmes. Car aucune époque ne s’est montrée aussi éloignée du puritanisme que la nôtre, du moins en apparence. Elle affiche une sexualité tous azimuts, balayant le spectre entier de ses représentations possibles, depuis l’esthétique raffinée de photos de mode où les effets de lumière et le charme des poses subliment la nudité, jusqu’aux vidéos les plus trash en libre accès sur le Net, lait pornographique que biberonnent les générations nouvelles. Rien de puritain dans les LGBT Pride, dans le « mariage pour tous », dans L’Inconnu du lac ou La Vie d’Adèle, ni dans le culte du corps sous toutes ses formes, sportives, artistiques, hygiénistes, au point qu’on a élevé le thème du corps, dans les arts comme dans le cercle universitaire des lettres et sciences humaines, au rang d’icône.
Que fait la cyber-police ? Il se pourrait néanmoins que ce soit précisément par la fenêtre du corps que revienne le puritanisme autrefois chassé par la porte de la révolution sexuelle. Sous le coup d’un retournement dont l’Histoire est prodigue, l’esprit libertaire, dont procède le féminisme reconnu enfin comme force motrice, se trouve désormais menacé par les victoires que peuvent revendiquer à juste titre les homosexuel(le)s et les féministes radicales, minorités alliées depuis des décennies contre le système patriarcal, lequel, en dépit des assauts, préserve ses positions tout en déclinant. Symbolisé par l’irrésistible expansion des biotechnologies, le culte de la vie qui caractérise la postmodernité éclaire le succès de ces minorités, succès matérialisé par l’exhibition des corps tels que les met en scène, actuellement, l’exposition « Masculin/Masculin » au musée d’Orsay. Mais ce même culte de la vie et ce même corps minoritaire tendent à se développer toujours davantage aux dépens du corps archaïque, celui du mâle blanc hétérosexuel, qui se repère en premier lieu dans la verticalité du pouvoir incarné par l’Église, reçu pour mortifère, oppresseur, discriminant, c’est-à-dire conservateur.
Il va de soi que les succès remportés par les minorités sociétales comprennent des retombées positives, à commencer par le droit qu’elles ont vaillamment acquis de s’exprimer en pleine lumière. Cependant l’incroyable violence symbolique qu’elles se permettent à l’égard de l’Église et, plus généralement, à l’égard de l’esprit conservateur, témoigne de la radicalité insatiable du combat qu’elles mènent. À titre d’exemple, il est arrivé à Charlie Hebdo de tourner en dérision le pape Benoît XVI avec une brutalité inouïe, équivalente toutefois au courage que ce magazine démontre en publiant les caricatures du Prophète.
Bien sûr, dans les deux cas, c’est la religion qu’on pourfend, autrement dit la liberté qu’on défend, ou plutôt qu’on croit défendre. Et c’est là qu’on retrouve le retournement de la liberté en son contraire. Paradoxe d’une sincère mais naïve volonté de progrès, Najat Vallaud Belkacem décide, au nom de l’émancipation des femmes, de réhabiliter contre les clients de prostituées le « surveiller et punir » naguère démonté et dénoncé par Michel Foucault. Pour traquer les passes commises dans le secret des alcôves, voilà l’actuelle ministre du Droit des femmes conduite à mobiliser les formidables moyens de la cyber-police en guise de panoptique, ce type de prison imaginé au XVIIIe siècle par Jeremy Bentham pour obtenir, grâce à une architecture appropriée, une surveillance totale des détenus.
Cette décision qui s’inscrit dans le processus généralisé d’espionnage et de transparence permis par l’outil informatique repose sur l’idée, partagée entre autres par les révolutionnaires de 68, que l’Histoire suit un cours inéluctable, et que c’est aller dans le sens du progrès politique et moral que de réprimer sans état d’âme ce qui s’y oppose. Les meilleures intentions du monde – combattre les misères de la prostitution – transforment alors la lutte des femmes, dont personne ne conteste la nécessité, en guerre de dames patronnesses soucieuses de coercition à l’encontre des hommes coupables de désirs inconvenants, et de rééducation des filles perdues.
Il est impossible de ne pas percevoir sous ces intentions l’ancienne aspiration à faire table rase du passé pour changer l’humanité en vue de la rendre meilleure : plus saine, plus propre, plus vertueuse. Malgré la montagne de crimes perpétrés par les sociétés totalitaires du XXe siècle qui ont assis leur système répressif sur ce projet faustien, la leçon n’a pas suffi : sous une forme hautement civilisée, le projet perdure. Et il s’en remet à l’État pour s’accomplir.
Le recours aux moyens de répression policiers distingue le féminisme radical, qui en recherche l’exercice pour parvenir in fine au renversement de la domination masculine à son profit, du féminisme réformiste qui, confiant dans la responsabilité individuelle de toutes et de tous, prend acte de la réalité suivante : dans leur principe, l’égalité en droits de l’homme et de la femme et l’exigence de parité sont, au sein de la société française, globalement acceptés. Ce fait ne signifie d’aucune manière que l’idéal est atteint : il reste une grosse masse de grain à moudre, de résistances à vaincre.
Mais, si considérables soient-ils, les progrès à réaliser se situent dans ce cadre, pas dans le renversement d’une domination en une autre. C’est ce qui justifie l’insistance sur la sauvegarde à tout prix des libertés individuelles, fondement du contrat volontaire entre parties responsables, de préférence à l’imposition contraignante de la loi. Le puritanisme n’a pas conscience de ce qu’il est, et il n’a pas de limites : c’est son plus grand danger. Il avance à coups de boutoir sans se préoccuper de ses excès ni de ses contradictions. Il s’avère même capable de fourvoyer l’analyse d’une anthropologue aussi éminente que Françoise Héritier, à en croire du moins l’association abolitionniste Zéromacho qui la cite en ces termes : « Dire que les femmes ont le droit de se vendre, c’est dire que les hommes ont le droit de les acheter. » Or il est tout à fait manifeste que les prostituées ne se vendent pas, mais vendent leur force de travail sous forme de prestations tarifées, et que les hommes ne les achètent pas, mais achètent le plaisir que ces prestations leur fournissent. Les seules femmes qui se vendent, sans d’ailleurs que leur droit personnel soit impliqué, sont les fillettes que leurs parents proposent, moyennant tribut, pour des mariages arrangés. On ne dira même pas que les femmes qui monnaient la participation de leur corps à une gestation pour autrui se vendent, mais qu’elles louent leur ventre sans pour autant cesser de s’appartenir.
Ces confusions dans l’approche théorique du problème trahissent des a priori idéologiques par définition contraires à l’honnêteté intellectuelle qui devrait prévaloir dans l’abord de ce problème, d’une importance indéniable puisqu’il se rapporte en profondeur aux relations qu’entretiennent les femmes et les hommes. Les anciens gauchistes, tout comme le féminisme radical qui soutient l’abolition en matière de prostitution et, sans doute, de pornographie, réprouvent le lien, certes regrettable mais aussi universel qu’évident, entre le sexe et l’argent. Ils en arrivent ainsi à une conception virginale de la femme, dont l’intégrité corporelle rime pour eux avec la pureté de l’âme. Même librement consentantes, les prostituées seraient des victimes en tant que les jouissances sexuelles dont elles font commerce les souilleraient. À suivre ce genre de raisonnement, dans le monde irénique qu’ils s’attachent à fonder, enfin délivré de la figure autoritaire du père, de la marque des ancêtres, du sceau des traditions et, au bout du compte, de l’altérité sexuelle (exemplairement, dans l’univers du communisme intégral rien ne distingue, sur le plan vestimentaire, les hommes des femmes), le credo de l’immaculé régnera. Sonia Semionovna, la prostituée mystique de Crime et Châtiment, passera aux oubliettes. Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel ne sera plus compris, ni Belle de jour de François Truffaut, ni La Maman et la Putain de Jean Eustache, ni tant de films, de romans, de récits qui n’ont que faire de la « romance » et du « caractère authentique des sentiments ».
Tout sera simple, sain, bardé d’interdits, surveillé. On sera frères et soeurs, sans ombres et sans passé. On sera tout neufs. On sera purs. On s’ennuiera à mourir.[/access]
*Photo : Mourir à 30 ans.