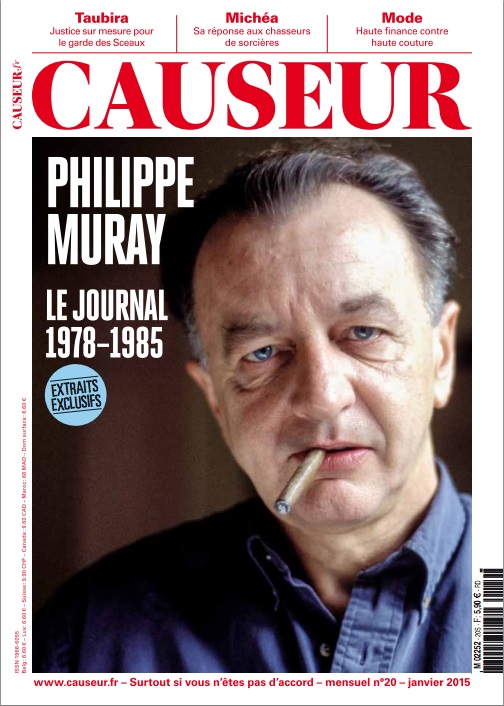Si les photos des fashion weeks vous semblent parfois aussi insondables et lointaines que certaines installations de la Fiac, mais que vous avez peur de passer pour ringard, c’est que vous avez raté quelques étapes. Retour sur une mutation aussi spectaculaire que fulgurante.
Jusqu’au milieu des années 1960, un mannequin, dit « mannequin cabine » ou « mannequin défilé », travaille presque exclusivement pour le couturier. Il en existe alors deux sortes, parfois confondues en une personne : celle qui pose pour les modèles en cours de fabrication, et celle qui défile. La première sert de « base » au couturier, qui crée littéralement le vêtement sur elle puis dessine un croquis sur une silhouette livrée avec explications au premier ou à la première d’atelier. Ce dernier reviendra ensuite avec le modèle en toile pour approbation, afin que le directeur artistique choisisse le tissu. Au moment des « collections », le mannequin présente les modèles dans les salons de la maison de couture, tous les jours pendant deux semaines ou plus, devant les clientes, la presse et d’autres invités choisis. Est montrée d’abord la haute couture, puis vient le prêt-à-porter, sur fond de musique douce. Les mannequins défilé doivent être « belles sans agressivité et raffinées sans ostentation ». Toutes ont suivi dans les différentes maisons des leçons de maintien : il faut marcher très droite, le bassin généralement plutôt en avant, dans l’esprit de la danse classique. Les filles de la cabine Chanel, femmes du monde souvent facétieuses et parfois muses d’artistes de la jet-set, les Paule Rizzo, Mimi d’Arcangues, Claude de Leuze, Gisèle Rosenthal, Paule de Mérindol, Odette de Blignières, Odile de Croüy, Marie-Hélène Arnaud, sont alors surnommées « la bande des blousons Chanel ». Et si les clientes des maisons de couture sont éblouies par la beauté de ces femmes très minces et très gracieuses, l’ambition secrète de leur ressembler n’est pas totalement inatteignable ni ridicule..[access capability= »lire_inedits »]
De leur côté, bloc-notes en main, les journalistes rédigent des descriptions détaillées et griffonnent les dessins des silhouettes numérotées qui seront reproduites dans les magazines. Ainsi les lectrices pourront-elles repérer le modèle qu’elles commanderont ou, pour les moins fortunées, passer le dessin à leur couturière de quartier, qui réalisera, pour elles et pour leurs filles, celui de leur choix dans un tissu moins cher. Le réel, alors, est encore bien palpable. Le système tel qu’il a été inventé par Worth1 un siècle plus tôt n’a pas tellement évolué. En moins de trente ans, il connaîtra une révolution qui transportera les mannequins dans une dimension quasi dématérialisée.
À l’origine de cette révolution, il y a Didier Grumbach. En propulsant le prêt-à-porter au détriment de la haute couture, cet homme d’affaires français va bousculer tous les codes. Il fonde en 1971 avec Andrée Putman la société Créateurs & Industriels, une plateforme inédite de rencontres entre les deux univers. Les stylistes, jadis au service des maisons de couture, deviennent « créateurs de mode », artistes dont le nom est une marque. De cette nébuleuse créative émergeront entre autres Emmanuelle Khahn, Jean-Charles de Castelbajac, Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier. Les coupes de leurs vêtements exigent des mannequins plus stylés, plus masculins, ou au moins plus androgynes. On leur apprend à marcher de manière plus agressive, en croisant les jambes avec un déhanchement. Il n’est plus question ni de maintien classique ni de sourire, que les stylistes japonais (Miyake, Yamamoto et Rei Kawakubo) ont déjà banni de leurs défilés.
Petit à petit, la haute couture décline. Plus moderne, plus accessible, le prêt-à-porter permet davantage de combinaisons et d’audaces dans sa garde-robe. Il vise un public large, puis énorme, bientôt l’équivalent pour le styliste des fans d’une rock star. D’une pièce de théâtre jouée devant quelques dizaines d’élus, le défilé se mue en show démultiplié sur petit et grand écran.
L’univers des mannequins n’échappe pas à ce grand chambardement : les mannequins cabine cèdent la place aux tops models, représentés par des agences internationales (Elite, Ford, Metropolitan…). Jusqu’aux années 1980, les stars, telles Mounia, mannequin-vedette d’YSL, ou Jerry Hall, demeuraient l’exception sur les podiums. Seules les mannequins de photos repérées par Vogue et Harper’s Bazaar, qu’elles fussent du genre socialites[2. Mot anglais désignant un membre de la haute société, lié à la mondanité joyeuse et brillante, remarquable par sa richesse, son esprit, son goût pour les arts.], comme Dorian Leigh et Bettina[3. Dorian Leigh (1917-2008), muse de Richard Avedon, amie de Truman Capote ; Bettina Graziani, mannequin et épouse du photographe Benno Graziani, puis du prince Ali Khan.] , ou transfuges de la rue, telles Veruschka ou Twiggy, accédaient au statut d’icônes. À cet égard, Inès de la Fressange, mannequin attitré de Chanel de 1983 à 1989, fut l’une des dernières exceptions.
Les tops models seront cette passerelle commercialisée du monde des photos à celui des podiums. Décrocher une Naomi Campbell ou une Linda Evangelista pour un défilé – leurs cachets faramineux permettant seulement leur apparition en « guest stars » – représente un gain considérable pour une maison. Le défilé devient une superproduction où les mannequins (célèbres ou non) sont bookés par des agences qui prennent en charge leur permis de travail, leurs hôtels, et choisissent la maison la plus généreuse. Il ne s’agit plus de salariées d’une maison, défilant à plusieurs reprises devant deux ou trois rangées d’invités, mais de cinquante « intermittentes », dont deux ou trois stars seront le feu d’artifice d’un spectacle réglé au millimètre. Plus question de musique douce ni d’éclairage en adéquation avec le maquillage ou la coiffure de jour ou du soir. On présente un look, devant un parterre parfois immense, dans une musique tonitruante. Il faut s’arrêter longuement au bout du podium pour les photos. Cette logique spectaculaire a suscité de grands moments de folie : John Galliano chez Dior et Alexander McQueen chez Givenchy ont pu s’y livrer avec une fougue excessive et parfois très talentueuse, le premier inventant le hardcore glamour, qui pouvait aller des tenues SM aux thème « clochardes », le second faisant défiler des mannequins handicapés.
En toute logique, les habitudes de la photo déteignent sur celles des défilés, et leurs exigences très particulières (maigreur, photogénie, éclairage) se banalisent pour devenir celles du réel. Or rien n’est plus impalpable que la photogénie. Et plus prosaïquement, puisqu’une photo de base confère automatiquement 3 à 5 kg de plus à son sujet, il faudra donc avoir dans le réel éliminé les kilos qui n’existaient que sur la pellicule.
L’étape suivante, celle des photos retouchées, d’abord partiellement puis intégralement, n’est que la continuation de cet éloignement progressif du réel. Les mannequins sont sélectionnés en fonction de critères quasi étrangers au monde des hommes et des femmes réels D’où cette impression étrange – non dénuée de beauté, de cette beauté fascinante du bizarre –, pour qui assiste aujourd’hui aux défilés. Peu importe, car l’enjeu s’est déplacé : le défilé ne sert plus à conquérir une poignée de clientes, mais à signaler une tendance au monde entier, tendance reproduite en instantané sur les blogs et les tweets, et susceptible d’être rapidement reproduite à bas coût par les stylistes des chaînes mondiales.
De même que les silhouettes féminines de Paris en 1900 sont plus proches de celles de la Renaissance que des nôtres, les défilés de mode des années 1960 ressemblent plus à un ballet exécuté à la cour de France qu’aux défilés actuels. Mais bon, on ne va tout de même pas regretter les femmes du monde ! Maintenant que nous sommes pour de bon en Démocratie, de quel droit y aurait-il des gens plus élégants que d’autres ?[/access]
*Photo : LaurentVu/SIPA. 00703138_000011.
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !