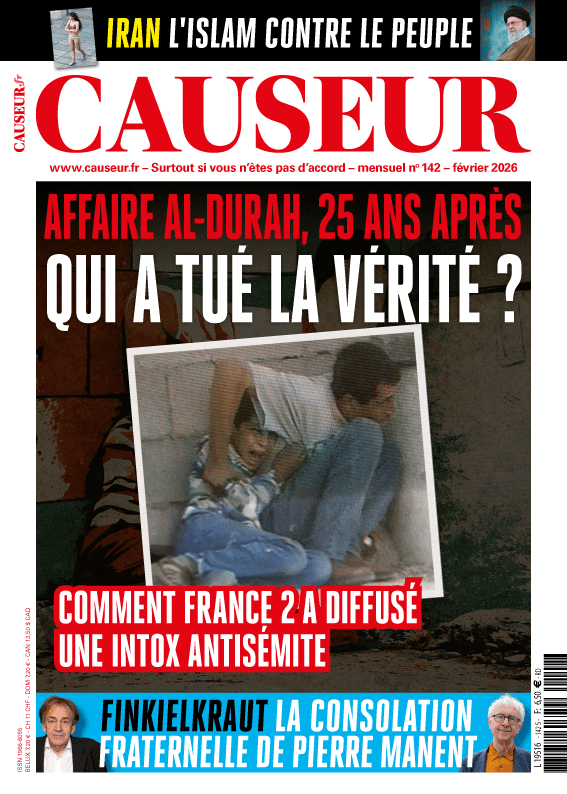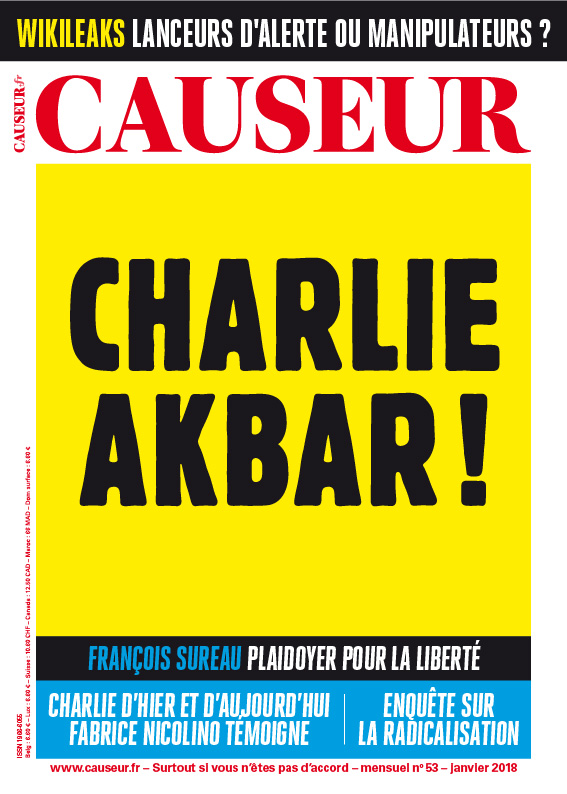Entretien avec Bernard Rougier, spécialiste du Moyen-Orient arabe et enseignant à l’université d’Auvergne et à Sciences-Po Paris.
Causeur. Y a-t-il un ou des profils du militant djihadiste ?
Bernard Rougier. On manque de matériaux empiriques sur la galère des banlieues, l’influence des discours religieux, le rapport complexe aux institutions républicaines des enfants de l’immigration maghrébine, le poids des réseaux locaux… Schématiquement, il y a d’abord les intellectuels, dont le rôle est de passer la réalité française au crible, avec un recodage religieux de la société. De jeunes diplômés de l’université française « déconstruisent » l’histoire de la République et font le lien entre le relativisme postmoderne à la mode dans les sciences sociales et un islamisme de rupture avec la société globale. L’autre catégorie correspond au profil du paumé, du jeune déscolarisé au collège, en survie précaire grâce aux dispositifs de l’aide sociale ou à l’accès aux petits boulots. Lecture assidue des textes fondamentaux, apprentissage de la langue arabe, le djihadisme accomplit ce que l’école a manqué : le sens du travail et une rigueur intellectuelle – sélective !
A lire aussi : Quartier libre pour la hallalisation des esprits
Pourquoi, selon vous, cette radicalisation par quartier ?
À la façon du communisme municipal des années 1950, des écosystèmes islamistes maillent l’espace local, en combinant lieux de culte, de restauration halal, club de sport et, parfois, filière professionnelle : agents de sécurité, employés de mairie, chauffeur de bus. On aboutit à une retraditionalisation des quartiers, qui renforce le contrôle religieux. Ces écosystèmes ne prônent évidemment pas la lutte armée sur le sol français, mais ils entretiennent une logique de rupture avec la société. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette production d’islam n’osent pas la remettre publiquement en cause, de peur de rompre le consensus local et de passer pour des traîtres à leur communauté. Ils se taisent, ou, s’ils ont les moyens, déménagent. À l’ombre de cet écosystème, vous avez une minorité djihadiste, elle-même engagée dans de nombreux débats internes, du reste. L’enjeu du défi républicain est un groupe majoritaire flou, qui se reconnaît dans l’islam, l’immigration et les quartiers, qu’il faut soustraire à cette emprise.
Les pouvoirs publics ont-ils pris la mesure du problème ?
On évolue vers une prise en compte plus lucide. Le schéma classique de l’embrigadement sectaire n’est pas opérant. De même, exagérer l’importance des convertis d’origine européenne dilue le rôle des « quartiers » dans les processus de violence. On focalise sur les réseaux sociaux et les manipulateurs charismatiques, en sous-estimant l’effet croisé des logiques idéologiques moyen-orientales et des logiques sociales françaises. C’est justifié par la volonté de ne pas nourrir le discours du Front national, mais c’est un déni de réalité.
La pensée extrême. Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques
Price: ---
0 used & new available from