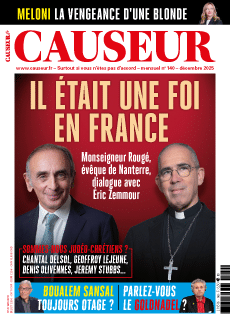Yvonne Beauvais, religieuse et résistante décorée par de Gaulle, a transformé son couvent en clinique moderne et a courageusement caché des Juifs et des résistants pendant la guerre, avant d’être torturée par la Gestapo. Mais son mysticisme, marqué par des phénomènes surnaturels, a suscité la méfiance, conduisant l’Église à abandonner sa canonisation en 1960 avec l’argument « Trop de miracles ». Jean de Saint-Cheron retrace son destin fascinant…
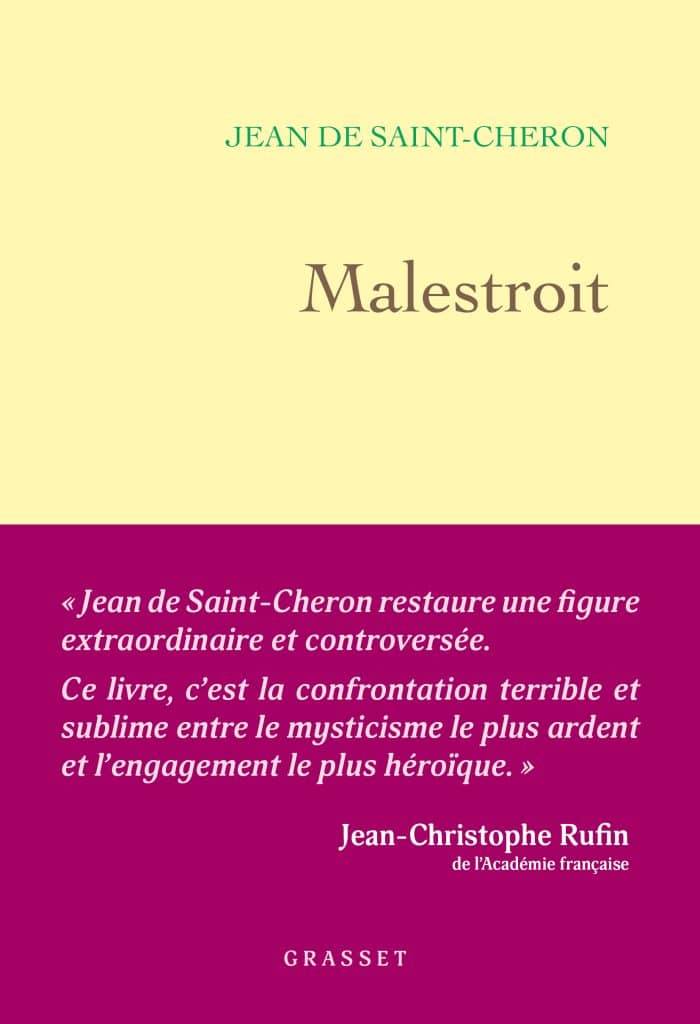
Notre époque matérialiste supporte difficilement l’intrusion du surnaturel dans nos vies de consommateurs soumis à l’immédiateté et à l’horizontalité. Dès que l’on parle de mystique, de phénomènes irrationnels, de prophéties, de stigmates, de bilocation, de visions autres que celles sous psychotropes, la société du Spectacle crie à la supercherie et s’imagine devant un tableau des Peintures noires de Goya. On ne comprend rien à l’épopée de Jeanne d’Arc, à son message universel, lorsqu’elle brûle devant une foule sidérée. On méprise les paroles de Saint-Bernard, prononcées en 1146, sur la colline de Vézelay, exhortant les paysans illettrés à le rejoindre pour grossir les rangs de la Deuxième croisade. On ne comprend guère mieux l’Appel du 18-Juin du général de Gaulle si l’on n’admet pas un acte dicté par l’irrationnel. Même le Vatican, parfois, se méfie des « miracles » et refuse de les reconnaitre. « Trop de miracles », déclare l’inquisition de l’Église de Rome, en 1960, après avoir examiné le cas d’Yvonne Beauvais, morte le 3 février 1951, des suites d’un cancer du sein, à l’âge de quarante-neuf ans. Le dossier de canonisation est alors définitivement refermé.

Mais qui était cette femme ? Une mythomane ? Une illuminée ? Une malade rongée par l’absence du « phallus symbolique » ? Ou une femme trop libre, à la volonté de fer, dans une société patriarcale ? Dans un livre passionnant, qui se lit comme un roman de Simenon, Jean de Saint-Cheron mène l’enquête au pays de cette belle jeune femme qui se fit religieuse à l’âge de 26 ans et transforma le monastère des Augustines de Malestroit en une clinique moderne. Pas mal pour une prétendue possédée. On le suit pas à pas dans la Bretagne tellurique, sous les ornières du ciel, cette Bretagne « parsemée de bosquets de chênes, de menhirs et d’Intermarché ‘’Les Mousquetaires’’ ». On découvre le couvent gothique, les boules bleues des hortensias, les silhouettes massives des taiseux qui passent sans vous regarder. C’est le territoire d’Yvonne Beauvais, connue sous le nom d’Yvonne-Aimée de Malestroit. Son dévouement, sa bravoure, sa foi méritaient un livre de cette dimension. Jean de Saint-Chéron lui rend un vibrant hommage tout en n’hésitant pas à éclairer les zones sombres de sa personnalité. Sans être une « sainte bataillienne », les crises mystiques d’Yvonne obligent à la prudence tant les phénomènes de stigmates et de prémonitions, ainsi que ses visions violentes, sont formidables. L’auteur nous apprend qu’elle fut également une grande résistante, ce qui n’est pas rien dans une France collaborationniste. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Mère supérieure est gaulliste. Malestroit cache massivement des résistants, des parachutistes alliés, sans oublier cette jeune juive qui échappe aux wagons plombés. Yvonne est arrêtée par la Gestapo, elle subit la torture, ne parle pas, à l’instar de Jean Moulin qui aura le visage détruit par les coups. Cette femme, par son courage, devient comme une sœur des suppliciées de Ravensbrück. Extrait : « Quand on la torture le 17 février 1943 à la prison du Cherche-Midi, alors que des plaintes cauchemardesques s’échappent des cellules voisines, Yvonne Beauvais ne hurle pas. Le benêt qui la violente la regarde danser sur ses orteils, tandis que ses épaules se déforment sous les assauts du cuir. Elle souffre en silence. » Elle sera décorée de la Légion d’honneur par le général de Gaulle. C’était une époque où cette décoration signifiait quelque chose.
Pour la comprendre, et l’aimer, il y a cette lettre écrite à Marguerite Villemont, datée du 2 novembre 1925 : « Ce soir, en visitant des tombes de famille, des amis, des connaissances, je sentais un bonheur intense m’envahir. Oh ! si le monde pouvait comprendre ce qu’est vraiment la mort. Mourir, c’est enfin sortir du moi borné et se jeter dans l’infini de Dieu. »
Jean de Saint-Cheron, Malestroit, Vie et mort d’une résistante mystique, Grasset. 224 pages.