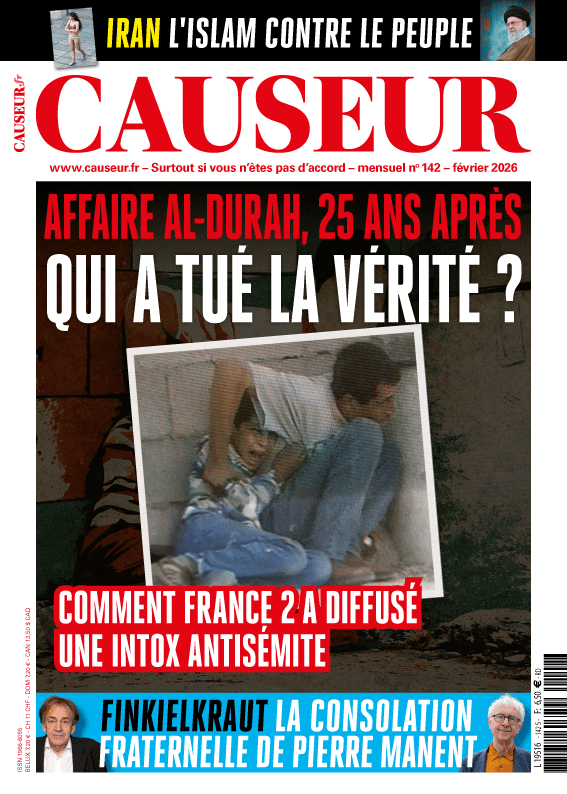La peur est entrée dans Paris. Et un peu partout en France. A coups de prophéties alarmistes, certains médecins médiatiques nous annoncent une seconde vague de Covid-19 semblable au pic qui a affecté l’hexagone au printemps dernier. Sachons raison garder, recommande Frédéric Adnet, professeur de médecine d’urgence à l’Université de Paris 13. Ce praticien qui dirige les urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny explique pourquoi, malgré les milliers de contaminations quotidiennes, nous ne revivrons plus la situation épidémique de mars-avril. Entretien.
Daoud Boughezala. Dans les médias, nombre de vos confrères médecins alertent sur le risque d’une future seconde vague. D’après eux, la courbe suivie ces derniers jours par le nombre d’infections quotidiennes au Covid-19 laisserait présager un retour à la situation épidémique de mars-avril. Partagez-vous cette analyse ?
Frédéric Adnet. Non. Tous les experts s’accordent sur le fait que si deuxième vague il y a, elle ne ressemblera pas à la première. Or, un certain discours anxiogène laisse croire que nous risquons de nouveau d’être submergés par une deuxième vague similaire à la première. Ce n’est pas du tout ce que disent les épidémiologistes et les médecins spécialistes des maladies infectieuses. D’abord, on ne peut pas comparer le nombre de nouveaux cas quotidiens observés en mars-avril avec celui qu’on observe aujourd’hui parce que la méthode de dépistage est radicalement différente. Au printemps, les dépistages étaient très ciblés vers les patients symptomatiques qui répondaient aux critères d’hospitalisation. Autrement dit, les patients les plus graves. Aujourd’hui, on fait du traçage extrêmement large, c’est-à-dire des dépistages de masse, en direction des patients symptomatiques, asymptomatiques, des cas contacts, etc.
Voici pourquoi nous n’avons pas (encore) de deuxième vague?
Les discours sont un peu alarmistes sur la circulation actuelle du virus car elle est comparée à la courbe de la première vague (document). Cette comparaison à l’air inquiétante mais elle est fausse.
Voici pourquoi: pic.twitter.com/yNJNbyqOKA— frederic adnet (@fredericadnet) August 18, 2020
Il faudrait multiplier les courbes de mars-avril par un facteur qui peut varier de cinq à dix pour pouvoir la comparer à l’augmentation actuelle. Aujourd’hui, on observe probablement un petit rebond qui n’a rien à voir avec ce qui s’est passé en mars-avril.
Si deuxième vague il y a, en quoi sera-t-elle différente de la première ?
Lors de la première vague, le virus s’est diffusé dans une population dite « naïve », c’est-à-dire sans aucun moyen de protection ni surtout aucune immunité collective. Le virus s’en est ainsi donné à cœur joie. D’où cette célérité, la vitesse de la croissance du nombre de nouveaux cas graves qui a été phénoménale au point de submerger notre structure hospitalière. Aujourd’hui, le virus est toujours là et continue de se propager. Sauf que ce qui joue sur la vitesse de propagation d’une épidémie, ce sont les moyens que l’on se donne pour la freiner : les masques (une étude montre que si 50% de la population le porte, cela a un impact direct sur la vitesse de propagation du virus), la distanciation physique, le traçage et l’isolement des cas détectés. Ajoutons à cela l’immunité collective.
L’amplitude du rebond ne peut pas atteindre l’intensité de la première vague car plusieurs éléments va « freiner » le virus: population partiellement masquée, distanciation partiellement suivie, Tracing. et immunité collective. Ces quatre éléments vont freiner le flux de patients
— frederic adnet (@fredericadnet) August 18, 2020
On a lu tout et son contraire sur la notion d’immunité collective. Sa réalité est-elle avérée ?
Revenons aux fondamentaux. Ce que l’on sait clairement, c’est qu’un patient atteint de cette maladie, même dans sa forme peu symptomatique, développe une immunité humorale. Le Covid est donc une maladie qui provoque une immunité protectrice efficace. Certes, on ne connaît pas la durée de cette immunité mais des éléments sont rassurants : sur 24 millions de cas recensés à travers le monde, on n’en a pas encore recensé un seul qui s’est réinfecté. Cela démontre un peu par l’absurde que l’immunité marche. On est maintenant pratiquement certain de l’efficacité de cette immunité générée dès lors qu’on attrape le virus. Reste l’incertitude sur sa durée, avec des études en laboratoire contradictoires. Mais l’épidémie a commencé en novembre et en août, la Chine n’a toujours pas de cas de réinfection. On peut donc raisonnablement estimer donc que l’immunité protège son porteur au moins un an.
Certains scientifiques évoquent également d’autres types d’immunité. Desquelles quoi s’agit-il ?
En plus de l’immunité humorale, il existe deux autres types d’immunité qui sont toujours en discussion. La première est l’immunité cellulaire, que l’on ne détecte pas par les tests sanguins car ces tests détectent les anticorps qui vont aller attraper le virus, pas les cellules qui vont aller manger les cellules infectées. Or, l’immunité cellulaire est extrêmement efficace. On s’est aperçu qu’un certain nombre de patients avait un test d’immunité humorale négatif mais un test d’immunité cellulaire positif. Les tests actuels d’immunité humorale sous-estiment donc probablement l’immunité collective.
Soit dit en passant, pourquoi ne pratique-t-on pas des tests pour mesurer l’immunité cellulaire ?
Parce que cela nécessiterait des tests très chers et très compliqués. Alors que la détection de l’immunité humorale ne demande qu’une goutte de sang mise sur du papier buvard avant d’obtenir la réponse en une demi-heure, comme un test de grossesse, l’immunité cellulaire nécessite des cultures de culture et toute une infrastructure complexe longue à mettre en place. En pratique courante, on ne pourra jamais lancer de campagne de détection de l’immunité cellulaire.
Si j’ai bien suivi, reste donc un second type d’immunité collective. Quel est-il ?
La seconde immunité est l’immunité croisée. Le coronavirus SARS-CoV-2 appartient en effet à une famille de sept virus qu’on connaît bien, avec trois « méchants » et quatre « gentils ». Parmi les coronavirus « méchants », on trouve le MERS, le SARS-CoV-1 et le fameux SARS-CoV-2 (Covid-19). Quant aux coronavirus « gentils », ils sont responsables de rhumes et de symptômes grippaux sans gravité. En laboratoire, on s’est aperçu que les anticorps actifs contre ces coronavirus « gentils » et très fréquents pouvaient être efficaces contre le SARS-CoV-2 (Covid-19). L’immunité croisée est un grand espoir qui aurait pu expliquer le fait que les enfants s’infectent moins. Les rhumes touchent surtout les enfants, lesquels développent des anticorps contre les « gentils » coronavirus qui, en laboratoire, sont efficaces contre le Covid. Malheureusement, cela n’a pas été vérifié dans les études cliniques. Une étude française célèbre a même montré que les enfants qui avaient les anticorps contre les coronavirus « gentils » s’infectaient de la même manière que les autres. L’immunité croisée fait donc actuellement débat. Elle marche in vitro en laboratoire mais l’étude clinique sur les enfants la contredit.
Ce résultat décevant donne-t-il raison aux plus pessimistes ?
Non. S’il n’y avait pas d’immunité efficace, on ne pourrait pas élaborer de vaccin, comme pour le VIH. Or, on parvient à obtenir cette immunité reproductible dans les essais pour fabriquer un vaccin. Dans les phases 1 et 2 des vaccins américains, chinois et russe, lorsqu’on injecte des protéines du virus ou du virus inactivé, cela provoque une réponse immunitaire très forte et protectrice.
L’immunité collective reste un grand espoir. Actuellement, le Conseil scientifique de l’Elysée la chiffre de manière complètement pifométrique à 10% de la population française. Ce chiffre est une moyenne qui reflète de grandes disparités. En Seine-Saint-Denis et dans l’est de la France, il doit être plus élevé. Mais dans les régions peu touchées comme la Bretagne ou le Pays basque, l’immunité collective doit être beaucoup plus faible. En tout cas, quel que soit son pourcentage, c’est un frein à la propagation du virus. C’est pourquoi la deuxième vague, qui va se propager au sein d’une population avec une immunité collective, respecte la distanciation et suit les procédures de traçage, sera beaucoup plus lente que la première. Toutes les mesures que nous adoptons ne visent pas à tuer le virus mais à contrôler la vitesse de l’épidémie.
A l’instar de certains médecins, préconisez-vous de suivre les chiffres de la létalité – plutôt rassurants – plutôt que ceux des nouvelles infections afin de suivre la progression du virus ?
Pas du tout. La létalité n’est sûrement pas une indication fiable car on lui fait dire n’importe quoi. Il est très difficile d’avoir une idée de la mortalité liée au Covid-19. Et ce pour plusieurs raisons. Il y a une mortalité directe et indirecte, par exemple liée au fait que les patients ont peur d’aller à l’hôpital, restent chez eux et meurent d’un infarctus du myocarde. Sans parler des maladies chroniques ou des morts subites, dont on ne sait jamais si elles sont directement ou indirectement liées au Covid-19. Il est complètement délirant de prétendre comme le Pr Raoult que le virus tue moins à Marseille qu’à Paris parce qu’on ne maîtrise pas du tout le dénominateur – est-ce que la population est comparable ? est-ce que l’exposition au virus était comparable ?
Pour mesurer l’impact d’une épidémie, il faut comparer les courbes de mortalité prévues aux courbes de mortalité obtenues. Par exemple, si en août 2019, il y avait 100 000 morts en France contre 120 000 en 2020, cela voudrait dire qu’il y a eu un excès de mortalité de 20 000 personnes qu’on va rattacher au Covid-19.
Le vrai marqueur de l’épidémie, c’est l’impact qu’a le virus sur nos structures hospitalières : le nombre de patients en réanimation, le nombre de ceux qui appellent le Samu, de ceux qui entrent en hospitalisation complète et le nombre de tests PCR positifs. Ces indicateurs donnent une idée de la morbidité, donc de la mortalité de l’épidémie.
à suivre…
Causeur ne vit que par ses lecteurs, c’est la seule garantie de son indépendance.
Pour nous soutenir, achetez Causeur en kiosque ou abonnez-vous !