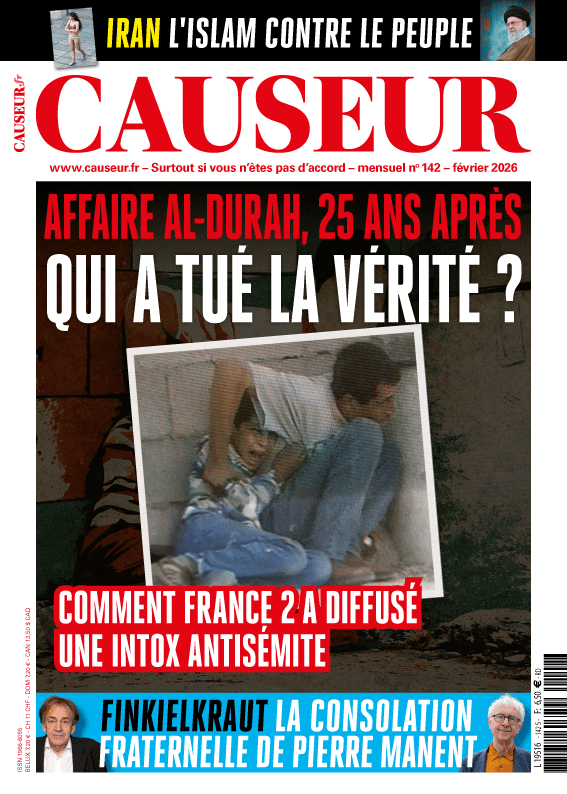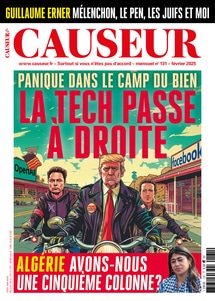La bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris dévoile une partie de son éblouissante collection de bijoux de scène. Des pièces d’orfèvrerie qui relèvent de la haute joaillerie et qui, pour certaines, remontent à la Restauration. L’histoire de ces tiares, diadèmes, couronnes et colliers regorgeant de perles et de brillants est, en soi, un conte de fées.

Il était une fois un puissant royaume dont le roi se nommait Opéra et la reine s’appelait Danse. Ils régnaient dans un splendide palais au sein duquel existait une salle fort retirée, enfouie dans les brumes de l’oubli. Personne à la Cour n’en savait la destination et nul depuis des lustres n’aurait pensé s’y hasarder. Or, il advint que la clef de cette chambre mystérieuse fut un jour remise à une noble dame nouvellement arrivée et qui reçut le commandement d’en retirer tout ce qui s’y pouvait receler. C’était une bien étrange aventure qui survenait là. La dame n’avait nulle conscience de la tâche dont on la chargeait. Et quand il lui fut enfin donné d’ouvrir cette porte, elle pensa sur le seuil défaillir d’étonnement : dans les vitrines qui tapissaient les murailles, sur des tables immenses, dans les armoires, ce n’était que ruissellement de couronnes, de diadèmes, de tiares, de colliers, de pectoraux, de bracelets, de broches, de pendentifs ; que cascades de diamants, d’émeraudes, de rubis, de saphirs, d’améthystes et de perles fines.
Si l’on écrivait encore des contes à la manière de jadis, voilà comment on pourrait relater l’extraordinaire aventure qui advint en 1980 à une dame détachée, à sa demande, par l’Éducation nationale, auprès de l’Opéra de Paris. À peine installée dans les murs de l’institution, Danièle Fouache fut effectivement chargée de libérer une vaste pièce perdue dans l’immensité du Palais Garnier afin de ménager un nouvel espace qu’on destinait aux ateliers de confection de costumes, et d’en déposer pêle-mêle le contenu dans les combles. « On m’avait donc confié la clef de la mystérieuse chambre et tout comme l’héroïne de Barbe bleue, j’en ouvris la porte dans une parfaite ignorance de ce qui m’attendait. Et comme je suis émotive, je faillis m’évanouir en découvrant le contenu ! »
À lire aussi, Raphaël de Gubernatis : Le « Boléro », les mystères d’un chef-d’œuvre
Près de 10 000 joyaux étaient accumulés là sans que nul, alors, ne s’en soucie : des ornements accumulés depuis l’inauguration de l’Opéra en 1875 et qu’avaient portés toutes les impératrices, les princesses, les rois, les tsars, les princes, les courtisanes, les bayadères des opéras et des ballets du répertoire. « L’Opéra n’était en ce temps qu’une maison de production, soupire Danièle Fouache. On y vivait au rythme de la saison lyrique et chorégraphique et on n’y avait pas encore acquis la notion de conservation du patrimoine. » Tout était relégué là sans qu’il n’y ait personne pour soupçonner la richesse, l’ampleur et l’intérêt de ces merveilles. Ainsi s’était assoupi un fabuleux trésor sur lequel ne veillait nul terrible dragon, et dans lequel, parfois, des costumiers barbares s’en allaient puiser, démontant, saccageant sans vergogne ces merveilles de la joaillerie pour créer à moindres frais de nouveaux ornements.
Des bijoux dignes des maisons royales…


Mademoiselle Brandon, 1895 © Charles Duprat, OnP

pour Aida de Giuseppe Verdi, 1880 © Charles Duprat, OnP
Ces bijoux magnifiques, destinés à exalter des personnages hors norme et à resplendir de loin, avaient été dessinés par des décorateurs, des costumiers fameux et façonnés par les orfèvres des quartiers du Marais, ceux-là mêmes qui œuvraient pour les grands joailliers de la place Vendôme. Puis, dès les années 1930, par souci d’économie et parce que le goût avait changé, par les ateliers mêmes de l’Opéra.
Certes, à l’exception de la turquoise, de l’opale ou du corail, les pierreries sont fausses, les perles sont faites de verre soufflé dans lequel on a instillé quelque liquide afin de leur conférer le plus bel orient. Mais le raffinement et la splendeur des parures créées par les ateliers d’orfèvres étaient parfaitement semblables aux ouvrages de la haute joaillerie. Avec des bijoux de scène dont les plus anciens datent peut-être de la Restauration, l’ensemble est unique au monde. Et personne n’en avait conscience. Comme on n’avait pas eu conscience, au début de la Troisième République, de l’immense valeur historique et vénale que représentait l’ensemble des joyaux de la Couronne : 77 486 pierres et perles composant des chefs-d’œuvre furent dispersées, vendues à perte en 1887 par haine de la monarchie et par mépris républicain du patrimoine.
Et comment les faire resplendir…
En 2004, un quart de siècle après cette découverte, lors d’une exposition malicieusement titrée « L’Air des bijoux » (on avait encore quelque esprit), près de 400 pièces d’orfèvrerie ont été présentées dans la rotonde des abonnés, à l’Opéra, caverne idéale pour abriter de tels trésors et qui s’est fait l’écho, durant six mois, de celle d’Ali Baba. Des trésors alors restaurés par les élèves du lycée de la bijouterie Nicolas-Flamel, à Paris.
A lire aussi: Le plaisir d’être trompé
Vingt ans plus tard, alors que 4 000 de ces ornements sont désormais sous la sauvegarde de la bibliothèque-musée de l’Opéra, et donc de la Bibliothèque nationale, on ne montre que 70 pièces de ce trésor de légende. Un rien dans cette immensité qui fait immanquablement penser aux présents qu’offre l’Inca à Tintin dans Le Temple du soleil avant de lui découvrir, pour taire ses scrupules, les centaines de jarres débordantes d’or et de pierreries alignées dans une gigantesque salle souterraine ; mais un rien d’un luxe inouï, digne d’être confronté aux joyaux des maisons souveraines d’Europe, et porté par tous les héros et les héroïnes du répertoire.
Jusque-là, leur seule magnificence avait suffi pour exposer ces joyaux. Avec le temps est apparue la nécessité d’étoffer le propos : les 70 ornements sont présentés dans un tout autre esprit. Aujourd’hui, des recherches poussées les resituent au cœur des ouvrages lyriques ou chorégraphiques pour lesquels ils ont été créés et rappellent les artistes qui les ont portés. Et grâce aux maquettes de décors, aux affiches, aux vidéos, on les redécouvre dans le cadre au sein duquel ils ont resplendi.
« Bijoux de scène de l’Opéra de Paris ». Jusqu’au 28 mars 2025, bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris.