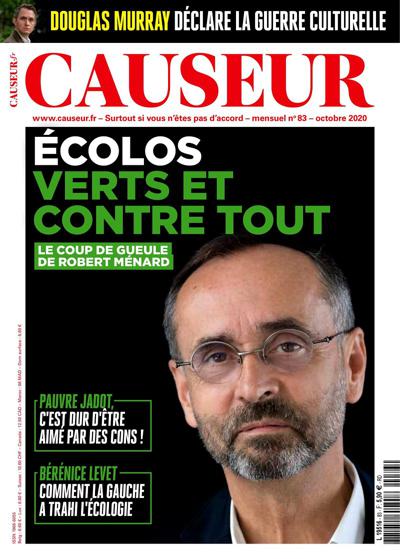Pour l’auteur de Juger la Reine, tout s’est joué entre le 17 et le 23 juin 1789 : la fin de mille ans de monarchie et l’avenir de la France. Restituant, grâce à des sources très variées, l’atmosphère de ces journées, l’historien explore trois évènements fondateurs de tout ce qui suivra, de la Déclaration des droits de l’homme à la Terreur en passant par tous les avatars ultérieurs de la longue guerre civile française. Repondant à François Furet, il affirme que la Révolution n’est pas terminée.
Élisabeth Levy. Votre livre[tooltips content= »Sept jours – 17-23 juin, la France entre en Révolution, Tallandier, octobre 2020″](1)[/tooltips] se concentre sur la semaine du 17 au 23 juin 1789. Pourquoi l’histoire populaire retient-elle de tout autres dates ?
Emmanuel de Waresquiel. Parce qu’en France, on a toujours été plus attaché aux symboles qu’aux réalités qui se cachent derrière eux. La Bastille est très vite devenue le symbole de l’insurrection populaire et de la prise du pouvoir par le peuple, donc un acte fondateur. En réalité, elle n’a jamais été « prise », elle s’est rendue. Le peuple ne l’a pas plus attaquée parce qu’elle était « l’antre du despotisme », mais parce qu’il s’y trouvait de la poudre. Le roi et son gouvernement étaient déjà nus le 14 juillet 1789. Les choses se sont jouées avant, en juin, avec trois événements liés entre eux et qui contiennent en eux-mêmes toute la Révolution et tout ce qu’elle deviendra par la suite, jusqu’à la guerre civile et la Terreur de 1793. Reste qu’en une semaine, tout est accompli, la révolution politique, mais aussi la révolution sociale.
Commençons par le 17 juin : les députés du tiers état se constituent en Assemblée nationale indivisible en adoptant la motion de Sieyès. En quoi s’oppose-t-elle à celle de Mirabeau ?
Mirabeau propose de faire des députés les représentants du « peuple français ». Dans son esprit et dans celui de nombreux députés du tiers état, le peuple n’est pas la nation. Il n’en représente que la part la moins éclairée. Il est un allié nécessaire, mais un allié dangereux. Quoi qu’il en soit, Mirabeau préserve ainsi ceux qui restent : les représentants de la noblesse et du clergé, et tout autant le roi. Toutes les déclarations de Louis XVI, depuis son avènement au trône en 1774 et jusque sous la Révolution, qu’il n’a par ailleurs jamais comprise, tournent autour de cette même idée : « Je ne fais qu’un avec la nation. » En se déclarant unilatéralement les représentants de la nation, les députés séparent le roi de cette dernière et le privent du même coup de sa sa légitimité. En quelques jours et après mille ans de droit divin et d’incarnation monarchique, la souveraineté change brutalement de camp. C’est cela la « table rase » évoquée par François Furet. De plus, le même jour, ils placent la dette publique sous la protection et l’honneur de la nation, privant le roi du plus important de ses pouvoirs régaliens, celui de lever l’impôt.
Les Français évoquent la raison et pourtant, ils sont habités par leurs désirs, leurs fantasmes
On se heurte immédiatement à un paradoxe français. L’aspiration à l’« indivisibilité » se conjugue avec une conflictualité permanente.
On peut dire que la guerre civile française a commencé à l’instant où les députés du tiers état se sont constitués en Assemblée nationale, non pas par un contrat passé avec le roi et les deux autres ordres, mais contre eux. En se proclamant seuls représentants de la nation et en déclarant cette dernière « indivisible », ils renvoient les deux autres ordres du royaume à l’inexistence politique et sociale, à leur « inutilité ». « Mauvais citoyens », « privilégiés », « ennemis », « traîtres », « complot » : on trouve déjà dans les discours de juin 1789 les mots de la Terreur. Toute l’habileté des députés du tiers état est d’avoir fait croire à l’opinion que les exemptions et privilèges fiscaux ne touchaient que les nobles et le clergé, soit un peu moins de 500 000 personnes sur une population de 26 millions d’habitants, comme s’ils ne bénéficiaient pas aussi de ces derniers : pays d’État, corps de ville, corporations, etc. Le décret du 17 juin est un décret de combat.
Trois jours plus tard, le 20 juin, trouvant porte close, les mêmes députés du tiers se rendent au Jeu de paume tout proche et jurent de ne se séparer que lorsqu’ils auront donné une constitution à la France.
Les députés du tiers s’étaient déclarés Assemblée nationale indivisible le 17 juin. Le 20 juin, ils se déclarent Assemblée constituante, unanime et indissoluble. Le 23 juin, c’est le dernier épisode. Le roi et le gouvernement tentent de reprendre la situation en main.
Mais les trois discours de la séance royale du 23 juin résument l’impasse dans laquelle se trouve l’absolutisme monarchique. D’un côté, une velléité de modernisation libérale, de réformes administratives et fiscales ; et de l’autre, le maintien d’un ordre social inégalitaire qui fonde la légitimité même du pouvoir royal. En conséquence, il ne vient pas une seconde à l’esprit de Louis XVI de réunir les ordres séparés au sein des états généraux en une assemblée unique qui voterait « par tête » et donnerait une quasi-majorité au tiers état. De même, les états généraux restent, dans son esprit, un organisme de conseil et non de décision essentiellement réuni pour éviter une banqueroute qui guette le pouvoir depuis des années. À l’issue de la séance du 23 juin, le roi demande aux députés des trois ordres de se retirer dans leurs chambres respectives. La noblesse et une partie du clergé s’exécutent. Les députés du tiers s’y refusent et dans la foulée, se déclarent inviolables, ce qui est inouï. Ils représentent désormais la nation et n’ont plus d’ordre à recevoir du roi. Cependant, la réponse de Mirabeau au grand maître des cérémonies Dreux-Brézé – « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n’en sortirons que par la force des baïonnettes » – a été inventée de toutes pièces a posteriori. Les mots « peuple » et « maître » n’apparaissent que plus tard, à partir de 1791. En réalité, les avocats et les juristes du tiers état sont loin de représenter le peuple au nom duquel ils parlent. La France est agricole et rurale à 80 % et seule une poignée de députés du tiers appartient à ce monde-là.
Les députés du tiers état ont trop lu !
Vous revenez souvent sur le pouvoir des. Les mots qui fabriquent le réel : c’est la définition de l’idéologie.
Les députés du tiers état ont trop lu ! Beaucoup appartiennent à ces « sociétés de pensée » décrites par Augustin Cochin au siècle dernier (académies, sociétés de lecture, loges maçonniques), qui sont autant de laboratoires des idées des Lumières, des philosophes à Jean-Jacques Rousseau, des droits naturels au contrat social. Pourtant, rares sont ceux qui comme l’abbé Sieyès ont véritablement pensé la représentation comme le bras politique et légitime de la souveraineté nationale. Nombre de députés du tiers réclament une constitution sans très bien savoir ce qu’elle sera. Il ne faut pas oublier non plus leur origine robine. Les trois quarts d’entre eux appartiennent à la basoche et aux offices de judicature : procureurs, notaires et surtout avocats. Ils sont élus parce qu’ils sont les seuls à maîtriser le discours et la parole, sur fond d’abstention et d’émeutes, sans aucun contrôle de la part du gouvernement royal. En vérité, leur amour des mots, leur goût des abstractions tiennent moins au Contrat social de Rousseau qu’à leurs « Mémoires à consulter », aux prétoires et aux plaidoiries. Par expérience, ils ont tendance à vouloir tordre le réel, à l’adapter aux catégories du droit.
Peut-être découvrent-ils aussi ce qu’on n’appelle pas encore la « liberté d’expression » ?
Oui, mais c’est une autre histoire. L’opinion, le déferlement des brochures ont évidemment joué un rôle essentiel. Mais je veux souligner ici que, pendant toute la Révolution, les luttes de factions ont été des luttes de mots. Qui détient la tribune détient le pouvoir, pourvu que les
sections sans-culotte parisiennes prennent ces mots pour des vérités. Il y a dans la Révolution française une dimension littéraire. Certes, contrairement aux Cent jours et aux révolutions de 1830 et de 1848, 1789 n’a pas eu d’écrivains de génie – ni vraiment Chateaubriand qui était à peine là, ni Stendhal, qui était trop jeune, ni Hugo, qui n’était pas né. Plus tard, c’est surtout la Terreur qui inspirera ces derniers (voyez le 1793 de Victor Hugo), pas la « promesse » de 89. Reste qu’en France, les mots précèdent les choses. Comme l’écrit Tocqueville dans ses Souvenirs de 1848, il y a un peu d’un homme de lettres dans chaque Français, dans la mesure où il accorde plus d’importance à ce qu’Adolphe Thiers appelle « le réel d’imaginaire », qu’au réel tout court. Les Français sont les fils dénaturés de Descartes. Ils évoquent sans cesse la raison et pourtant ils sont littéralement habités par leurs rêves, leurs désirs, leurs fantasmes. Avec eux, les symboles prennent bien souvent le pas sur l’histoire, sur le passé, sur la complexité des choses et du réel. En découvrant le décret du 17 juin, le comte de Virieu, un noble libéral, n’en revient pas de ce pouvoir des mots. À ce compte-là, plaisante-t-il, il ne me reste plus qu’à me déclarer pape pour l’être. Or, cette dimension est essentielle si on veut comprendre la dynamique révolutionnaire. Les mots de 1789 sont déjà ceux de la Terreur.
La révolution du tiers état ressemble beaucoup à une revanche trop longtemps différée sur la noblesse et le clergé
En somme, la prétention à changer le monde par le verbe annonce la logique terroriste ?
Je me garderais bien de le dire comme cela. Plutôt que de « terrorisme », je préfère parler d’atmosphère et de climat. En 1789, le climat qui a porté nombre de Français à l’utopie, à l’enthousiasme, à la justice et au bonheur n’était pas si printanier que cela. La révolution du tiers état ressemble beaucoup à une revanche trop longtemps différée sur la noblesse et le clergé. Elle est faite aussi de jalousies, de haines, de ressentiments, de suspicions réciproques.
Les députés du tiers disent : « Nous sommes la nation », ce qui signifie « nous sommes toute la nation ». Et les « autres », que deviennent-ils ?
La démonstration de juin 1789 – largement revisitée et magnifiée par la suite – est une démonstration d’unanimité. L’indivisibilité fonde la nation et en même temps elle porte les conséquences tragiques de son absolutisme. Elle ne suppose aucune forme d’opposition. Elle crée à mesure des dissidents, des traîtres et des ennemis. Et ceux-là bientôt mériteront la mort. Le premier dissident de la Révolution est un obscur député du tiers état, Martin-Dauch, qui le 20 juin fut le seul à refuser de prêter le serment du Jeu de paume. Le roi, pensait-il, ne serait pas content si on ne lui demandait pas sa sanction. Dans son tableau du Serment qui fixe à jamais la mémoire de cette journée, le peintre David en a fait un traître d’anthologie. Il ne sera pas le dernier.
De même, le « suspect » est né dans les discours de juin 1789. Les « attentats » contre la nation souveraine qui très vite ont pris la forme d’obscurs complots aussi. Le premier complot dénoncé en juin par les députés du tiers état et par l’opinion révolutionnaire, c’est celui dit des « aristocrates ». Le mot signifiait jusqu’alors le gouvernement des meilleurs. Désormais, l’aristocrate identifié aux nobles ou à leurs amis est un traître. Le complot, réel ou supposé, est au cœur de la dynamique révolutionnaire.

Vous tournez autour du pot, mais faut-il comprendre que 1789 annonce 1793 ? Pardon de cette question tarte à la crème, mais la Terreur était-elle inévitable ? Au demeurant, pourquoi écrire terrorisme entre guillemets ?
La terreur doit se comprendre dans un contexte de guerre civile beaucoup plus que comme un corpus idéologique. Née en septembre 1792, la République est très vite en danger de mort : guerres de Vendée, insurrection de Lyon, de Toulon, guerres extérieures. La Terreur a été l’arme politique déployée par les jacobins pour la sauver. Nous sommes encore au xviiie siècle. Le sens des mots doit être compris à l’aune de ce siècle. Si l’on s’en rapporte à L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, « terroriser », c’est jeter l’effroi dans les rangs de l’adversaire. Du reste, la terreur s’exerce tout autant du côté de la contre-révolution que de la Révolution. La Terreur n’est donc pas une idéologie totalisante et totalitaire comme elle l’a été au xxe siècle, c’est une arme de combat. Il n’y a jamais eu véritablement de gouvernement de la Terreur. C’est un membre du club des Jacobins qui met la Terreur à l’ordre du jour, pas la Convention nationale. Cette période a été un immense bazar fait de conflits d’intérêts et de pouvoirs entre des factions politiques, des comités, des administrations qui se tiraient dans les pattes les unes les autres, où personne n’a été vraiment capable d’organiser quoi que ce soit. Dans l’esprit des révolutionnaires, elle était un moyen (atroce) de « légitime défense ». Ce qui ne la justifie pas pour autant.
Chez Lénine aussi, c’est un moyen…
Elle est au cœur du projet communiste dès la révolution d’octobre 1917 : une minorité s’empare des moyens de la contrainte et du pouvoir. Au contraire, les révolutionnaires de 1789 pensent la Révolution comme universelle et indivisible. Personne n’a pensé à l’époque que cela conduirait tout droit à la Terreur.
Selon vous, les révolutionnaires inventent la politique. Sauf que la politique ne crée pas les clivages, elle les représente dans un théâtre prévu à cet effet.
Ça c’est le parlementarisme dont l’apprentissage se fait surtout après la Révolution, sous la Restauration et la monarchie de Juillet. La politique naît en 1789, et. On ne conçoit pas à cette époque qu’il puisse exister des minorités et des majorités d’assemblée. C’est pour cela qu’on prête serment.
En quoi cette semaine est-elle fondatrice et la France qui en est issue déjà la nôtre ?
C’est à ce moment-là que la politique naît en France, et elle naît avec une disposition particulière à la conflictualité. Le complot sur lequel je reviendrai habite encore nos imaginaires. De même l’irruption de la morale en politique au nom de la vertu. Des 1789, les notions de bien et de mal traversent les discours des députés les plus radicaux comme Robespierre. Et ces catégories morales vont très vite être érigées en une sorte de ligne de partage entre les pauvres et les riches. Souvenez-vous de l’apostrophe de Joseph Fouché, le futur ministre de la police, en 1793 : « Ici on rougit d’être riche et l’on s’honore d’être pauvre. » Enfin, la Révolution s’est accomplie au nom de la transparence, contre le « secret du roi ». Ce sont les députés du tiers qui les premiers, et contre les ordres de ce dernier, rendent leurs délibérations publiques. La caisse de résonance de l’opinion leur était indispensable. Les rapports métaphoriques de l’ombre et de la lumière hantent les esprits de 89. Plus de comptes publics secrets, plus de diplomatie secrète. Le secret est contre-révolutionnaire. En même temps, très vite, les révolutionnaires vont réaliser qu’il n’y a pas de politique et de légitimité du pouvoir sans une part de secret.

La Révolution, écrivez-vous, c’est à la fois les droits de l’homme et la Terreur. Est-ce encore ce qui nous constitue ?
Les droits de l’homme étaient déjà violés avant même que l’encre de la Déclaration des droits de l’homme n’ait eu le temps de sécher, à commencer par la liberté d’opinion. De même la séparation des pouvoirs. Dès le 23 juin, Mirabeau érige la surveillance et la dénonciation en vertus citoyennes. La Révolution a été une vaste machine surveillante, depuis les comités de recherches de l’Assemblée nationale et de la Commune de Paris jusqu’aux innombrables comités de surveillance de 1793. De la surveillance, on passe à la dénonciation. Et de la dénonciation à la délation, la frontière est mince. Plus besoin de preuves, l’intention suffit pour vous condamner à mort.
Vous tireriez un fil allant de la délation de ces années à 1940 ?
Je pense que cette pratique est dans l’ADN français. Est-elle née pendant la Révolution ? En tout cas, c’est à ce moment-là qu’elle a été politisée et érigée en nécessité politique, puis en vertu républicaine.
On le sait, la mémoire réécrit l’histoire. La mémoire nationale a eu tendance à faire des débuts de la Révolution une sorte de conte de fées…
Dans la reconstruction mémorielle de la séquence fondatrice de la Révolution, l’ennemi, le traître, le complot, le secret, la haine du riche n’apparaissent pas. Pendant plus d’un siècle, on a voulu célébrer la nation unanime, l’égalité, la liberté et la fraternité. À lire les documents contemporains de l’événement, les esprits étaient beaucoup moins iréniques. Mais cette réécriture était essentielle, car elle est au cœur de la légitimité républicaine.
La nation française s’est constituée en sept jours après mille ans de monarchie
Pendant très longtemps, l’interprétation qu’on avait de la Révolution a été un marqueur politique. Autrement dit, peut-il exister une seule histoire de la Révolution ?
De ce point de vue, je me vis un peu comme un suiveur de François Furet. La Révolution ne peut être étudiée « de l’intérieur » que pour la condamner ou la glorifier. Pour la comprendre, il faut en sortir. Je ne fais pas d’idéologie, j’essaie de comprendre la façon dont les choses se sont passées et dont on les a sublimées.
La nation française s’est constituée en sept jours après mille ans de monarchie. La Révolution française a été à la fois politique et sociale, ombrageuse, absolutiste et guerrière. Certes elle s’inscrit dans un cycle qui traverse toute la seconde moitié du xviiie siècle (la révolution américaine, celle de Genève, de la Hollande, du Brabant), mais elle n’est comparable à aucune autre. La « table rase », c’est Français. Je vais vous donner un seul exemple. La Révolution s’est faite sur la négation du passé, jusqu’à l’iconoclasme de la Terreur : « L’histoire n’est pas notre code », disait en 1789 le pasteur Rabaut Saint-Étienne, l’un des « pères fondateurs » de la souveraineté de la nation. D’où la volonté de créer un homme régénéré, un républicain tout neuf. C’est pour cela que tout ce qui a précédé est très vite devenu « l’Ancien Régime ».
Sauf qu’on n’éradique pas si aisément le vieux monde…
En effet sauf à réinventer la société française, ce qui arrivera peut-être un jour, la Révolution porte en elle-même son incomplétude. Mais pour l’instant, nous sommes encore les héritiers d’une double culture. De l’Ancien Régime, nous avons conservé le goût des préséances, des hiérarchies et des privilèges. Il n’y a pas plus de grades, d’échelons et de titres que dans l’administration française. Ne nous étonnons pas dans ces conditions de nos flagorneries. Il restera toujours en nous quelque chose du courtisan. Puis, à nos traditions d’Ancien Régime sont venues s’ajouter celles de la Révolution, notamment un attachement indéfectible à l’égalité. Résultat : tout en léchant les bottes de notre supérieur, nous avons furieusement envie de lui couper la tête. Je le dis en souriant, mais nous sommes tout de même un peu schizophrènes.
Allez, pour finir, un petit jeu. Qu’auriez-vous été ?
Si je me réfère à mes origines sociales, même si je n’ai certainement pas le fétichisme du déterminisme et des héritages, j’aurais peut-être été assez proche de ces aristocrates libéraux qui formaient alors la minorité de l’ordre de la noblesse. Ces gens prônaient sincèrement des réformes. Mais en 89, l’affrontement l’a emporté sur le compromis – ce fut le « modèle breton » avec ses combats de rue, ses morts et ses haines entre la bourgeoisie et la noblesse – en particulier à Rennes en janvier 1789.
Mais pour revenir à votre question initiale, j’aurais été anglais, à l’image de l’agronome Arthur Young, éberlué de ce qu’il voyait et entendait. Comme lui, je suis incapable de comprendre la théocratie d’Ancien Régime, l’alliance du trône et de l’autel comme l’on disait (« Mon royaume n’est pas de ce monde ») et pas plus cet absurde renversement de sacralité du côté des hommes et de la République qui s’opère par le serment du 20 juin 1789. La transformation mémorielle des grands principes révolutionnaires en promesse fondatrice porte en elle tout à la fois nos espoirs et nos déceptions. D’où ma volonté de traiter cette séquence en l’observant des deux côtés, du côté du roi et du côté de la Révolution. Contrairement à Furet je ne pense pas que la Révolution soit devenue « un objet froid ». Elle nous a donné en héritage, pour le meilleur et pour le pire, des pratiques politiques, et plus encore une sorte de psychologie invisible. Ses paradoxes sont toujours à l’œuvre aujourd’hui, entre la représentation parlementaire et la rue, la transparence et le secret, les rêves et la raison, l’oubli du passé et sa transmission, et jusqu’à nos divergences sur notre actuel modèle économique et financier. Par exemple, la haine de la finance et de l’« agiotage » –spéculation comme on disait à l’époque – est née à droite, en 1789, avant de passer à gauche. Comme la décentralisation, comme l’écologie, comme beaucoup d’autres choses. Bref nous sommes encore les enfants de 89, des enfants un peu grognons. Nous n’avons pas fini de faire l’apprentissage de nos illusions.
Sept jours – 17-23 juin, la France entre en Révolution. Tallandier, octobre 2020.