« Paris est la seule ville du monde où coule un fleuve encadré par deux rangées de livres », dixit Blaise Cendrars. Causeur peut y dénicher quelques pépites…
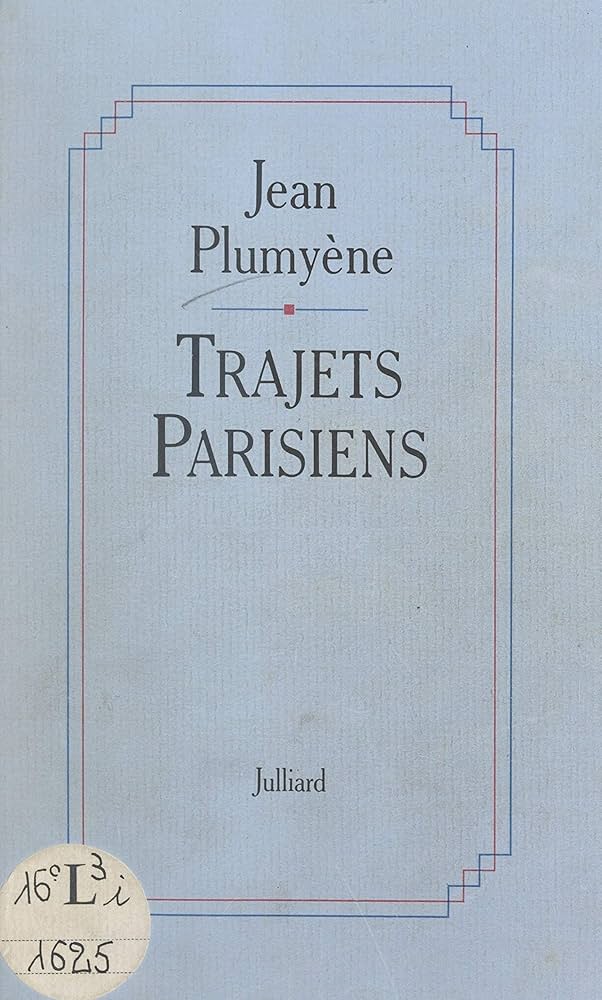
On écrit sur Paris avec ses jambes autant qu’avec sa plume. L’écrivain de Paris est un marcheur, un arpenteur de rues, de buttes, de plaines et de boulevards ; un fouineur de caves et de mansardes ; un client de bistrots et de restos ; un chat de salon et un rat de bibliothèque… car un écrivain de Paris est aussi un lecteur. Il sait qu’à force de tourner en rond dans cette ville depuis mille ans, les auteurs qui le précèdent y ont rédigé les plus belles pages, qu’en sortant de chez soi on ne peut que mettre ses pas dans ceux d’autrui et emprunter les mots des autres – parfois sans le savoir. Cet enrichissement successif, ce millefeuille de phrases et d’impressions, cette accumulation de choses vues qui se refile de génération en génération explique peut-être l’éternelle réinvention de cette littérature parisienne. Et il arrive qu’un miracle advienne.
Trajets parisiens, de Jean Plumyène (1932-1986), est un bijou sans préciosités, une démonstration d’élégance sans maniérisme. Le ton est juste, le regard est franc, les mots sont simples : Plumyène est au sommet de son art. Que cherche-t-il ? Reconstituer la géographie parisienne de quelques auteurs, retracer leurs déambulations citadines, leurs habitudes, leurs promenades, leurs appartements et leurs déménagements. « C’est un sujet de rêverie, en attendant de devenir un objet de science, que les migrations, d’un quartier à l’autre de la capitale, de ses artistes et de ses écrivains. » En six chapitres, on découvre donc à ses côtés « les Goncourt dans leur paysage », le « trajet de Léautaud », les « domiciles de Fargue », le « Paris surréel » de Breton, l’« Aragon parisien » et le « Paris-centre » de quelques autres, Céline, notamment. Pourquoi eux ? Parce que « tous les écrivains sont parisiens, mais certains le sont plus que d’autres ».
Il observe la façade de l’immeuble de l’un, les commerces de la rue d’un autre, gravit les escaliers qui mènent à la porte d’un troisième… Jean Plumyène consigne ses pérégrinations au début des années 1980, quand il était encore possible d’avoir sous les yeux les vestiges vivants du Paris du xixe siècle et des années 1930. Il se fait ouvrir la chambre de bonne de Léautaud, retrouve le dernier appartement de Fargue, s’attable au Cyrano, le QG des surréalistes à Pigalle, qu’il voit cependant, plus tard, dépecé de son décor historique pour devenir un fast-food. Mais Plumyène estime que « rien de parisien ne disparaît jamais vraiment. Les grandes villes, il faut le savoir, ont meilleure mémoire que les campagnes, par nature plus exposées qu’elles, toujours à la merci des grandes invasions, des végétations destructrices ». Il n’a pas complètement tort, mais aujourd’hui, le Paris préservé se cache derrière des digicodes et l’acharnement de quelques édiles à ratiboiser ce qui dépasse du passé annonce la disparition des ultimes survivances de ce Paris du quotidien des siècles anciens. Nul doute que la promenade, qu’il compare à la conversation (« le causeur change de sujet, le promeneur de trottoir »), sera toujours possible à l’avenir. Reste à savoir quel sera l’avenir du piéton de Paris condamné à arpenter des « rues piétonnes ».
Trajets parisiens, Jean Plumyène, Julliard, 1984.




