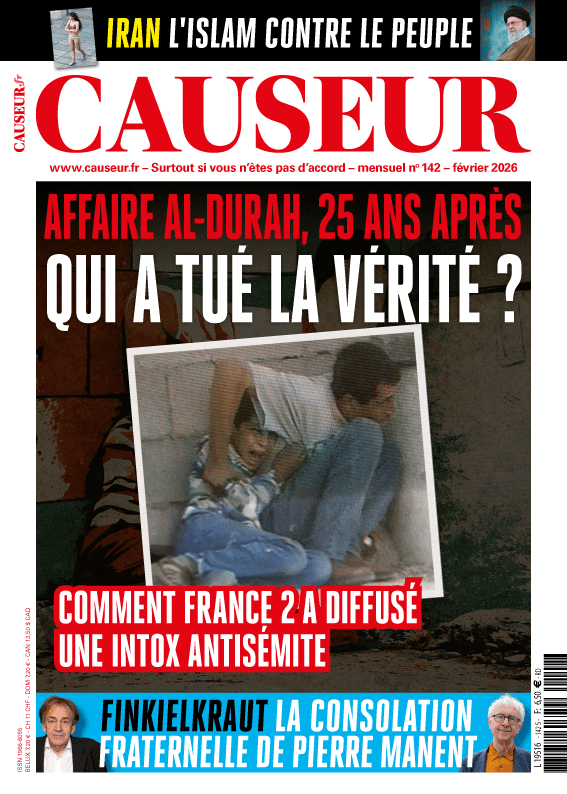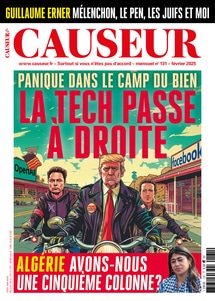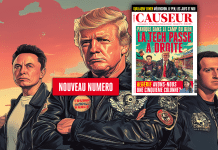Avec ses 32000 agents (dont seulement la moitié de chercheurs) et un budget de 3,7 milliards d’euros, le Centre national de la recherche scientifique est devenu un pachyderme administratif qui cumule les doublons et ne figure plus depuis longtemps en tête des classements. Il existe d’autres établissements aux compétences quasi égales : les universités.
La situation très dégradée des finances publiques et l’excès évident de la dépense devraient imposer à tout gouvernement doté d’un minimum de courage une révision générale des politiques menées afin de traquer les organes inutiles, de rationaliser ce qui peut l’être et plus largement de redéfinir le champ d’intervention de l’État. Si une telle politique, à vrai dire inespérée, était menée, il y a fort à parier qu’une institution apparaîtrait bientôt dans le radar : le Centre national de la recherche scientifique. Certes, la façade est rutilante et peut faire illusion. Le CNRS, c’est 32 000 agents en 2021, derniers chiffres connus – dont seulement la moitié de chercheurs, le reste étant composé d’agents administratifs, ce qui laisse augurer d’un problème. C’est un budget de 3,7 milliards d’euros, dont plus de trois quarts de subventions de l’État (les ressources propres, c’est-à-dire les services rendus aux entreprises, mais aussi à d’autres organismes publics, en représentent donc moins d’un quart). C’est un organisme de rang mondial, le troisième, selon les organes de classement qui font autorité, et même le premier en Europe (mais ce classement comporte un biais important, non seulement en raison de la taille du CNRS, mais parce qu’il est fondé sur un nombre de publications dont beaucoup émanent en fait des universités). C’est enfin une histoire prestigieuse, et donc intouchable, puisque par le nom de son fondateur, Jean Zay, il est associé au meilleur de la Résistance française contre le nazisme, que le général de Gaulle en a fait, dans les années 1960, un des fers de lance de sa politique de grandeur nationale et que de nombreux scientifiques, parmi les plus reconnus et les plus récompensés, prix Nobel et médailles Field compris, ont travaillé en son sein.
Il reste que ces temps héroïques sont un peu derrière nous, si on en croit les derniers indicateurs disponibles et les évolutions inquiétantes qu’ils dessinent : la France ne consacre que 2,2 % de son PIB à la recherche, loin derrière l’objectif de 3 % fixé par l’Union européenne, loin, surtout, des 3,13 % que réalise l’Allemagne, et est totalement dépassée par les pays asiatiques les plus innovants (4,93 % pour la Corée) et, champion du monde, par Israël avec 5,8 %. Certes, l’État n’est pas seul en cause, puisque environ deux tiers des dépenses intérieures de recherche et développement émanent des entreprises, mais au moins serait-il bon de leur donner un environnement favorable auquel les controverses perpétuelles sur le principal instrument de soutien, le crédit impôt-recherche, ne contribuent pas vraiment. La recherche publique ne peut en revanche se dédouaner d’une autre tendance défavorable : la part de la France dans le nombre de publications scientifiques ne cesse de décroître et notre pays figure désormais à la huitième place, dépassé depuis 2017 par l’Italie. Puisqu’il se veut le fleuron du secteur, la responsabilité du CNRS dans ce fiasco ne peut pas être éludée. Mais au-delà de ces effets circonstanciels, le mastodonte public pose deux types de problèmes structurels.
Une place discutable dans le paysage universitaire
Le premier est un problème d’organisation administrative. Le CNRS est en effet un acteur inutile, dans la mesure où il existe déjà des établissements qui, à côté de leur mission d’enseignement, et en lien étroit avec elle, se voient reconnaître une compétence très large en matière de recherche : ce sont tout simplement les universités. Elles disposent d’ailleurs pour cela, avec quelques établissements assimilés, d’un monopole (sur lequel on pourrait d’ailleurs discuter) qui est celui de délivrer les diplômes du doctorat et de l’habilitation à diriger des recherches, alors que le CNRS n’intervient en aucun cas en la matière. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas mieux éviter un doublon et organiser la totalité de la recherche scientifique autour de grands pôles universitaires, comme le font l’immense majorité des pays développés ? Quel est l’apport du CNRS ? Que fait-il que les universités ne pourraient pas faire ? Officiellement contribuer à définir une politique générale de la recherche. Mais outre qu’on peut légitimement s’interroger sur cette centralisation dans un pays démocratique, force est de reconnaître que le CNRS s’acquitte très mal de cette tâche. C’est en tout cas un des principaux reproches que lui fait l’organisme public d’évaluation (le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ou Hcéres dans le jargon du ministère de l’Enseignement et la Recherche, qui comme toutes les bureaucraties labyrinthiques, adore les acronymes) dans le dernier rapport qu’il lui consacre en novembre 2023. Et de noter, avec une fermeté assez rare pour être soulignée que « le conseil d’administration du CNRS ne joue pas son rôle stratégique[1] ». Autre mission avancée : gérer de gros équipements de recherche qui nécessitent des immobilisations lourdes et des équipes importantes. L’argument semble incontestable pour justifier l’existence du CNRS, au moins dans les sciences dures, physique ou biologie par exemple, mais ne vaut rien en matière de sciences sociales et humaines (16 % de l’activité du CNRS qui pourrait donc sans dommage sortir de l’institution). Notons surtout, pour mieux apprécier la rigueur de la démonstration, que les secteurs où ces équipements sont les parmi plus considérables, c’est-à-dire l’énergie atomique et la médecine, ne sont pas rattachés au CNRS, mais disposent de leur propre centre de recherche, respectivement le CEA et l’Inserm. Chercher l’erreur… Enfin, le CNRS sert à sélectionner des dossiers de recherche et accueille les universitaires qui les ont initiés en « délégation » (pendant quelques mois, ils sont accueillis au CNRS et dispensés de leur charge d’enseignement, qui est de cent quatre-vingt-douze heures par an) ou leur fait bénéficier d’avantages matériels. Cette fonction est évidemment légitime mais n’a nul besoin, pour être accomplie, d’une structure aussi lourde que le CNRS. C’est si vrai qu’une structure, beaucoup plus légère, existe déjà à cette fin : il s’agit de l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui distribue 1,2 milliard d’euros par an et pourrait tout à fait élargir ses missions. La France n’a besoin que d’une agence de moyens et non pas de deux, dont l’une éléphantesque.
Le malheur est que le CNRS n’est pas seulement inutile, il est aussi néfaste. Pour le comprendre, il faut ouvrir le capot et explorer la machinerie administrative. En général, le CNRS n’agit pas seul : son mode d’action privilégié passe par une association avec l’université dans le cadre d’une structure conjointe appelée une « unité mixte de recherche » (UMR). Ces laboratoires regroupent des personnels titulaires de l’université, qui sont très majoritaires (professeurs et maîtres de conférences), et des personnels titulaires du CNRS (chargés et directeurs de recherche), auxquels s’ajoutent des doctorants et quelques électrons libres ne disposant pas de postes fixes (membres associés). Cette organisation présente deux défauts majeurs. D’abord, les agents du CNRS, dont le statut, notamment en termes indemnitaires, est très proche de celui de leurs collègues universitaires, ne doivent aucune charge de cours. L’enseignement supérieur se prive ainsi de 16 000 enseignants, alors que les besoins sont criants, les amphithéâtres surchargés et que sont pratiqués à grande échelle l’embauche de vacataires et le paiement d’heures dites « complémentaires » (royalement rémunérées autour de 43 euros brut). Cette situation commence d’ailleurs à faire scandale et est désormais ouvertement contestée, y compris dans la presse bien-pensante. Le second défaut n’est pas moins grave et sans doute plus sournois. La présence du CNRS au sein des UMR complique la machine bureaucratique, déjà protubérante au sein des universités, et consiste concrètement à tout faire en double. Certaines dépenses sont prises sur des crédits du CNRS, d’autres sur des crédits universitaires, sans que leur nature diffère réellement. Il y a évidemment deux logiciels de paiement, deux cadres juridiques pour la gestion du personnel, deux structures hiérarchiques… Le nombre de réunions, de comités et de conseils, tantôt de « labo », tantôt d’UFR ou de « sous-section », est multiplié par deux, alimentant une tendance déjà prononcée à la polysynodie. Cette redondance et ce temps mal employé ont évidemment un coût qui mériterait d’être chiffré.
Vers un modèle plus efficace et compétitif
La réorganisation administrative n’est pas le seul problème généré par le CNRS. Il en existe un second, qui porte sur les principes et engage la liberté, et donc la nécessaire diversité de la recherche. Est-il légitime de définir une orientation générale de la recherche émanant d’une seule institution, qui plus est publique ? Les esprits libéraux répondront probablement par la négative. Cette interrogation est particulièrement sensible dans le domaine des sciences sociales et humaines, où l’on voit les effets d’une telle politique, qui sont de privilégier les sujets à la mode ou idéologiquement mobilisables, c’est-à-dire, dans les faits, le colonial et le « post-colonial », le genre et l’écologie. Le problème n’est pas que ces thèmes, au demeurant légitimes et souvent honnêtement traités, soient abordés, c’est qu’ils ont acquis, sinon une exclusivité, au moins une prépondérance, qu’ils sont, dans certains cas, devenus des passages obligés ou des réflexes conditionnés, au détriment d’autres thèmes, tout aussi légitimes, de l’imagination créative ou de la simple curiosité intellectuelle. À cela s’ajoutent (mais la remarque vaut malheureusement aussi pour les universités) des procédures de recrutement insuffisamment robustes, surtout lorsqu’il s’agit d’emplois à vie : la direction du CNRS a ainsi été dernièrement mise en cause par la Cour des comptes pour avoir modifié les ordres de classement établis par des commissions d’experts.
Que faire donc ? Supprimer le CNRS assurément. Mais ce projet se décline en deux temps. Il prend d’abord la forme d’une réorganisation administrative, simple dans son principe, redoutable dans ses modalités. Il suffit de faire comme partout et d’articuler l’enseignement supérieur et la recherche autour de trois types d’institutions : des universités qui se voient reconnaître, comme c’est déjà largement le cas, une compétence générale en la matière ; une agence de moyens, l’ANR, dont la force de frappe serait renforcée ; et une instance d’évaluation, l’Hcéres. Et rien d’autre ! Dans les faits, il suffirait de transférer les moyens du CNRS aux établissements universitaires auxquels ils sont déjà associés, de verser les chargés de recherche dans le corps des maîtres de conférences et les directeurs dans celui des professeurs. Dans cette architecture rationalisée (on imagine les économies d’échelle !), on pourrait même imaginer de faire sortir l’agence de moyens de la sphère publique. C’est le cas en Suisse, pays bien plus performant que la France en la matière (la recherche y représente 3,3 % du PIB) où la structure équivalente, le Fonds national suisse, revendique fièrement son statut de fondation de droit privé. Car une simple rationalisation administrative est sans doute insuffisante et il faut imaginer une réforme plus large qui viendrait casser le quasi-monopole de l’État en matière de recherche fondamentale. La création de véritables universités privées, combinant enseignement supérieur et recherche, et délivrant un diplôme équivalent au doctorat, devrait très sérieusement être envisagée, sur le modèle de ce qui se passe à peu près partout dans le monde occidental. On doit à cet égard saluer l’audace du patronat italien (et la pusillanimité de son homologue français) qui a fondé, dès 1974, une université, la Luiss, devenue depuis une des premières d’Europe en économie et en sciences politiques. Cette orientation permettrait à coup sûr d’établir une véritable diversité de pensée, difficilement envisageable dans un périmètre purement public, et une plus grande efficacité, gagée sur la concurrence. S’interroger sur l’avenir du CNRS, c’est aussi ouvrir un débat salutaire sur l’ensemble de notre système d’enseignement et de recherche, dont l’ensemble de la société serait à terme bénéficiaire.
[1] « Rapport d’évaluation du CNRS », novembre 2023, p. 4, consultable en ligne sur le site du Hcéres.